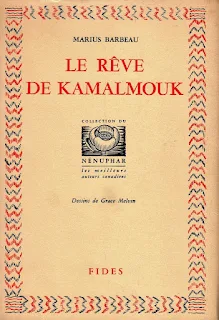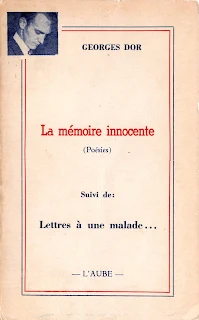Louis-Frédéric Rouquette, La bête errante, Paris,
La Revue Française - Alexis Rédier, (vers 1930), 279 p. (coll. Le Paon Blanc)
(lithographies en deux tons de Georges Tcherkessoff) (Édition originale : Ferenczi,
1923) — Le livre est de grande qualité. Papier vélin, bandeau au début de
chacun des chapitres, en plus des lithographies.
L’action
se situe dans le prolongement du
Grand
silence blanc que j’ai déjà blogué. Ce n’est pas, à proprement
parler, un véritable Laurentiana, les Canadiens français n’étant que mentionnés
ici et là et n’étant représentés que par un personnage secondaire.
Nous
sommes au Yukon, aux alentours de 1920. La Ruée vers l’or est terminée depuis
longtemps. Seuls quelques irréductibles persistent. L’histoire débute à
Cariboo-kid, dans un camp de mineurs. Hurricane, un ancien étudiant de Berkeley,
a quitté San Francisco et s’est fait chercheur d’or par amour pour Dolly. Il se
lie d’amitié avec Gregory Land, le maître de poste, qui parcourt le Yukon pour distribuer
le courrier. Quand ce dernier quitte Cariboo-Kid pour se rendre à Dawson,
Hurricane décide de l’accompagner. Sur leur route, ils croisent un homme mort,
assassiné. À Last-Chance, autre camp de mineurs, ils s’arrêtent : ils
découvrent les deux meurtriers, qui seront pendus à la suite d’un procès expéditif.
Dans l’altercation qui a eu lieu au moment de la dénonciation, Hurricane s’est
démis une épaule. Après l’avoir soigné pendant quelque temps, Gregory doit reprendre
sa route. Hurricane, guéri, exploite une mine dans la région avec un Cri nommé Billikins,
mais n’en tire pas de grands revenus. L’hiver revient et la vie s’arrête. Quand
Gregory, le maître postier, revient au printemps, Hurricane découvre qu’il n’a
pas de lettres pour lui. Sa belle l’a oublié.
Hurricane
part avec Gregory à Dawson. On y présente un film dans lequel Dolly joue. Fou
de rage, Hurricane s’engage dans une bataille dont il sort sérieusement blessé.
Une dancing-girl, Flossie, le soigne. Il avait aidé cette fille lorsqu’ils
étaient tous deux à Cariboo-Kid. Gregory doit continuer la distribution du
courrier plus au nord, jusqu’à Forty Miles. Hurricane, Flossie et Billikins
l’accompagnent. Pour leur malheur, Gregory décide de prendre un raccourci et
ils se perdent. Pendant cinq semaines, ils se battent pour leur vie. Billikins
meurt et les trois autres attendent pour ainsi dire la mort dans un igloo de
fortune. Deux chiens, Tempest et Hurricane-chien décident de « prendre les
choses en main ». Ils découvrent le campement de deux chasseurs, dont l’un
est Freddy, le héros du Grand silence blanc et l’ancien maître de
Tempest. Les chasseurs les retrouvent et les ramènent à Dawson. Hurricane
décide alors de retourner à San Francisco pour revoir son ancienne amoureuse.
Mais il a vite fait de constater qu’il n’a plus rien en commun avec elle. Il
s’installe dans le Nevada. Et un jour, Flossie revient porteuse d’une
nouvelle : elle a vendu la mine de Hurricane et il est millionnaire.
Pendant deux ans, les deux travaillent sur le ranch. Mais Hurricane s’ennuie et
il décide de repartir au Yukon. Lors
d’une randonnée sur la grande Trail, il croise Flossie qui a pris la même
décision. Les deux repartent ensemble.
À
lire le résumé, on pourrait penser qu’on se trouve devant un roman d’aventures.
En fait, le roman est lent, l’essentiel n’étant pas dans l’action. Comme le
titre l’insinue, La bête errante est un roman sur l’errance. Oui, ces
hommes et femmes espèrent trouver une fortune en grattant le sol, mais tous
savent que la ruée vers l’or, c’est de l’histoire ancienne. À moins d’une
chance inouïe, tout au plus réussiront-ils à grappiller quelques parcelles d’or
qui leur permettront de survivre. Reste donc le bonheur de vivre dans un monde
en dehors du monde, loin de la civilisation et de ses contraintes. Et de parcourir
un pays sauvage, non dépourvu d’humanité tout de même : toutes les
difficultés qu’ils rencontrent dans cette nature impitoyable obligent les êtres
- et même les bêtes - à se serrer les coudes, à dévoiler ce qu’il y a de
meilleur en eux.
Rouquette
est un romancier, mais aussi un poète, comme le démontrent sa description des
lieux et du climat, ses incursions dans la tête de ces rudes gaillards. Le
chapitre XXIX, dans lequel il décrit les cinq semaines d’errance de Gregory et
ses amis, est particulièrement brillant.
Extrait
Les chiens de Gregory mettent de la vie dans la mort du
paysage. C’est vers cette vie qu’il va avec entêtement.
La nuit l’environne, les bêtes puantes le guettent, non,
c’est la théorie des blonds archanges dont a parlé Flossie et, pour lui donner
raison, le ciel se déchire. Des rubans blanchâtres se dénouent, un à un, qui,
formant des faisceaux et des gerbes, s’allument de mille paillettes.
Au ras de l’horizon se déroule une banderole de lumière
atténuée, un immense anneau se forme dans lequel s’inscrit une croix, puis la
croix s’efface, un serpent se love; souple, fuyant, il passe au travers des
cercles bleus et roses.
La terre est comme baignée de lune. Chaque chose se détache
avec une netteté singulière.
Les chiens sont arrêtés, museaux levés. On les croirait
découpés au ciseau, de même Gregory, de même les rochers.
Derrière les scintillations qui s’élèvent, de bas en haut, on
aperçoit le clignotement des étoiles, des étoiles disparues depuis plusieurs
semaines et qui disent clairement : « Votre destin vous mène au Nord et c’est à
l’Ouest que vous alliez ! »
L’erreur est humaine, la nature seule poursuit le cycle de
son immuable révolution prévue dans les siècles des siècles.
Que pèse le vouloir des hommes !
Mais la nature leur permet l’illusion de la volonté pour les
aider à vivre... et à mourir.
Et à ceux qui vont mourir, elle dévoile sa beauté. Un halo
monte dans la transparence céleste, ses hachures dorées descendent comme une
pluie de feu, d’un feu très doux, très pâle, dont les flammes s’intensifient
peu à peu et qui, rouges à la base, jaunes au milieu, sont vertes au sommet,
et, à nouveau, dans une circonférence parfaite, une croix apparaît.
La croix de mort ou la croix d’espérance? (p. 190-191)