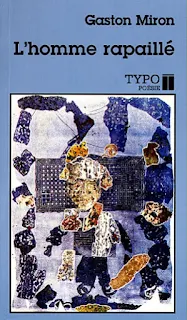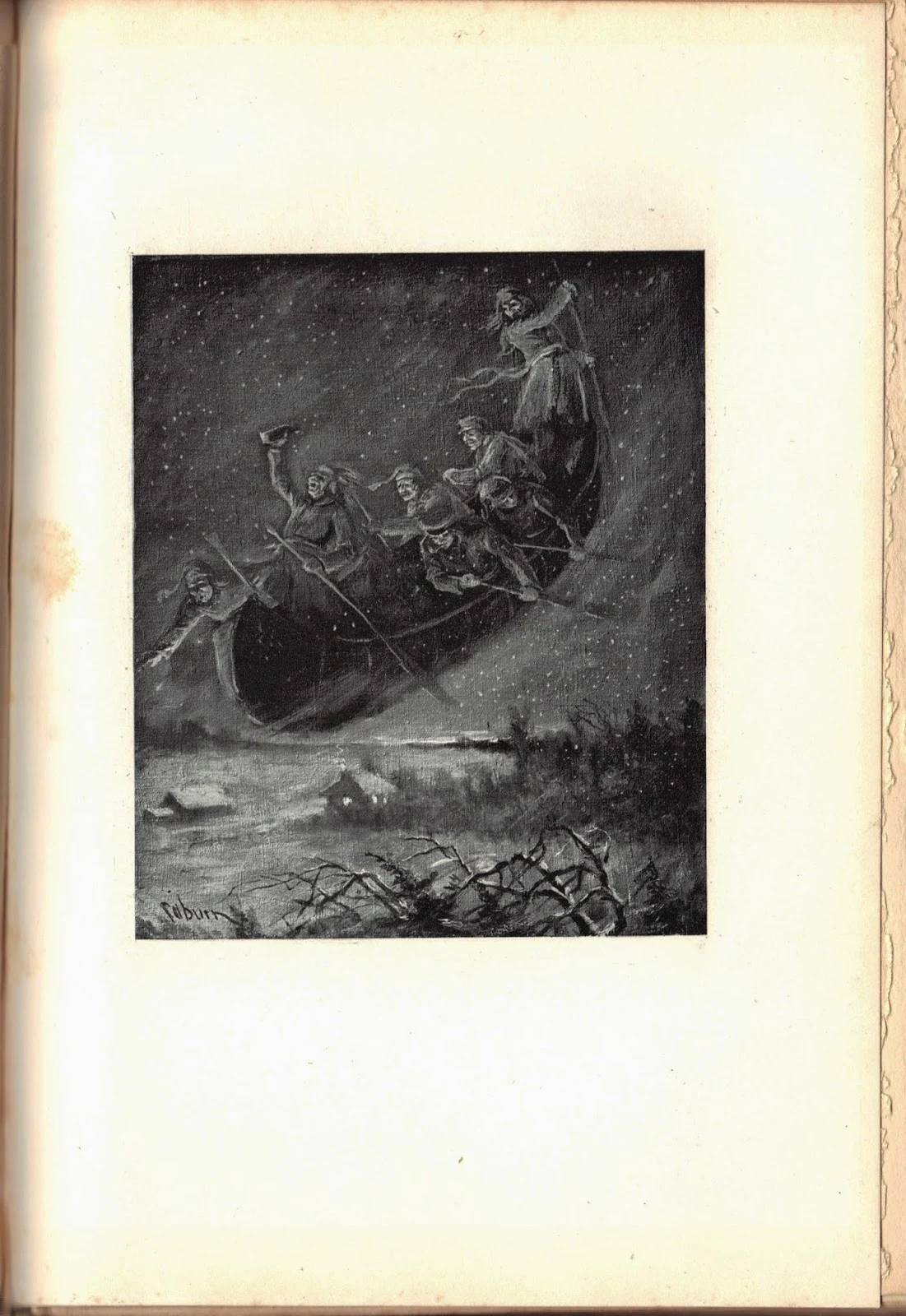|
| Première édition |
Gaston Miron, L’homme rapaillé, Montréal, PUM, 1970, 171 pages.
J'ai publié ce texte aux alentours de l'année 2000 sur Cyberscol, site disparu récemment. L'homme rapaillé est paru en 1970 mais certains poèmes datent du milieu des années 1950.
Comme l’œuvre de Miron fut en constante évolution, nous avons choisi la dernière version québécoise (Montréal, Typo, 1998) de L’homme rapaillé pour réaliser cette présentation. Cette version contient l’œuvre littéraire (presque) complète puisque Miron, au fil du temps, y a ajouté la plupart des poèmes de Deux Sangs et de Courtepointes.
J'ai publié ce texte aux alentours de l'année 2000 sur Cyberscol, site disparu récemment. L'homme rapaillé est paru en 1970 mais certains poèmes datent du milieu des années 1950.
Comme l’œuvre de Miron fut en constante évolution, nous avons choisi la dernière version québécoise (Montréal, Typo, 1998) de L’homme rapaillé pour réaliser cette présentation. Cette version contient l’œuvre littéraire (presque) complète puisque Miron, au fil du temps, y a ajouté la plupart des poèmes de Deux Sangs et de Courtepointes.
Ce recueil a été
traduit en plusieurs langues. Plus de 100000 exemplaires auraient été
vendus de par le monde.
Dans cette
présentation, nous allons nous attacher aux quatre grandes suites
mironiennes : La marche à l’amour, La batèche, La vie agonique et L’amour et
le militant. Nous présenterons aussi son plus célèbre texte
didactique, Notes sur le non-poème et le poème.
Citons quand même les autres parties du recueil : Influences, Aliénation délirante, Poèmes de l’amour en sursis, J’avance en poésie, Six Courtepointes, Pages
manuscrites, Circonstances, De la langue.
La marche à l'amour
Cette suite est
constituée de sept poèmes dont l’illustre poème éponyme. En simplifiant
beaucoup, disons que la poésie de Miron évoque quelques facettes de l’amour. D’abord, les
déconvenues amoureuses. L’amour ne va pas sans problème. Ou il ne se
réalise pas et n’a de vie que dans le poème, ou il se brise et laisse le poète
« à sa boue ». Pourtant,
comme ce sera le cas pour le militant, il suffit d’aller au plus profond de la
souffrance pour entrevoir la lumière :
ta lumière n’a pas fini de m’atteindrece jour-là, ma nouvellement oubliéeje reprendrai haut bord et destin de poursuivreen une femme aimée pour elle à cause de toi(Poème de séparation 2)
Beaucoup plus
fécondes sont les promesses de l’amour. Miron ne cesse de dire qu’il n’y a que
« la marche à l’amour » pour amender « sa vie en friche », pour conjurer ses « manitous maléfiques », pour contrer
ce qui « rend absent et malheureux »,
pour habiter « ces bouts de temps
qui halètent » et traverser les siècles. La femme « tout ensoleillée d’existence »
devient sa « ceinture fléchée
d’univers », sa « réconciliation
batailleuse », son « eau
bleue de fenêtre ». Pourtant, sans cesse l’amour se dérobe et renvoie
le poète à son errance.
je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toilentement je m’affale de tout mon long dans l’âmeje marche à toi, je titube à toi, je boisà la gourde vide du sens de la vieà ces pas semés dans les rues sans nord ni sudà ces taloches de vent sans queue et sans têteje n’ai plus de visage pour l’amourje n’ai plus de visage pour rien de rien(La marche à l’amour)
Sur un mode plus didactique, les derniers poèmes du cycle font état des empêchements de l’amour. Essentiellement, il est menacé par l’action du militant et même par la poésie, « demeure provisoire de l’amour ». (Cécile Pelosse)
Je voudrais t'aimer comme tu m'aimes, d'uneseule coulée d'être ainsi qu'il serait beaudans cet univers à la grande promesse de Sphynxmais voici la poésie, les camarades, la luttevoici le système précis qui écrase les nôtreset je ne sais plus, je ne sais plus t'aimercomme il faudrait ainsi qu'il serait bon(Avec toi)
 Les critiques se sont penchés sur la conception des rapports amoureux, particulièrement sur le rôle que Miron attribue à la femme. Ainsi Jacques Brault, dans « Miron le magnifique » : « Je veux dire que la femme ne figure qu’en fonction de l’homme; elle ne reçoit ses attributs que de l’homme, un avenir ne s’ébauche pour elle que dans le regard, les gestes, les paroles de l’homme. […] Or, l’homme de «La marche à l’amour » voit clairement cet état de choses; d’où le fiasco de son entreprise, d’où les souffrances, les plaies qu’il dénude, les dénonciations dont il s’accable et l’espèce de désœuvrement du cœur et du corps où s’installe son attente d’un amour à venir. »
Les critiques se sont penchés sur la conception des rapports amoureux, particulièrement sur le rôle que Miron attribue à la femme. Ainsi Jacques Brault, dans « Miron le magnifique » : « Je veux dire que la femme ne figure qu’en fonction de l’homme; elle ne reçoit ses attributs que de l’homme, un avenir ne s’ébauche pour elle que dans le regard, les gestes, les paroles de l’homme. […] Or, l’homme de «La marche à l’amour » voit clairement cet état de choses; d’où le fiasco de son entreprise, d’où les souffrances, les plaies qu’il dénude, les dénonciations dont il s’accable et l’espèce de désœuvrement du cœur et du corps où s’installe son attente d’un amour à venir. »
La batèche
Cette suite ne
contient que deux poèmes : Le damned
Canuck et Séquences. Cri de
colère, cri de ralliement aussi sans doute, la parole de Miron devient plus incisive :
grands hommes, classe écran, qui avez fait de moile sous-homme, la grimace souffrante du cro-magnonl’homme du cheap way, l’homme du cheap workle damned Canuck(Le damned Canuck)
L’idée de
« La batèche » lui est venue dans une taverne en 1953. Ses compagnons
et lui se récitaient leurs poèmes. Autour d’eux les habitués forment un cercle.
Laissons Miron raconter la suite : « Tout à coup l’un de ceux-ci nous
apostrophe : "C’est pas ça, vous l’avez pas pantoute. C’est comme ça
qu’on dit : Crisse de câlisse de tabarnak d’ostie de saint-chrême..."
En un éclair, je viens de saisir l’un des éléments rythmiques de notre parole
populaire, celui du juron. » Cette « découverte » nous vaudra
ces vers, devenus célèbres :
Damned Canuck de damned Canuck de pea soupsainte bénite de sainte bénite de batèchesainte bénite de vie maganée de batèchebelle grégousse de vieille réguine de batèche(Séquences)
La vie agonique
Cette suite contient douze poèmes. Miron s’acharne à dire le triste sort
de ce pays agonique « chauve
d’ancêtres », ce « pays que
jamais ne rejoint le soleil natal », « l’inutile chlorophylle de son amour sans destin », « son visage de peuple abîmé », sa
« campagne affolée de désolement »,
son inutile « abondance captive »...
L’homme agonique a partie liée avec ce pays. L’homme agonique a un visage,
celui de Miron, « le rouge-gorge de
la forge » : « Je suis
malheureux plein ma carrure »; « je suis ici à rétrécir dans mes épaules »; « moi je gis, muré dans la boîte crânienne / dépoétisé
dans ma langue et mon appartenance / déphasé et décentré dans ma
coïncidence ».
Et pourtant le
destin de l’homme agonique n’est pas sans appel. La résistance s’organise
autour de « l’amour tocsin »
et de la poésie, « poésie mon
bivouac » dira Miron. Il faut assumer – pour la dépasser – sa condition d’humilié, quitter « les parallèles de sa pensée »,
aller sur la place publique et monter « la garde du monde ».
Il n’en faut pas
plus pour rejoindre la lumière, pour que l’avenir existe :
mais donne la main à toutes les rencontres, pays
toi qui apparais
par tous les chemins défoncés de ton histoire
aux hommes debout dans l’horizon de la justice
(Compagnon des Amériques)nous te ferons, Terre de Québec
lit des résurrections
et des mille fulgurances de nos métamorphoses
de nos levains où lève le futur
de nos volontés sans concessions
les hommes entendront battre ton pouls dans l’histoire
c’est nous ondulant dans l’automne d’octobre
c’est le bruit roux de chevreuils dans la lumière
l’avenir dégagél’avenir engagé(L’octobre)
L'amour et le militant
Cette suite compte sept poèmes, les cinq premiers
étant regroupés sous le titre éponyme, les sixième et septième étant « Le
camarade » et « Le salut d’entre les morts ».
 |
| L'édition de 1994 |
Dans une lettre écrite à Claude Haeffely, datée de 1965, Miron écrit que « L’amour et le militant » est « une tentative de concilier ces deux démarches [la poésie et l’action politique] dans une vision totalisante ». (À bout portant) Beaucoup de poèmes de Miron mélangent furtivement l’intime et le politique. « L’amour et le militant » expose et dénoue cette problématique. Quelle place doit occuper l’intime, trop souvent relégué à l’arrière-plan par les obligations du militant? Contrepoids ? Compensation? Rempart ? Si l’intime est peu satisfaisant, peut-on atteindre le « pays lumineux de [s]on être » ?
Au « milieu
de la plus quotidienne obscurité » s’impose cette nécessité :
« Femme, il me faut t’aimer femme de
mon âge ». Aux « actions
prochaines dans la lutte » du militant répondent « l’aube recommencée sur l’autre versant »,
le « manège du désir » et
« l’étreinte plus pressante
que la fatalité » de l’amoureux. « Jusque dans le bas-côté des choses » survit ce couple sans
cesse menacé, « tour à tour
désassemblé et réuni à jamais ». La « patiente amoureuse », frêle, fragile, frileuse femme souffre
« au creux dans [s]on ventre »
de l’action du militant qui déborde sur la vie amoureuse. Pour dompter la durée
et la mort, pour garder « la mémoire
et la trace », il y a l’amour, le couple. Et Miron de conclure :
« et j’en finis pas d’écouter les
mondes / au long de tes hanches…»
Notes sur le non-poème et le poème
On le sait, L’Homme rapaillé a toujours contenu
un certain nombre d’essais, terme qu’on emploiera à défaut de mieux (Miron parle
de « Recours didactiques »). Plusieurs de ces textes en prose
(parfois entrecoupés de poèmes) traitent de la langue. Dans « Notes sur le non-poème et le poème »,
c’est d’aliénation dont nous parle Miron. Non pas l’aliénation
socio-économique, si mesurable, mais celle plus subreptice, qui pervertit la
langue du minoritaire. « Je dis que
la langue est le fondement même de l’existence d’un peuple, parce qu’elle
réfléchit la totalité de sa culture en signes, en signifiés, en signifiance. »
Être dépossédé de sa langue, c’est être coupé du dehors, c’est se condamner à
l’amnésie. Le réel est « sans
contours », les autres deviennent un « agrégat », les mots « flottent
à la dérive » dans un magma innommable. Comment savoir qui l’on est si
l’on n’est nommé que de l’extérieur, par l’autre? Comment un peuple amnésique
pourrait-il transmettre sa mémoire ? « Je
suis suspendu dans le coup de foudre d’un arrêt de mon temps historique…»
Bien entendu, les poètes au premier chef souffrent de cette perversion du langage. À commencer par Miron lui-même qui, dans ce texte, doit recourir à l’explication, donc au non-poème. « La mutilation présente de ma poésie, c’est ma réduction présente à l’explication. » Pourtant, il faudra en venir au poème, identifier l’origine du mal, les coupables, se libérer du sentiment de culpabilité du minoritaire. « L’affirmation de soi, dans la lutte du poème, est la réponse à la situation, qui sépare le dehors et le dedans. Le poème refait l’homme. » En attendant que le poème devienne « souverain », le poète doit emprunter d’autres voix, celles du non-poème : « je me fais didactique… je me fais politique… je me fais utopique… je me fais idéologique… »
Bien entendu, les poètes au premier chef souffrent de cette perversion du langage. À commencer par Miron lui-même qui, dans ce texte, doit recourir à l’explication, donc au non-poème. « La mutilation présente de ma poésie, c’est ma réduction présente à l’explication. » Pourtant, il faudra en venir au poème, identifier l’origine du mal, les coupables, se libérer du sentiment de culpabilité du minoritaire. « L’affirmation de soi, dans la lutte du poème, est la réponse à la situation, qui sépare le dehors et le dedans. Le poème refait l’homme. » En attendant que le poème devienne « souverain », le poète doit emprunter d’autres voix, celles du non-poème : « je me fais didactique… je me fais politique… je me fais utopique… je me fais idéologique… »
Gaston Miron - biographie
Deux sangs
L’Homme rapaillé (étude)
À bout portant
Les débuts de l’Hexagone (Pilon)
L'Hexagone 25 : rétrospective 1953-1978
Les Matinaux (René Char)
Pour saluer Miron (2015 : Courtepointes)
Le damned Canuck (étude)
Pour saluer Miron (2018)
Avec toi (2019)
Compagnon des Amériques (2020)
Hommage à Miron (2021)
Sur la place publique (étude)
Balado sur Miron
Le poème liminaire (étude)
Deux sangs
L’Homme rapaillé (étude)
À bout portant
Les débuts de l’Hexagone (Pilon)
L'Hexagone 25 : rétrospective 1953-1978
Les Matinaux (René Char)
Pour saluer Miron (2015 : Courtepointes)
Le damned Canuck (étude)
Pour saluer Miron (2018)
Avec toi (2019)
Compagnon des Amériques (2020)
Hommage à Miron (2021)
Sur la place publique (étude)
Balado sur Miron
Le poème liminaire (étude)