(Le 14 décembre, date de décès de Miron, on se permet un peu de mironnage.)
Gaston Miron, L'homme rapaillé, Paris,
François Maspero, 1981.
(J’ai écrit ce texte en 2000 et
je l’ai publié sur le site Critiques
libres. J’avais vécu un an à Genève et je voulais faire connaître L’homme rapaillé aux Européens et aux autres francophones.)
On s’entend au Québec pour dire
que Gaston Miron est l’un de nos plus grands poètes. Et ce n’est pas parce que
Bernard Pivot, dans sa Bibliothèque idéale, l’a inséré parmi les
cinquante plus grands poètes francophones. Pourtant, il est l’auteur d’un seul
livre, qui a connu de multiples évolutions, livre toujours inachevé lorsque la
mort survient en 1996. Ce livre, c’est L’homme rapaillé (québécisme :
remettre ensemble ce qui a été séparé).
Ce recueil peut être lu en dehors
de toute considérations historiques et locales, comme en font foi les
nombreuses traductions. Pourtant, il est lié à un moment précis de notre
histoire. Aux alentours des années 1960, en pleine période de décolonisation,
les Canadiens français, aliénés, inféodés aux grands intérêts anglo-saxons
depuis la Conquête (1760) sortent de la Grande Noirceur, choisissent de s’appeler les Québécois et entrent dans l’Histoire,. Toute une partie de l’œuvre
de Miron témoigne de cette période d’effervescence où un peuple choisit de
reprendre en main sa destinée. Sa poésie est engagée, revendicatrice,
politique, plus proche de la poésie du Tiers-Monde que de celle de l’Europe.
Il est triste et pêle-mêle dans les étoiles tombées
livide, muet, nulle part et effaré, vaste fantôme
il est ce pays seul avec lui-même et neiges et rocs
un pays que jamais ne rejoint le Soleil natal
(Héritage de la tristesse)
Mais Miron n’est pas qu’un poète
de circonstances, qu’un poète national. Il a aussi écrit quelques-uns de nos
plus beaux poèmes d’amour, amour le plus souvent malheureux, amour dévoré par
le militant. Miron, c’est une espèce de Vieux Romantique, excessif, passionné, qui arrive mal à concilier poésie, militantisme et vie sentimentale.
Tu as les yeux
pers des champs de rosées
tu as les yeux d’aventure et d’années-lumière
la douceur du fond des brises au mois de mai
dans les accompagnements de ma vie en friche
avec cette chaleur d’oiseau à ton corps craintif
moi qui suis charpente et beaucoup de fardoches
moi je fonce à vive allure et entêté d’avenir
la tête en bas comme un bison dans son destin
la blancheur des nénuphars s’élève jusqu’à ton cou
pour la conjuration de mes manitous maléfiques
moi qui ai des yeux où ciel et mer s’influencent
pour la réverbération de ta mort lointaine
avec cette tache errante de chevreuil que tu as
(La marche à l’amour)
Et encore ? Miron a essayé de cerner la langue québécoise, non pas
l’argot, mais une langue héritée de nos ancêtres français et transformée par
des circonstances historiques, par cette coupure d’un siècle qui a suivi la
Conquête. Ses poèmes sont truffés de québécismes et, plus important encore, ils
essaient de reproduire le rythme de la parole populaire québécoise. Un rythme
cassé, une phrase souvent orpheline qui se développe plus par à-coups que par
longues tirades.
Nous sommes nombreux silencieux raboteux rabotés
dans les brouillards de chagrin crus
à la peine à piquer du nez dans la souche des misères
un feu de mangeoire aux tripes
et la tête bon dieu, nous la tête
un peu perdue pour reprendre nos deux mains
ô nous pris de gel et d’extrême lassitude
(Le damned Canuck)
Quand il est décédé en 1996, il est devenu le
premier écrivain québécois à se voir offrir des funérailles nationales. Non
qu’il fût un héros, mais parce que l’amour, l’amour de la littérature, l’amour
de la langue, l’amour du pays ont trouvé en lui un valeureux défenseur, parce
qu’il leur a consacré toute sa vie avec une générosité qui n’a que très
rarement trouvé sa pareille, du moins chez nous.
Actualité de Miron en France
 Gaston Miron sur
Laurentiana
Gaston Miron sur
Laurentiana
Gaston Miron -
biographie
Deux sangs
L’Homme
rapaillé (étude)
À bout portant
Les débuts de
l’Hexagone (Pilon)
L'Hexagone 25
: rétrospective 1953-1978
Les Matinaux (René Char)
Pour saluer Miron (2015 : Courtepointes)
Le damned Canuck (étude)
Pour
saluer Miron (2018)
Avec toi (2019)
Compagnon des Amériques (2020)
Hommage à Miron (2021)
Sur la place publique (étude)
Balado sur Miron
Le poème liminaire (étude)

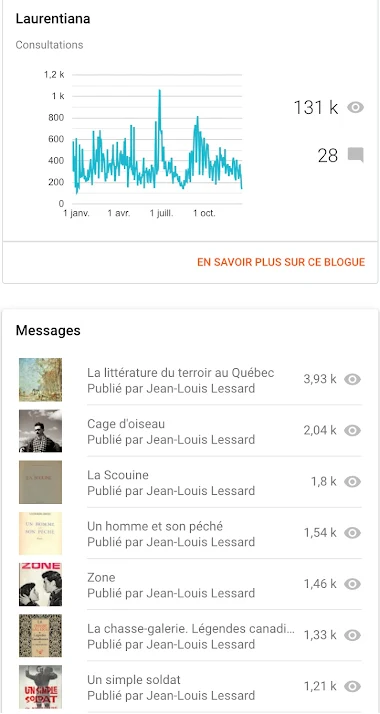









.jpeg)
.jpeg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)