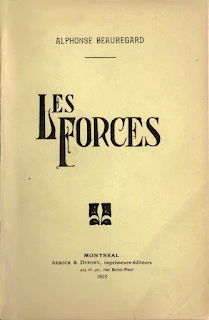Jean-Charles Harvey, L’Homme qui va, Québec, Le Soleil, 1929, 213 pages.
Le recueil compte 11 nouvelles, dont plusieurs empruntent à des genres littéraires très peu abordés au Québec : la science-fiction, le merveilleux.
L’homme qui va
Tristan Bonhomme est né idiot. Rejeté, abandonné, il devient mendiant. Un jour, il rencontre une jolie fille dont il tombe amoureux. On lui dit, pour l’éloigner, qu’elle est partie vers l’Ouest. Pendant toute sa vie, il va poursuivre cette jeune fille, croyant l’avoir enfin retrouvée dans les Rocheuses, juste avant de mourir, sous la forme d’un glacier.
Tu vivras trois cents ans
Lazare Pernelle, le célèbre médecin qui a vaincu le cancer et la tuberculose, quand il voit la mort venir, demande et obtient un sursis : pendant les 300 prochaines années, il ne vieillira plus, en d’autres mots il aura toujours 35 ans. Il voyage, vit beaucoup d’aventures amoureuses, revient chez lui et essaie de trouver un remède pour vaincre le vieillissement. Il connaît l’amour à deux cents ans, mais sa femme et ses enfants finissent par devenir des vieillards.
Isabeau
Une belle fille attire tous les hommes dans ses filets.
Au pays du rat sacré
Nous sommes en 1950. Paul Durant, un célèbre aviateur, a réussi à se rendre sur Mars. Là il découvre un monde qui adore les rats blancs. Pourtant, on lui apprend qu’autrefois, on adorait les rats gris. Un jour, un savant a déclaré qu’il existait aussi des rats blancs. On l’a ostracisé, fait taire. Le temps lui a donné raison.
Le Revenant
Le fantôme de Louis Hémon, revenu à Péribonka, rencontre sur le perron de l’église, Maria. Les deux discutent du temps qui passe, de la tradition et de la modernité.
Éros
Le narrateur rencontre Éros, qui accepte de lui montrer tous les types d’amour qui existent à travers le monde.
Radiodiffusion sanglante
Germaine et Georges doivent se marier. Germaine, qui doit soigner une maladie, va habiter quelque temps dans les Rocheuses. Elle rencontre un Américain. Elle annonce, via un téléphone audiovisuel, à Georges qu’elle va le quitter. Il se suicide à l’écran.
L’Homme rouge
Après la messe de Noël, le curé découvre un père Noël dans son église. Ce dernier lui raconte qu’il est devenu père Noël pour expier une faute, commise au temps d’Hérode. Il était parmi les soldats qui avaient massacré les Saints Innocents.
L’étoile
Kathleen Murphy rêve d’Hollywood. Elle finit par quitter La Malbaie, par réaliser son rêve, laissant derrière elle un amoureux éperdu.
Hélène au XXVe siècle
Le monde, sous la gouverne d’un parlement mondial, vit dans la paix. Pourtant, l’aspirant président accepte difficilement sa défaite, surtout que son rival lui a aussi ravi la femme qu’il aimait (la belle Hélène). Il décide de le faire assassiner et d’enlever Hélène. Il mourra des mains même de sa belle.
La dernière nuit
Suite à une période de glaciation, ne subsistent que trois êtres humains, deux hommes et une femme. L’homme rejeté tue son rival, bien inutilement, puisque les deux survivants périssent de froid.
Livre surprenant. Plusieurs récits donnent dans la science-fiction, genre très populaire dans les années 1920 aux États-Unis. Harvey s’aventure à décrire certains objets du futur. Voici sa description de la télé :
« On vient de donner la dernière main à la prodigieuse invention du radio-ciné-parlant. L'image visuelle se transmettant par les airs à l'égal des sons, on combine parfaitement, dans les appareils récepteurs d'ondes, la photographie animée et la vibration sonore. A cela s'ajoute la reproduction exacte des couleurs. Ensemble admirable, longtemps cherché, qui réalise un effort séculaire et qui, en dépassant tous les arts de l'histoire humaine, est l'une des plus belles fleurs de la civilisation.
Dans chaque maison, le drame et la comédie entrent vivants, complets et passionnants. La parole humaine, le jeu infini des teintes, le décor dans toute sa splendeur... Devant ce progrès, les vieilles pièces théâtrales, telles que représentées dans le passé, ont pâli. Le Roi Lear, n'apparaît plus dans une tempête de fer-blanc, près d'un camp de carton. Le chef-d'œuvre de Shakespeare se déroule dans le champ illimité de la nature farouche. Et la voix des interprètes, portée à mille milles de distance, répète, dans des millions de foyers à la fois, les mots poignants du génie. » (p. 170-171)
Harvey s’avère plutôt pessimiste : les hommes du futur ne semblent guère avoir appris. Il s’en prend surtout au nationalisme, à la source de bien des guerres. Sur le plan plus personnel, il n’en finit plus de décrire les « ravages » de l’amour. Et quand il endosse ce sujet, Harvey donne à chaque fois dans la mièvrerie. Les jeunes filles sont toujours des déesses qui usent de leurs charmes pour dévaster le cœur des hommes. « Kathleen Murphy possédait plusieurs qualités: un visage photogénique, un corps bien sculpté, un tempérament d'artiste et une jolie voix. Elle avait un charme incomparable, et elle le savait. Très sensible aux hommages masculins, elle s'appliquait à créer de l'amour autour de sa personne par la fascination de ses mouvements et de son sourire. Mais comme toute femme de nature privilégiée, elle ne pouvait s'attacher qu'à celui qui la dominerait toute. Aussi devait-elle semer des douleurs et des larmes dans bien des cœurs. »
Enfin, l’écriture de Harvey est souvent ampoulée, maniérée, entre autres dans les dialogues. Avez-vous déjà entendu quelqu’un parler ainsi ? « L'enfant blond me regardait électriquement, et mon épiderme frissonnait sous la caresse ardente de ses yeux glauques.
—Éros! Éros! lui dis-je, détourne de moi ton beau visage! Tu me fais peur. Cent fois tu m'as frappé et cent fois je suis tombé dans la tristesse. Sous tes coups, je me sentais brûler comme une torche. Sur cette braise qui parcourait tout mon être, tu jetais le vin de l'amour au bord des lèvres trompeuses que tu m'offrais. Mais à peine ma bouche était-elle libérée d'une étreinte qu'elle en cherchait une autre. Et toujours le tison du désir inextinguible cheminait dans mes veines.
Le petit dieu sourit dans la lumière mourante du jour. Blessé par le soir, le soleil saignait sur les vertèbres du nuageux horizon, et l'Amour, drapé d'un ample rayon pourpre, vêtu de crépuscule, étala sous mes yeux les secrets de son génie. » (p. 109)
Le recueil compte 11 nouvelles, dont plusieurs empruntent à des genres littéraires très peu abordés au Québec : la science-fiction, le merveilleux.
L’homme qui va
Tristan Bonhomme est né idiot. Rejeté, abandonné, il devient mendiant. Un jour, il rencontre une jolie fille dont il tombe amoureux. On lui dit, pour l’éloigner, qu’elle est partie vers l’Ouest. Pendant toute sa vie, il va poursuivre cette jeune fille, croyant l’avoir enfin retrouvée dans les Rocheuses, juste avant de mourir, sous la forme d’un glacier.
Tu vivras trois cents ans
Lazare Pernelle, le célèbre médecin qui a vaincu le cancer et la tuberculose, quand il voit la mort venir, demande et obtient un sursis : pendant les 300 prochaines années, il ne vieillira plus, en d’autres mots il aura toujours 35 ans. Il voyage, vit beaucoup d’aventures amoureuses, revient chez lui et essaie de trouver un remède pour vaincre le vieillissement. Il connaît l’amour à deux cents ans, mais sa femme et ses enfants finissent par devenir des vieillards.
Isabeau
Une belle fille attire tous les hommes dans ses filets.
Au pays du rat sacré
Nous sommes en 1950. Paul Durant, un célèbre aviateur, a réussi à se rendre sur Mars. Là il découvre un monde qui adore les rats blancs. Pourtant, on lui apprend qu’autrefois, on adorait les rats gris. Un jour, un savant a déclaré qu’il existait aussi des rats blancs. On l’a ostracisé, fait taire. Le temps lui a donné raison.
Le Revenant
Le fantôme de Louis Hémon, revenu à Péribonka, rencontre sur le perron de l’église, Maria. Les deux discutent du temps qui passe, de la tradition et de la modernité.
Éros
Le narrateur rencontre Éros, qui accepte de lui montrer tous les types d’amour qui existent à travers le monde.
Radiodiffusion sanglante
Germaine et Georges doivent se marier. Germaine, qui doit soigner une maladie, va habiter quelque temps dans les Rocheuses. Elle rencontre un Américain. Elle annonce, via un téléphone audiovisuel, à Georges qu’elle va le quitter. Il se suicide à l’écran.
L’Homme rouge

Après la messe de Noël, le curé découvre un père Noël dans son église. Ce dernier lui raconte qu’il est devenu père Noël pour expier une faute, commise au temps d’Hérode. Il était parmi les soldats qui avaient massacré les Saints Innocents.
L’étoile
Kathleen Murphy rêve d’Hollywood. Elle finit par quitter La Malbaie, par réaliser son rêve, laissant derrière elle un amoureux éperdu.
Hélène au XXVe siècle
Le monde, sous la gouverne d’un parlement mondial, vit dans la paix. Pourtant, l’aspirant président accepte difficilement sa défaite, surtout que son rival lui a aussi ravi la femme qu’il aimait (la belle Hélène). Il décide de le faire assassiner et d’enlever Hélène. Il mourra des mains même de sa belle.
La dernière nuit
Suite à une période de glaciation, ne subsistent que trois êtres humains, deux hommes et une femme. L’homme rejeté tue son rival, bien inutilement, puisque les deux survivants périssent de froid.
Livre surprenant. Plusieurs récits donnent dans la science-fiction, genre très populaire dans les années 1920 aux États-Unis. Harvey s’aventure à décrire certains objets du futur. Voici sa description de la télé :
« On vient de donner la dernière main à la prodigieuse invention du radio-ciné-parlant. L'image visuelle se transmettant par les airs à l'égal des sons, on combine parfaitement, dans les appareils récepteurs d'ondes, la photographie animée et la vibration sonore. A cela s'ajoute la reproduction exacte des couleurs. Ensemble admirable, longtemps cherché, qui réalise un effort séculaire et qui, en dépassant tous les arts de l'histoire humaine, est l'une des plus belles fleurs de la civilisation.
Dans chaque maison, le drame et la comédie entrent vivants, complets et passionnants. La parole humaine, le jeu infini des teintes, le décor dans toute sa splendeur... Devant ce progrès, les vieilles pièces théâtrales, telles que représentées dans le passé, ont pâli. Le Roi Lear, n'apparaît plus dans une tempête de fer-blanc, près d'un camp de carton. Le chef-d'œuvre de Shakespeare se déroule dans le champ illimité de la nature farouche. Et la voix des interprètes, portée à mille milles de distance, répète, dans des millions de foyers à la fois, les mots poignants du génie. » (p. 170-171)
Harvey s’avère plutôt pessimiste : les hommes du futur ne semblent guère avoir appris. Il s’en prend surtout au nationalisme, à la source de bien des guerres. Sur le plan plus personnel, il n’en finit plus de décrire les « ravages » de l’amour. Et quand il endosse ce sujet, Harvey donne à chaque fois dans la mièvrerie. Les jeunes filles sont toujours des déesses qui usent de leurs charmes pour dévaster le cœur des hommes. « Kathleen Murphy possédait plusieurs qualités: un visage photogénique, un corps bien sculpté, un tempérament d'artiste et une jolie voix. Elle avait un charme incomparable, et elle le savait. Très sensible aux hommages masculins, elle s'appliquait à créer de l'amour autour de sa personne par la fascination de ses mouvements et de son sourire. Mais comme toute femme de nature privilégiée, elle ne pouvait s'attacher qu'à celui qui la dominerait toute. Aussi devait-elle semer des douleurs et des larmes dans bien des cœurs. »
Enfin, l’écriture de Harvey est souvent ampoulée, maniérée, entre autres dans les dialogues. Avez-vous déjà entendu quelqu’un parler ainsi ? « L'enfant blond me regardait électriquement, et mon épiderme frissonnait sous la caresse ardente de ses yeux glauques.
—Éros! Éros! lui dis-je, détourne de moi ton beau visage! Tu me fais peur. Cent fois tu m'as frappé et cent fois je suis tombé dans la tristesse. Sous tes coups, je me sentais brûler comme une torche. Sur cette braise qui parcourait tout mon être, tu jetais le vin de l'amour au bord des lèvres trompeuses que tu m'offrais. Mais à peine ma bouche était-elle libérée d'une étreinte qu'elle en cherchait une autre. Et toujours le tison du désir inextinguible cheminait dans mes veines.
Le petit dieu sourit dans la lumière mourante du jour. Blessé par le soir, le soleil saignait sur les vertèbres du nuageux horizon, et l'Amour, drapé d'un ample rayon pourpre, vêtu de crépuscule, étala sous mes yeux les secrets de son génie. » (p. 109)