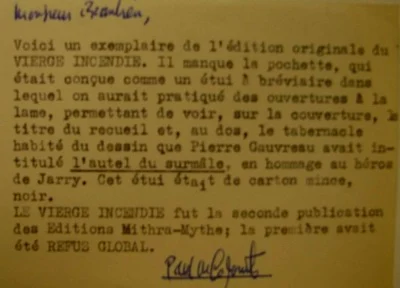Alphonse Thomas, Gustave ou un héros canadien, Montréal, Librairie Beauchemin, 1908, 376 pages. (3e édition revue et corrigée) (1re édition : 1882)
Alphonse Thomas, Gustave ou un héros canadien, Montréal, Librairie Beauchemin, 1908, 376 pages. (3e édition revue et corrigée) (1re édition : 1882)Le roman est sous-titré « Roman historique et polémique ». Le projet d’Alphonse Thomas est expliqué clairement dans l’avant-propos : « Dans un pays habité par une population mixte en fait de croyances religieuses, il est bon et utile que les catholiques aient sous la main un manuel de controverse qui soit comme un arsenal où ils puissent trouver avec facilité une réponse aux arguties qui leur sont tous les jours répétées par les protestants. Mais un manuel de controverse est généralement trop sérieux et par conséquent d'une lecture peu attrayante ; il lui manque la forme dialoguée et populaire accessible à tous.
L'auteur de Gustave a cru combler une lacune et rendre service à la cause catholique en présentant sous forme de roman les questions de controverse qui surgissent le plus ordinairement et qui peuvent offrir quelque danger pour la foi. »
L’action commence à Montréal en 1854. Encore enfant, Gustave Dumont a été confié à ses grands-parents, de fervents catholiques. Son père et sa mère se sont exilés aux États-Unis et ont embrassé la religion protestante. M. Dumont, le père de Gustave, est même devenu pasteur à Burlington. Aujourd’hui, leur fils a 16 ans. Il a décidé de le rapatrier et d’entreprendre sa conversion. Mais les grands parents et les professeurs de Gustave ont prévu le coup et lui ont donné les moyens de défendre sa foi, soit un livre qui fournit des réponses à toutes les objections. Dans la suite du roman, le lecteur a droit à d’interminables discussions entre Gustave et son père ou les amis protestants de celui-ci. Tous les différends entre les catholiques et les protestants y passent : la confession, le pape, les saints, les statues, le purgatoire, l’immaculée conception…. Gustave n’en finit plus de confondre les détracteurs de sa foi.
Quelques mois passent. Ses parents déménagent à Saint-Louis, puis à Saint-Joseph, à 96 milles plus au sud, pour fonder une nouvelle secte protestante, « l’Église évangélique du Christ ». Les nouvelles convictions de M. Dumont durent peu : il rencontre des Mormons qui le convertissent. Il décide de partir au Lac-Salé (Salt Lake city). Comme sa femme, reconvertie au catholicisme, refuse de le suivre, M. Dumont l’abandonne, tout comme sa fille. Lui et son fils se rendent à Omaha, pour rejoindre une caravane de convertis mormons en route vers le grand Lac-Salé.
À partir d’ici, on délaisse les discussions religieuses; le roman devient un véritable récit d’aventures. Plusieurs événements se succèdent : la caravane vient bien près de se faire écrabouiller par un troupeau de buffles, une jeune fille est enlevée par un Autochtone, Gustave sauve la vie d’un de ses compagnons lors d’une chasse aux buffles, Gustave avec deux de ses amis s’égarent dans l’immense plaine et échappent de justesse à des loups, la caravane est attaquée par des Autochtones. Dans toutes ces aventures, Gustave, qui manie aussi bien le fusil que la Bible, se comporte en héros. La caravane arrive finalement à Lac-Salé, la Jérusalem des Mormons. La ville est belle et harmonieuse, mais Gustave a tôt fait de découvrir que les prophètes, polygames, s’en mettent plein les poches.
Le gouvernement américain impose à la communauté mormone un gouverneur. Plusieurs décident de quitter la ville sainte. M. Dumont et son fils décident de se joindre à une caravane vers le Canada. Cependant, ils s’arrêtent à Fort Larimée où M. Dumont trouve un travail rémunérateur. Le colonel du fort, ayant appris le désir de Gustave de revoir sa mère et sa sœur, lui confie une mission qui doit le mener à Saint-Louis. Comme il a promis à sa mère de lui ramener son père, il ne fait que s’enquérir de ses nouvelles sans la rencontrer. Il poursuit sa route vers Montréal pour accomplir une autre promesse, cette fois-ci à ses grands parents : les revoir lorsqu'il aura 20 ans. Pendant ce temps, dans un moment d’ennui, son père lit le livre que les enseignants ont confié à Gustave pour se défendre contre les protestants. L’illumination se fait en lui, il retrouve sa foi catholique et décide de revenir vers sa femme. Gustave, sur la route du retour, le rencontre miraculeusement à St-Louis. Les retrouvailles sont émouvantes. Tout le monde habite un temps chez M. Lewis, un ami qu’il s’était fait à leur arrivée. Celui-ci a une fille. Elle et Gustave se font les yeux doux. La famille décide de rentrer à Montréal, mais quelques mois plus tard, revient à Saint-Louis pour s’y établir. Gustave épouse Clara.
Très pénible à lire, surtout dans la première partie, à moins que vous aimiez les longues discussions sur le sexe des anges. « GUSTAVE OU UN HÉROS CANADIEN pourrait être considéré comme l'aboutissement de la campagne contre les mauvaises lectures inaugurée officiellement en 1845 par la fondation de l'Œuvre des bons livres. On voulait combattre les mauvais romans, en particulier par la rédaction d'honnêtes ouvrages. On sacrifiera à l'imaginaire pour mieux faire passer le message. Mais, avec le temps, le camouflage disparaît et le souci didactique se révèle sans pudeur. C'est Alphonse Thomas qui est allé le plus loin en ce sens en présentant sous forme de dialogue un véritable traité d'apologétique. » (DOLQ)
Extrait
— Vous prétendez donc que nous adorons la sainte Vierge ?
— Non, je ne prétends pas cela.
— Alors, nous ne rendons pas à Marie ce qui n'est dû qu'à Dieu. Nous avons pour principe que celui qui honore la mère honore le fils davantage. Si le catholique vénère Marie et lui rend hommage, c'est parce qu'elle est la mère d'un Dieu, la mère de Jésus-Christ, qui a lui-même aimé et honoré sa mère plus que nous pouvons le faire nous-mêmes. Comme lui, nous aimons à l'appeler notre mère, à l'invoquer, sachant d'avance que son Fils ne saurait rien lui refuser.
— Mais, dit madame Dumont, ceci ne démontre pas que Marie a été conçue sans péché.
— Maman, que veulent donc dire ces paroles que l'ange a prononcées, lorsqu'il vient annoncer à Marie le mystère de l'Incarnation : Je vous salue, pleine de grâce.
— Qu'est-ce que cela prouve ?
— Cela prouve que Marie n'aurait pas joui de la plénitude des grâces, si elle eût été entachée du péché originel.
— Je ne comprends pas bien, reprit madame Dumont, explique-toi mieux.
— Être pleine de grâce, maman, veut dire jouir de la plénitude de la grâce. Or, si Marie eût été entachée du péché de nos premiers parents, lors même qu'elle aurait joui de toutes les grâces, l'ange envoyé de Dieu n'aurait pu lui dire : Je vous salue, pleine de grâce. Mais afin de mieux m'expliquer, je vais vous lire les remarques suivantes que je trouve dans mon catéchisme; les voici :
Nous, catholiques, croyons que Marie est immaculée, parce que Dieu en a fait une créature toute spéciale et plus élevée que les autres. Quand il a dit au serpent : J’enverrai une femme qui t'écrasera la tête, cette seconde Ève fut créée à l'instant même. La première Ève ayant été la cause de la chute de l’homme, cette seconde devrait le relever. Marie est donc venue au monde par la volonté et la parole de Dieu. Si elle n'est apparue que plus tard, nous n'avons rien à y voir. Dieu avait ses desseins. Non, Marie, comme fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, et épouse du Saint-Esprit, dignités que Dieu seul peut conférer, dignités qui n'appartiennent qu'à elle, Marie n'a pu être coupable ou souillée d'aucune tâche du péché. Cette pensée est certainement contraire à la raison et à la foi. Nos frères séparés croient pourtant à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'incarnation de Jésus ; pourquoi leur serait-il plus difficile de croire que Marie est l'œuvre de Dieu ? Les deux œuvres sont les mêmes ; il y a parfaite liaison entre elles et on ne peut, avec raison, les séparer. (pages 56-57)
Le gouvernement américain impose à la communauté mormone un gouverneur. Plusieurs décident de quitter la ville sainte. M. Dumont et son fils décident de se joindre à une caravane vers le Canada. Cependant, ils s’arrêtent à Fort Larimée où M. Dumont trouve un travail rémunérateur. Le colonel du fort, ayant appris le désir de Gustave de revoir sa mère et sa sœur, lui confie une mission qui doit le mener à Saint-Louis. Comme il a promis à sa mère de lui ramener son père, il ne fait que s’enquérir de ses nouvelles sans la rencontrer. Il poursuit sa route vers Montréal pour accomplir une autre promesse, cette fois-ci à ses grands parents : les revoir lorsqu'il aura 20 ans. Pendant ce temps, dans un moment d’ennui, son père lit le livre que les enseignants ont confié à Gustave pour se défendre contre les protestants. L’illumination se fait en lui, il retrouve sa foi catholique et décide de revenir vers sa femme. Gustave, sur la route du retour, le rencontre miraculeusement à St-Louis. Les retrouvailles sont émouvantes. Tout le monde habite un temps chez M. Lewis, un ami qu’il s’était fait à leur arrivée. Celui-ci a une fille. Elle et Gustave se font les yeux doux. La famille décide de rentrer à Montréal, mais quelques mois plus tard, revient à Saint-Louis pour s’y établir. Gustave épouse Clara.
Très pénible à lire, surtout dans la première partie, à moins que vous aimiez les longues discussions sur le sexe des anges. « GUSTAVE OU UN HÉROS CANADIEN pourrait être considéré comme l'aboutissement de la campagne contre les mauvaises lectures inaugurée officiellement en 1845 par la fondation de l'Œuvre des bons livres. On voulait combattre les mauvais romans, en particulier par la rédaction d'honnêtes ouvrages. On sacrifiera à l'imaginaire pour mieux faire passer le message. Mais, avec le temps, le camouflage disparaît et le souci didactique se révèle sans pudeur. C'est Alphonse Thomas qui est allé le plus loin en ce sens en présentant sous forme de dialogue un véritable traité d'apologétique. » (DOLQ)
Extrait
— Vous prétendez donc que nous adorons la sainte Vierge ?
— Non, je ne prétends pas cela.
— Alors, nous ne rendons pas à Marie ce qui n'est dû qu'à Dieu. Nous avons pour principe que celui qui honore la mère honore le fils davantage. Si le catholique vénère Marie et lui rend hommage, c'est parce qu'elle est la mère d'un Dieu, la mère de Jésus-Christ, qui a lui-même aimé et honoré sa mère plus que nous pouvons le faire nous-mêmes. Comme lui, nous aimons à l'appeler notre mère, à l'invoquer, sachant d'avance que son Fils ne saurait rien lui refuser.
— Mais, dit madame Dumont, ceci ne démontre pas que Marie a été conçue sans péché.
— Maman, que veulent donc dire ces paroles que l'ange a prononcées, lorsqu'il vient annoncer à Marie le mystère de l'Incarnation : Je vous salue, pleine de grâce.
— Qu'est-ce que cela prouve ?
— Cela prouve que Marie n'aurait pas joui de la plénitude des grâces, si elle eût été entachée du péché originel.
— Je ne comprends pas bien, reprit madame Dumont, explique-toi mieux.
— Être pleine de grâce, maman, veut dire jouir de la plénitude de la grâce. Or, si Marie eût été entachée du péché de nos premiers parents, lors même qu'elle aurait joui de toutes les grâces, l'ange envoyé de Dieu n'aurait pu lui dire : Je vous salue, pleine de grâce. Mais afin de mieux m'expliquer, je vais vous lire les remarques suivantes que je trouve dans mon catéchisme; les voici :
Nous, catholiques, croyons que Marie est immaculée, parce que Dieu en a fait une créature toute spéciale et plus élevée que les autres. Quand il a dit au serpent : J’enverrai une femme qui t'écrasera la tête, cette seconde Ève fut créée à l'instant même. La première Ève ayant été la cause de la chute de l’homme, cette seconde devrait le relever. Marie est donc venue au monde par la volonté et la parole de Dieu. Si elle n'est apparue que plus tard, nous n'avons rien à y voir. Dieu avait ses desseins. Non, Marie, comme fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, et épouse du Saint-Esprit, dignités que Dieu seul peut conférer, dignités qui n'appartiennent qu'à elle, Marie n'a pu être coupable ou souillée d'aucune tâche du péché. Cette pensée est certainement contraire à la raison et à la foi. Nos frères séparés croient pourtant à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'incarnation de Jésus ; pourquoi leur serait-il plus difficile de croire que Marie est l'œuvre de Dieu ? Les deux œuvres sont les mêmes ; il y a parfaite liaison entre elles et on ne peut, avec raison, les séparer. (pages 56-57)