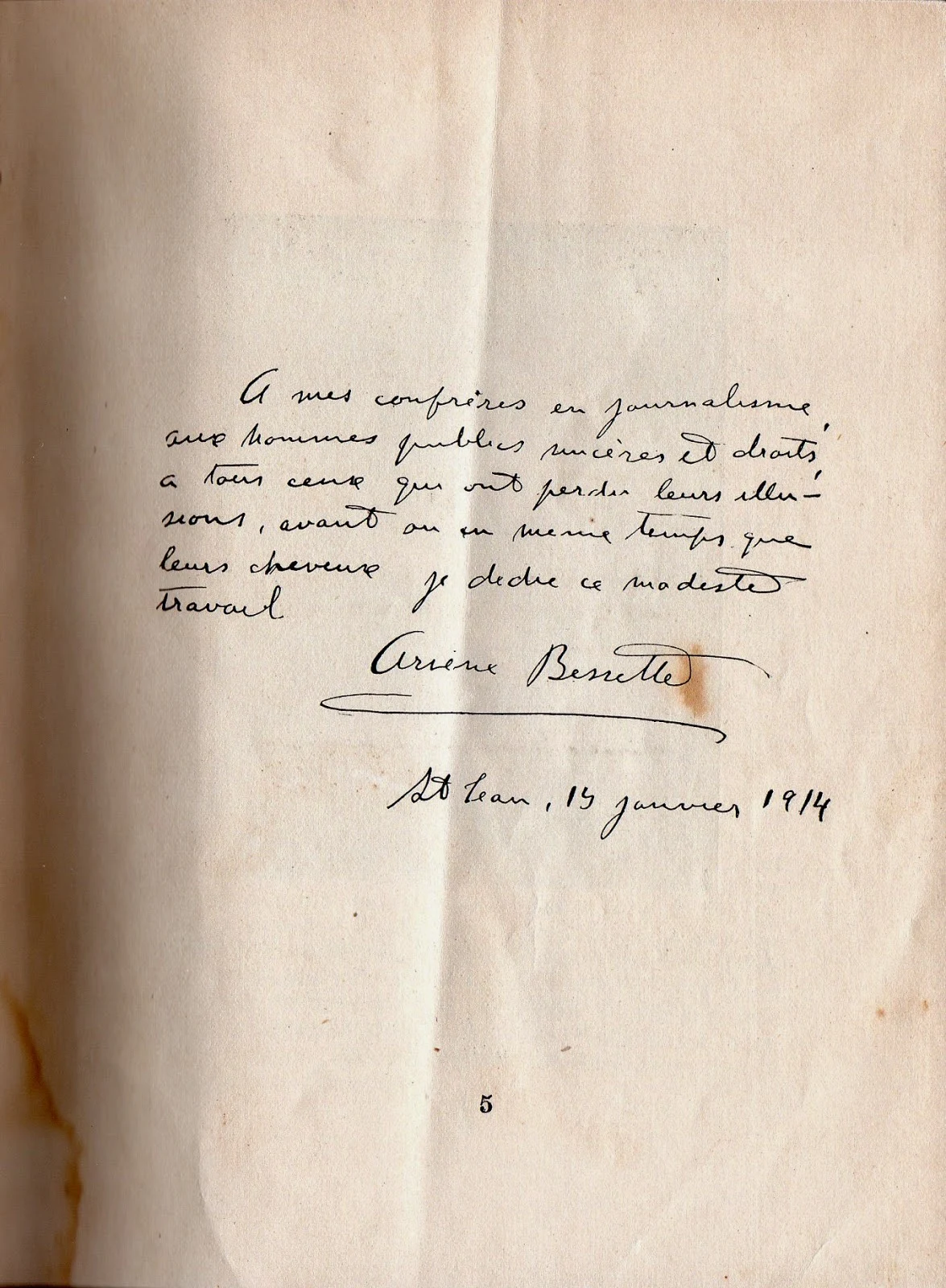Robert Élie, La Fin des songes, Montréal, Beauchemin, 1950, 256 pages.
Première partie
Bernard et Marcel, aujourd’hui dans la trentaine avancée, ont été de grands amis jusqu’à l’âge de 20 ans. Ils ont même épousé des sœurs, Nicole et Jeanne Courtois.
Marcel, journaliste, vit dans l’est de Montréal avec sa femme et ses deux enfants. Sa relation amoureuse bat de l’aile. En fait, il traverse une profonde remise en question : il n’arrive plus à se regarder dans un miroir, aux sens propre et figuré. Il a l’impression d’être un imposteur qui a abandonné tous ses idéaux de jeunesse. Bernard n’est pas très heureux non plus. À son retour de guerre, il n’a pas su recréer une vraie relation de couple avec sa femme. Plus encore, aucune profession ne semble l’intéresser. Il végète, menant sa vie en dilettante sans pour autant en tirer de grandes joies. Il est tenté par la politique, mais y renonce quand il découvre les compromissions qu’elle implique. Il finit par reprendre les riches affaires de son père.
Deuxième partie
Première partie
Bernard et Marcel, aujourd’hui dans la trentaine avancée, ont été de grands amis jusqu’à l’âge de 20 ans. Ils ont même épousé des sœurs, Nicole et Jeanne Courtois.
Marcel, journaliste, vit dans l’est de Montréal avec sa femme et ses deux enfants. Sa relation amoureuse bat de l’aile. En fait, il traverse une profonde remise en question : il n’arrive plus à se regarder dans un miroir, aux sens propre et figuré. Il a l’impression d’être un imposteur qui a abandonné tous ses idéaux de jeunesse. Bernard n’est pas très heureux non plus. À son retour de guerre, il n’a pas su recréer une vraie relation de couple avec sa femme. Plus encore, aucune profession ne semble l’intéresser. Il végète, menant sa vie en dilettante sans pour autant en tirer de grandes joies. Il est tenté par la politique, mais y renonce quand il découvre les compromissions qu’elle implique. Il finit par reprendre les riches affaires de son père.
Deuxième partie
La deuxième partie du roman est constituée du journal que Marcel a tenu entre le 5 janvier et le 19 février. Sous le couvert d’une réflexion philosophique, se cache le profond désarroi d’un homme qui a perdu contact, d’abord avec lui-même, mais aussi avec sa famille, ses amis et ses compagnons de travail. Il veut renouer avec le jeune qu’il a été, quitte à sacrifier femme et enfants. Écartelé entre le spirituel et le matériel, il se débat dans ses contradictions, désireux de conquérir la liberté, mais incapable d’abandonner certains principes qui le maintiennent dans sa vie actuelle. « Ne vaut-il pas mieux imiter ces parents qui tiennent leurs enfants bien au chaud pour que la chair soit en eux toujours plus forte que l’esprit et qu’ils se contentent du plaisir animal d’exister? » (p. 207) Il en vient à tromper sa femme avec sa belle-sœur. L’aventure est désastreuse. Il finit par se suicider.
Troisième partie
Troisième partie
Bernard est le personnage principal dans cette partie. C’est lui qui a récupéré et lu le journal de Marcel. Il se sent coupable et pourtant, ce drame va accélérer le processus d’évolution dans lequel il était lancé. Ce drame le force à sortir de sa coquille et à s’engager davantage auprès des siens : « N’était-ce pas l’amitié qui l’avait sauvé du désespoir et quelle force n’avait-il pas puisée dans cette entente soudainement établie avec Nicole, avec Jeanne et avec Louise, retrouvées au fond de cette misère? »
Robert Élie a écrit un roman qui n’est pas sans valeur. Ses personnages masculins se tiennent tout à fait. Ce n’est pas le cas des personnages féminins. L’atmosphère est sombre, pour ne pas dire lourde, tant les personnages vivent en profondeur des drames. On suit un personnage en dépression qui finit par se suicider. Faut-il y voir le drame individuel d’un névrosé? Ou plutôt accuser la société de la grande noirceur? Il est vrai que les deux personnages masculins souffrent de leur insignifiance. Cette société ne leur offre rien de très exaltant du point de vue intellectuel. Marcel est incapable de résoudre le problème. Pour lui, la solution doit passer par une recherche spirituelle. Toujours selon lui, le travail et sa famille (sa relation avec Jeanne) ont perverti ses idéaux de jeunesse. Qu’attend-il au juste de cette société? L’amour, la passion? En fait rien n’est très clair. Il se replie sur lui-même, sombre dans une profonde déréliction, se perd dans ses contradictions. Bernard, lui, refuse le jeu qu’on veut lui imposer : pendant un temps, il choisit la fuite, puis décide de se lancer dans l’action sans trop de convictions.
Ce roman représente bien l’état d’esprit d’une époque, un mélange de grande noirceur et d’existentialisme. On pense aussi à la recherche spirituelle de Saint-Denys Garneau, un ami de Robert Élie. Ceci étant dit, l’analyse est souvent trop intellectuelle et les dialogues sont parsemés de sous-entendus que le lecteur ne réussit pas toujours à saisir. ***½
 |
| Robert Élie |
Mercredi, le 18 février — Cette lamentable soirée m'a fait comprendre que je ne pourrais trouver d'appui autour de moi. Notre société est sans exigence. A aucun moment, nous n'entrons sous le feu des réflecteurs et nous arrivons à la vieillesse sans avoir jamais été au bout de nos forces. On nous a bien appris à compter nos péchés, à mesurer nos chances de survivance, mais non pas à vivre en acceptant les risques de la liberté. L'esprit dort et tout le monde est content!
Louis a raison, mais il est aussi sans passion en dépit de tous ses grands sentiments. L'heure est passée, mon ami, et tu continueras à t'agiter comme un moulin à vent qui n'a rien à moudre. Il n'y a pas eu de révélation dans ta vie et tu es une âme morte comme les autres, sans passé, sans avenir, sans religion. Personne ne se sauvera s'il ne se convertit, et peu importent le ciel et l'enfer, mais sur terre même on n'avancera que si un éclair vient déchirer notre nuit. Une société moins confortable ou moins avare offre des occasions de conversion et tous ces croyants et ces fous qui persistent à écrire des poèmes que personne ne lit, à faire des tableaux dont on se moque, entretiennent les feux des réflecteurs qui balaient la ville et surprennent les moins endormis. (p. 203)