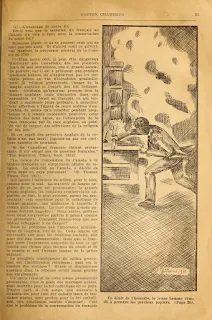Jean-François Simon (Frère Robustien), Gaston Chambrun, Montréal, Édouard Garand, 1923, 56 p. + 8 pages de publicité (Coll. « Le roman
canadien » no 6) (Illustrations de Albert Fournier, S. LeFebvre, Paul
Brousseau)
Dans sa publicité, Édouard Garand présente ainsi Gaston Chambrun : « Ce livre, qui est une réplique et un
digne pendant à l’œuvre de Alonié de Lestres [L’Appel de la race est publié un an plus tôt] soulèvera peut-être des polémiques, mais
personne ne peut nier la haute valeur littéraire de ce roman. / C’est
l’histoire d’un jeune homme qui veut rester Canadien français malgré son père,
et préfère la médiocrité de fortune à une richesse qui serait le prix d'une
alliance anglaise. »
Je vais résumer en laissant de côté beaucoup d’événements. L’action dure
5 ou 6 ans. À Winnipeg, M. de Blamon possède
une usine d’engrais chimique. Il offre au jeune Gaston Chambrun un poste de contremaître
s’il accepte de se rendre à Winnipeg. À Saint-Benoit-de-Vaudreuil, Gaston a une
petite amie, Marie-Jeanne, à laquelle il est symboliquement fiancé, ce que tout
le monde ignore sauf sa future belle-mère qui est mécontente de ces
fiançailles. Elle prétend que le père Chambrun n’acceptera pas que son fils
épouse une simple couturière, dont la mère est presque aveugle. L’avenir lui
donnera raison.
Les Chambrun sont amis avec les Richstone, une amitié vieille de deux générations.
Monsieur Richstone possède une industrie de sciage à Lachute. Il a épousé une
Canadienne française et ils ont une fille unique, Aurélia, 16 ans, qui est
vaguement amoureuse de Gaston depuis qu’il l’a sauvée d’une noyade certaine. Les Richstone et surtout M. Chambrun voient
déjà un mariage à l’horizon, ignorant les sentiments de Gaston à l’égard de
Marie-Jeanne. Mais ce dernier n’a pas l’intention de se laisser
corrompre : « Les Richstone pourraient être aussi riches qu’ils le
voudraient ; ce n’est point la dot de leur Aurélia qui ramènerait la prospérité
sous le toit des Chambrun... Non, cela ne se pouvait : trop d’obstacles
s’élevaient en barrière, infranchissable ; non, cela ne se ferait jamais.
D’ailleurs, c’était Marie-Jeanne qu’aimait Gaston et non la descendante des
oppresseurs de sa race... » La donne change lorsque Gaston apprend que son
cultivateur de père est ruiné. Ce dernier met alors beaucoup de pression – en
quelque sorte il lui impose – pour qu’il épouse Aurélia et sa dot.
Un coup de théâtre survient quand celle-ci annonce qu’elle rentre au
carmel. Surviennent deux morts : celles de la mère de Marie-Jeanne et de
la femme de M. Richstone. Ce dernier, maintenant seul, adopte Marie-Jeanne. Sa
dot de 50000$ fait tomber les objections que le père Chambrun entretenait
contre elle. Gaston revient au Québec et
épouse Marie-Jeanne.
Et, comme le lui a conseillé monsieur le curé, il y a longtemps, il
entend partager avec les siens ses connaissances et son expérience acquises à
Winnipeg. Il reprend l’usine de sciage de M. Richstone et devient gérant d’une
industrie d’engrais chimique que M. de Blamon possède à Montréal. Et là ne s’arrête
pas son implication dans la société :
« Son esprit actif et ingénieux sut mener à bien et de front ces
entreprises parallèles. Par des expériences directes faites sur ses terres,
dont lui-même dirigeait l’exploitation, il convainquit les « habitants » de la
supériorité des procédés scientifiques tels que : drainage des sols humides,
substitution de l’assolement à l’ancien système de la jachère, sélection des
semences, adaptation des engrais chimiques à la nature du sol, perfectionnement
des instruments aratoires, etc. / Secondant les tentatives du ministère de
l’agriculture, par ses soins, des conférences populaires furent organisées, des
congrès régionaux établis, les expositions agricoles multipliées, la diffusion
des revues scientifiques favorisées ; en un mot, un nouvel élan fut imprimé à
l’intelligence comme à l’initiative des populations rurales. »
J. F. Simon, tout comme Groulx, prêche contre les mariages mixtes. « Un
autre résultat de cette même promiscuité protestante, c’est la plaie des mariages
mixtes »; « Il y a une affinité héréditaire entre les âmes d’une même race. » D’ailleurs,
le mariage de M. Richstone finit par battre de l’aile.
Le nationalisme que J. F. Simon exprime dans son roman peut nous sembler
un peu tordu. Pour lui, et c’est clair, il ne faut surtout pas compter sur les
Anglais, ils vont toujours essayer de contrecarrer le développement du peuple
canadien-français, dans l’Ouest comme au Québec. Monsieur Richstone, en tant
que « partisan d’un libéralisme large, dont s’honorent grand nombre d’Anglais »
est une exception. Autrement dit, c’est un Anglais sympathique. Le hic n’est
pas là, mais plutôt dans le rôle que Simon attribue aux Canadiens français. Qui
vient à la rescousse du pauvre Canadien français qui fait faillite, qui va jusqu’à résoudre les conflits amoureux et qui sauve tout le monde,
tout compte fait ? Non ce n’est pas Monsieur le curé, cette fois-ci, mais M.
Richstone. Et quand ce n’est pas le bon papa anglais, c’est le grand-papa
français : M. de Blamon, un industriel installé à Winnipeg, tout aussi
paternaliste que Richstone. Bref, les Canadiens français, seuls, n’ont aucune
initiative, ne semblent parvenir à rien, agissent comme des serfs devant leurs
maîtres. De véritables quêteux! Pire encore, ce que mon résumé de dit pas,
c’est l’attitude de Gaston qui refuse de gravir les échelons sociaux de peur de
se salir les mains avec l’argent de la réussite. « Le nombre des déclassés
n’est que trop considérable et je préfère
demeurer dans une sphère plus humble, mieux en rapport avec mon
éducation, mes aptitudes et ma modeste
origine. » Né pour un petit pain...
Sur un autre sujet, il est clair que c’est l’industrie (voir
Robert Lozé), et non l’agriculture, qui peut permettre au
peuple canadien-français de prendre sa place et de s’imposer au plan national.
Le roman se clôt ainsi : « Puisse son exemple susciter
des imitateurs parmi les jeunes, car notre peuple sera d’autant plus redoutable
à ses adversaires, que plus nombreux se lèveront les émules de ce vaillant «
sans peur comme sans reproche ». Ce vaillant, c’est bien sûr Gaston, devenu
industriel.
C’est un roman populaire et je suppose qu’on
peut lui pardonner bien des invraisemblances, des rebondissements qui servent la thèse de l'auteur, des coups de théâtre…
et des digressions qui ne visent qu’à remplir des pages (le congrès eucharistique,
la magie de Noël, les conflits ouvriers à l’usine de M. Blamon).
Lire le roman : Gaston Chambrun Projet Québec/Canada