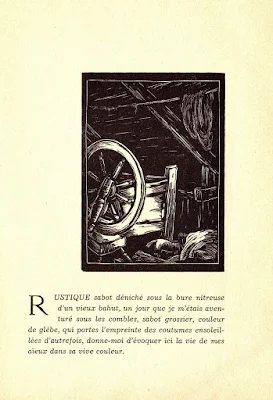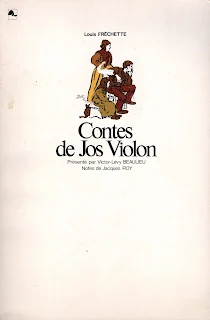Louis Fréchette, Les contes de Jos Violon, Montréal, L’Aurore, 1974, 143 p. Préface de Victor-Lévy Beaulieu. Appendice de Jacques Roy. Deux des 8 contes sont parus dans La Noël au Canada (1900), les 6 autres dans des almanachs, des revues ou journaux. Ces contes n’avaient jamais été rassemblés avant 1974. (Illustrations : Henri Julien)
Fréchette a écrit plusieurs contes. Le présent recueil en regroupe huit qui mettent en scène Jos Violon. « C'était un grand individu dégingandé, qui se balançait sur les hanches en marchant, hâbleur, ricaneur, goguenard, mais assez bonne nature au fond pour se faire pardonner ses faiblesses. » Jeune, Fréchette allait entendre Jos Violon (
Mémoires intimes). Celui-ci était un vieux voyageur originaire de Pointe-Lévis. Le célèbre conteur commençait toujours ses contes ainsi : « Cric, crac, les enfants! Parli, parlo, parlons! Pour en savoir le court et le long, passez le crachoir à Jos Violon! Sacatabi, sac-à-tabac, à la porte les ceuses qu'écouteront pas! »
Tipitte Vallerand
Tipitte Vallerand dirige une équipe de voyageurs qui remontent le Saint-Maurice. C'est un sacreur invétéré. « Je veux que le diable m’enlève tout vivant par les pieds », lance-t-il à tout propos. Tanfan Jannotte a bien voulu le faire taire, mais l’autre l’a menacé de sa carabine. Un soir, envers et contre tous, Tipitte décide d’établir le camp au Mont de l’Oiseau, bien que selon les dires, un personnage malfaisant, le Gueulard, hante les parages. Plutôt que de monter des tentes, les hommes rabattent un jeune bouleau au-dessus de leurs têtes. Pour punir ce mécréant de Tipitte, Tanfan Janotte lui attache les pieds à son insu et coupe le lien qui retient le bouleau au sol. Tipitte se retrouve se balançant au-dessus du feu. Il en perd ses cheveux. Jamais plus il ne sacra, sûr qu’il avait été puni par le Gueulard.
Titange
Titange est un maigrichon caractériel. Comme Noël approche, Titange a trouvé des « coureux de chasse galerie » pour descendre à Trois-Rivières. Le père Violon fait mine d’accepter de les accompagner. Il arrive le premier au rendez-vous et colle une image sainte sur le canot. Titange a beau proférer les paroles miraculeuses, rien n’y fait, le canot refuse de s’élever. Fou de rage, il saisit une hache, prêt à détruire le canot ; tout ce qu’il réussit, c’est à se trancher en partie le poignet.
Tom Caribou
Tom Caribou est un « toffe » et une véritable « entonnoir ». Le soir de la messe de minuit, les hommes de sa bande vont célébrer la « messe de mênuit » dans le camp voisin. Caribou refuse de les accompagner. Les hommes prévoient revenir aux petites heures le lendemain. Caribou, lui, décide de fêter à sa façon. Dieu sait comment, il a caché dans la fourche d’un grand merisier une cruche de whisky. Quand les hommes reviennent, ne le voyant pas au camp, ils se mettent à sa recherche. Voici ce qu’ils découvrent : « Tom Caribou était braqué dans la fourche d’un gros merisier, blanc comme un drap, les yeux sortis de la tête, et fisqués sur la physionomie d’une mère d’ourse qui tenait le merisier à brasse-corps, deux pieds au-dessous de lui. » Les hommes libèrent le « malvat » qui ne sera jamais plus le même par la suite.
 Coq Pomerleau
Coq Pomerleau
Coq Pomerleau, originaire de la Beauce, veut faire sa « cléricature de voyageur et son apprentissage dans l’administration de la grand’hache et du bois carré ». Il demande à Jos Violon de devenir son mentor. À l’étape de Trois-Rivières, Pomerleau se saoule et se bat avec un grand gaillard, la Grand’Tonne. Le lendemain, pour saluer son départ, celui-ci appelle la « vitupération des sacrements contre le Coq Pomerleau ». Superstitieux, le Coq est sûr que l’autre l’a ensorcelé. « Pas moyen de y aveindre autre chose de dedans le baril! » À Bytown, le Coq se saoule encore. On le jette au fond du canot et on entreprend la montée de la Gatineau. Quand il dessoule, le Coq se comporte comme s’il avait « le démon dans la corporation ». Le boss est obligé de le débarquer et Violon doit l’accompagner. Ils trouvent un vieux camp abandonné. Le lendemain, au réveil, ils découvrent avec stupéfaction que leur camp a été déplacé sur l’autre rive de la Gatineau. Les deux, se croyant ensorcelés, décident de rentrer à Bytown. En cours de route, ils réalisent que la rivière coule à l’envers. Ils finissent par rejoindre leurs compagnons au camp. Durant tout le reste de l’hiver, les deux hommes demeurent aussi désorientés. Ce fut le dernier « hivernement dans les chanquiers » de Jos Violon.
Les marionnettes
Cet hiver-là, Jos Violon et le célèbre « violoneux », Fifi Labranche, montent faire « chanquier » avec des voyageurs des Cèdres, des « vrais réprouvés ». Un soir que les hommes s’ennuient, Fifi sort son violon. On fait la fête. Quand Fifi déplore l’absence de danseurs, les voyageurs des Cèdres lui communiquent le moyen de s’en procurer. Il suffit de faire venir des marionnettes, des « espèces de lumières malfaisantes qui se montrent dans le nord ». Fifi joue le «
Money musk » et ces « fi-follets » apparaissent. Quand, quelques jours plus tard, Fifi veut jouer de nouveau, il découvre que son violon est ensorcelé. Il ne joue plus que le « Money musk ». Il faudra attendre la fin de l’hiver et un curé pour que le violon soit libéré de son sort.
Le diable des forges
Jos Violon est chargé par Bob Nesbitt de mener à bon port les 18 hommes engagés pour son « chanquier ». C’est le samedi soir et les hommes décident de fêter. Ils se rendent chez « le père Carillon, un vieux qui [tient] auberge presque en face de la grand’Forge ». Là, c’est la fête. Minuit arrive. La danse est défendue le dimanche! Mais les voyageurs, qui ne sont pas des « cheniqueux », ne s’arrêtent pas pour si peu. Seul Jos respecte la convention. Mais quand la belle « vingueuse de Célanire » l’invite à danser, il n’y tient plus. Durant la nuit, une danseuse découvre que les cheminées des Forges crachent le feu, ce qui refroidit l’assemblée qui va se coucher. Le lendemain, quand il fait le décompte des hommes, Jos découvre qu’il en manque un, oubliant sans doute de se compter. Un sort leur a été jeté, puisque plus tard dans la journée, il découvre qu’ils sont bien 18. Et ainsi de suite toute la journée. Ils rejoignent finalement le boss qui est mécontent et, lui, qui vient de trouver de l’or et qui comptait en faire profiter Violon, change d’idée.
Les lutins
Zèbe Roberge s’occupe de l’écurie, entre autres d’une belle jument que les hommes adorent et qu’ils ont baptisé Belzemire. Or, chaque lundi, lorsque Zèbe arrive à l’écurie, la jument a été brossée et nourrie. Il a l’impression qu’elle est sortie durant la nuit. Selon lui, ce sont des lutins qui lui jouent un tour. Avec Jos Violon, il décide de se cacher pour les surprendre. Quand une planche du plancher de l’écurie commence à se soulever, les deux déguerpissent. Le manège dure tout l’hiver et les deux, de crainte de froisser les lutins, évitent d’en parler. Le printemps venu, ils sont chargés de ramener les chevaux au sud. Or, cette Belzémire semble connaître le chemin comme si elle l’avait parcouru tout l’hiver. Elle s’arrête près d’une maison et une femme, l’ayant reconnue, appelle Baptiste, l’un des hommes du camp.
La hère
Jos et Zèbe travaillent à la Rivière-aux-Rats, un affluent de la Saint-Maurice. Là, dit-on, vit une bête mystérieuse que certains auraient vue mais que nul n'a décrite parce qu’« ouvrir la bouche pour en parler » attire la malchance. Au camp, avec eux, se trouve Johnny LaPicotte, un sorcier qui manigance avec le Mauvais Esprit, selon Zèbe. Un jour, il fait voir à Zèbe un lieu où l’écho répond à celui qui le questionne. Jos aura aussi l’occasion d’expérimenter la chose. Les deux décident que c’est la hère qui répond.
À l’époque, les contes de Fréchette étaient tout au plus considérés comme un appendice de son œuvre. On préférait ses envolées patriotiques. Peut-être est-il une autre raison pour expliquer cette réserve à l'égard de ses contes. Les personnages de Fréchette ne sont surtout pas ce qu’on appelle des « rongeux de ballustres ». On ne compte plus les ivrognes, les sacreurs, les caractériels, les sacrilèges, les dévergondés, les « coureux de chasse galerie », bref de « vrais réprouvés », de quoi faire dresser les cheveux sur la tête, même aux curés de campagne! Probablement pour ne pas trop heurter les croyances religieuses, Fréchette fait en sorte que les mécréants se repentent et qu’une explication rationnelle affleure. Cela saute aux yeux, il adore ces réprouvés. Cela s’entend aussi : ces contes nous convient à une véritable fête du langage populaire. Déformations de mots, inventions, anglicisme, mots du crû, archaïsmes, tout y passe! Il ne manque que les jurons! ****
Louis Fréchette sur Laurentiana
Mémoires intimes