Clément Marchand, Courriers des Villages, Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1940, 214 pages. (Illustrations de Rodolphe Duguay)
Clément Marchand nous présente une suite de nouvelles, qu’il appelle parfois des contes. En fait, certains textes sont à peine des récits. Le tout se passe à la campagne, dans un petit village, Rivière-à-la-Lime. La campagne, la vieille campagne canadienne-française, se meurt. De même le vieil héritage français, ce que l’auteur déplore.
Marchand, contrairement à la plupart des terroiristes, a une vision tragique de l’existence. Ne cherchez pas le bon paysan robuste, fort en bras et en gueule, vous ne le trouverez pas. Il n'est pas question ici de faire du pays, de transmettre l'héritage... Ses paysans sont des êtres un peu dégénérés, des simples, des rustres qui ressemblent beaucoup à leurs bêtes. En fait, les personnages les plus éclatants, ce sont justement les animaux : un verrat, un jars et un dindon. Un certain nombre de textes sont regroupés sous l’appellation : « Esquisse d’un bestiaire ».
La mort hante ces nouvelles. Et elle frappe d’abord les bêtes. Un verrat, avec « son honnête gueule de cochon », vit ses derniers moments avant d’être immolé (« La boucherie », un morceau d’anthologie!); un jars, qui « présidait avec une rare distinction de manières » à la destinée de douze oies neigeuses se fait happer par une auto (Victime du devoir); un bœuf, ex-vedette d’exposition et gloire locale, est brûlé vif (Le destin d’une gloire locale); des dindons qui font l’envie des voisins disparaissent mystérieusement (Un dindon en affaires). La mort certes, mais en même temps une compassion amusée pour ces animaux, tout à fait bêtes tout compte fait.
Il y a aussi toutes ces gens qui sont en train de mourir : « Mais hier la mort a grincé du pas sur les cailloux de la route. » Célestin a quitté sa femme qui le battait. Il revient, malade, il meurt et elle en souffre (Célestin et Adeline); un fermier perd sa femme et continue de « vieillir dans un pis aller, en attendant son tour » (Derniers rites); une femme se laisse mourir par amour (L’Ombre de la morte); une vieux fermier se jette dans le puits : « L’autre jour, dans un village non loin de chez nous, un fermier d’âge mûr s’est suicidé. » (Un suicide).
Il faut aussi noter l’omniprésence de la saison de l’automne, une nouvelle lui étant entièrement consacrée : « En automne ».
Le vol est aussi le motif de quelques nouvelles : dans « Fanfan », l’engagé part avec la cagnotte; dans « Faits divers », un voleur chipe des pommes; dans « Au relais de la Johnson », un coureur des bois se saoule et se fait rouler par ses amis de beuverie.
Dans la partie « Chansons et rites », quelques histoires valent par leur pittoresque : dans « Le ferment dans l’auge », à l’arrivée de la police, Mathurin jette sa bagosse dans l’auge des cochons qui se paient une petite saoulerie; dans « Fêtons la gamelle », un vieux paysan se repose après une journée à la cabane à sucre; dans « La montre », un homme qui voyage de nuit se fait une grosse frayeur; dans « Flambées de joie », le narrateur déplore l’abandon des rites qui présidaient aux nuits de Noël d’autrefois. D’autres textes ne sont que de pures descriptions très fines : « L’Église », « L’Orage ». Il faut dire que Marchand affectionne les régionalismes, les archaïsmes…
Enfin, il y a « Nuit sur la colline » qui clôt le recueil. On assiste à un tremblement de terre (un glissement de terrain). Je pense qu’on peut y lire le « glissement symbolique » du petit monde campagnard, même si l’auteur écrit ailleurs dans le bouquin que « les villages sont immuables ».
Marchand n’est pas Albert Laberge. Il n’a pas son regard hargneux. C’est un regard nostalgique qu’il pose sur la paysannerie qui est en train de s’écrouler. La campagne est désolante, mais la ville l'est encore plus. Il me semble que ce livre décrit bien le désarroi de cette époque de transition entre la campagne et la ville, entre les vieilles traditions françaises et la modernité américaine. ***½ ou ****
Extrait 1
Dans les villes tumultueuses où, malgré la promiscuité physique, la solitude morale de l'homme est si complète, toute la vie traquée par mille besoins, puise à un rythme effréné. Il y a des fluctuations et des séismes profonds. Les civilisations s'effritent après s'être entrechoquées comme des vagues. Les peuples se laissent asservir par les monstres qu'ils engendrent.
Seuls, inondés de lumière douce, baignant l'image de leurs pignons dans l'eau vivante d'une rivière, les villages participent à une sorte d'éternité reposante. Ils n'ont pas de passé. Ils n'ont pas non plus d'avenir. Ils s'éteignent dans le calme des soirs et la clarté blanche des aubes les voit renaître. (p. 79)
Extrait 2
Nos plus belles coutumes campagnardes, héritées des anciens, sont pour la plupart tombées en désuétude. Nos paysans troublés dans leur paix par les inventions du siècle ont peu à peu cessé de les pratiquer. Il fallait s'attendre que leur bon sens émancipé leur ferait rejeter un héritage dont l'usage quotidien des gazettes, de la radio et de l'automobile leur révélait soudain l'inutilité pratique. C'est un grand dommage car elles étaient de fécondes créatrices de joie, sachant distiller le plaisir, l'émotion et le rire sur la peau lisse de la vie rurale. Nos traditions étaient le bon mortier qui tient les maisons bien assises. On voit aujourd'hui que leur disparition a laissé un trou d'ennui et de désœuvrement dans l'existence des paysans. Le climat particulier de la campagne s'est insensiblement uniformisé à la platitude ouvrière des villes. Depuis qu'on ne s'amuse plus dans les villages, depuis qu'on a coupé les ponts avec le merveilleux, l'enthousiasme à l'œuvre sacrée de la terre a laissé place à un vague sentiment de défaitisme ou de pis-aller. Craignant le ridicule que leur vaut le titre de ruraux, les jeunes désertent. On peut observer le même phénomène de bout en bout du pays: les villes mangent les campagnes, elles pompent le sang des fermes mal gardées. (p. 203-204)
Lire dans Le Carnet du flaneur
Clément Marchand nous présente une suite de nouvelles, qu’il appelle parfois des contes. En fait, certains textes sont à peine des récits. Le tout se passe à la campagne, dans un petit village, Rivière-à-la-Lime. La campagne, la vieille campagne canadienne-française, se meurt. De même le vieil héritage français, ce que l’auteur déplore.
Marchand, contrairement à la plupart des terroiristes, a une vision tragique de l’existence. Ne cherchez pas le bon paysan robuste, fort en bras et en gueule, vous ne le trouverez pas. Il n'est pas question ici de faire du pays, de transmettre l'héritage... Ses paysans sont des êtres un peu dégénérés, des simples, des rustres qui ressemblent beaucoup à leurs bêtes. En fait, les personnages les plus éclatants, ce sont justement les animaux : un verrat, un jars et un dindon. Un certain nombre de textes sont regroupés sous l’appellation : « Esquisse d’un bestiaire ».
La mort hante ces nouvelles. Et elle frappe d’abord les bêtes. Un verrat, avec « son honnête gueule de cochon », vit ses derniers moments avant d’être immolé (« La boucherie », un morceau d’anthologie!); un jars, qui « présidait avec une rare distinction de manières » à la destinée de douze oies neigeuses se fait happer par une auto (Victime du devoir); un bœuf, ex-vedette d’exposition et gloire locale, est brûlé vif (Le destin d’une gloire locale); des dindons qui font l’envie des voisins disparaissent mystérieusement (Un dindon en affaires). La mort certes, mais en même temps une compassion amusée pour ces animaux, tout à fait bêtes tout compte fait.
Il y a aussi toutes ces gens qui sont en train de mourir : « Mais hier la mort a grincé du pas sur les cailloux de la route. » Célestin a quitté sa femme qui le battait. Il revient, malade, il meurt et elle en souffre (Célestin et Adeline); un fermier perd sa femme et continue de « vieillir dans un pis aller, en attendant son tour » (Derniers rites); une femme se laisse mourir par amour (L’Ombre de la morte); une vieux fermier se jette dans le puits : « L’autre jour, dans un village non loin de chez nous, un fermier d’âge mûr s’est suicidé. » (Un suicide).
Il faut aussi noter l’omniprésence de la saison de l’automne, une nouvelle lui étant entièrement consacrée : « En automne ».
Le vol est aussi le motif de quelques nouvelles : dans « Fanfan », l’engagé part avec la cagnotte; dans « Faits divers », un voleur chipe des pommes; dans « Au relais de la Johnson », un coureur des bois se saoule et se fait rouler par ses amis de beuverie.
Dans la partie « Chansons et rites », quelques histoires valent par leur pittoresque : dans « Le ferment dans l’auge », à l’arrivée de la police, Mathurin jette sa bagosse dans l’auge des cochons qui se paient une petite saoulerie; dans « Fêtons la gamelle », un vieux paysan se repose après une journée à la cabane à sucre; dans « La montre », un homme qui voyage de nuit se fait une grosse frayeur; dans « Flambées de joie », le narrateur déplore l’abandon des rites qui présidaient aux nuits de Noël d’autrefois. D’autres textes ne sont que de pures descriptions très fines : « L’Église », « L’Orage ». Il faut dire que Marchand affectionne les régionalismes, les archaïsmes…
Enfin, il y a « Nuit sur la colline » qui clôt le recueil. On assiste à un tremblement de terre (un glissement de terrain). Je pense qu’on peut y lire le « glissement symbolique » du petit monde campagnard, même si l’auteur écrit ailleurs dans le bouquin que « les villages sont immuables ».
Marchand n’est pas Albert Laberge. Il n’a pas son regard hargneux. C’est un regard nostalgique qu’il pose sur la paysannerie qui est en train de s’écrouler. La campagne est désolante, mais la ville l'est encore plus. Il me semble que ce livre décrit bien le désarroi de cette époque de transition entre la campagne et la ville, entre les vieilles traditions françaises et la modernité américaine. ***½ ou ****
Extrait 1
Dans les villes tumultueuses où, malgré la promiscuité physique, la solitude morale de l'homme est si complète, toute la vie traquée par mille besoins, puise à un rythme effréné. Il y a des fluctuations et des séismes profonds. Les civilisations s'effritent après s'être entrechoquées comme des vagues. Les peuples se laissent asservir par les monstres qu'ils engendrent.
Seuls, inondés de lumière douce, baignant l'image de leurs pignons dans l'eau vivante d'une rivière, les villages participent à une sorte d'éternité reposante. Ils n'ont pas de passé. Ils n'ont pas non plus d'avenir. Ils s'éteignent dans le calme des soirs et la clarté blanche des aubes les voit renaître. (p. 79)
Extrait 2
Nos plus belles coutumes campagnardes, héritées des anciens, sont pour la plupart tombées en désuétude. Nos paysans troublés dans leur paix par les inventions du siècle ont peu à peu cessé de les pratiquer. Il fallait s'attendre que leur bon sens émancipé leur ferait rejeter un héritage dont l'usage quotidien des gazettes, de la radio et de l'automobile leur révélait soudain l'inutilité pratique. C'est un grand dommage car elles étaient de fécondes créatrices de joie, sachant distiller le plaisir, l'émotion et le rire sur la peau lisse de la vie rurale. Nos traditions étaient le bon mortier qui tient les maisons bien assises. On voit aujourd'hui que leur disparition a laissé un trou d'ennui et de désœuvrement dans l'existence des paysans. Le climat particulier de la campagne s'est insensiblement uniformisé à la platitude ouvrière des villes. Depuis qu'on ne s'amuse plus dans les villages, depuis qu'on a coupé les ponts avec le merveilleux, l'enthousiasme à l'œuvre sacrée de la terre a laissé place à un vague sentiment de défaitisme ou de pis-aller. Craignant le ridicule que leur vaut le titre de ruraux, les jeunes désertent. On peut observer le même phénomène de bout en bout du pays: les villes mangent les campagnes, elles pompent le sang des fermes mal gardées. (p. 203-204)
Lire dans Le Carnet du flaneur

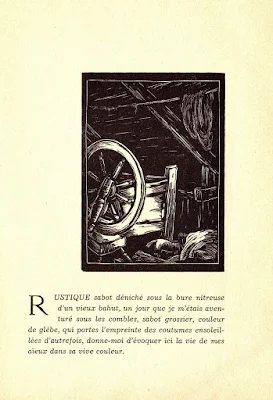



Aucun commentaire:
Publier un commentaire