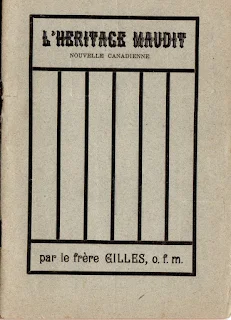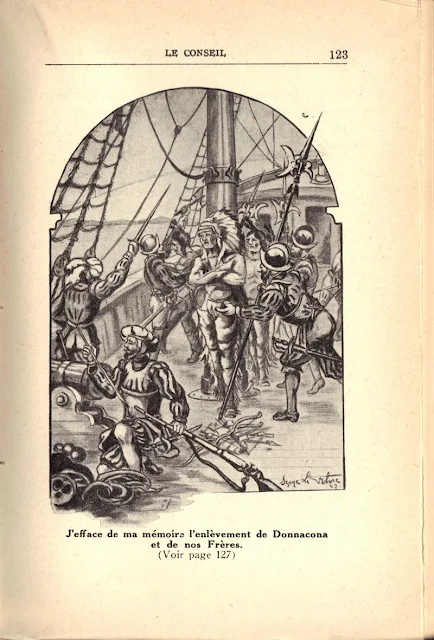Émile Lavoie, Le grand
sépulcre blanc, Montréal, Edouard Garand, 1925, 72 pages (Illustrations
d’Albert Fournier) (Coll. Le roman canadien)
Fin de juillet 1910. Le gouvernement
canadien, constatant que des bateaux américains et d’autres nations fréquentent
ses eaux territoriales du Nord, pour y chasser les baleines et commercer avec
les Inuits, décide d’envoyer une mission pour asseoir sa souveraineté sur la région.
En plus d’obliger les bateaux étrangers
à détenir un permis de pêche (voir
ce site), le rôle de la mission est de cartographier la région de la terre
de Baffin. C’est ainsi que Théodore
Maltais, un ingénieur civil, est inséré dans l’équipe en tant qu’expert
scientifique, dans ce périple qui doit
durer un an. Il doit faire des relevés géographiques, topographiques,
météorologiques. En plus, de sa propre initiative,
il va tenir un journal qui contient beaucoup d’observations sur la flore, la
faune et même sur les us et coutumes des Inuits : la religion, la sexualité,
l’hygiène, la nourriture, les vêtements, les habitations... Voilà pour l’aspect documentaire du roman,
aspect si développé qu’on n’a plus l’impression, parfois, d’être dans un roman. Le fascicule contient
quelques illustrations pour aider le lecteur à comprendre tout cela.
Pour donner un caractère
romanesque à cet ensemble qui pourrait sembler rébarbatif au lecteur de « romans
populaires » des éditions Garand, l’auteur
Émile Lavoie a imaginé plusieurs petites séquences où le danger guette notre
héros : escalade d’une montagne, rupture soudaine des glaces, rencontre de
bêtes sauvages, manque de nourriture, blessure… Mais, surtout, il a enrobé le
tout d’une histoire sentimentale entre Theodore et une Inuit du nom de Pacca,
dont le grand-père adoptif ainsi qu’un de ses oncles avaient du sang blanc dans
les veines. Ils ont participé à son éducation, ce qui explique qu’elle parle
français, qu’elle soit plus éduquée que ses congénères. Theodore en est si
follement amoureux qu’il décide de l’épouser et de passer outre aux exigences
de sa mission, malgré ses engagements. Bref, il ne veut pas rentrer au terme de
sa mission. Deux ans plus tard, ayant perdu sa femme et son fils dans un accident sur les
glaces, il rentre au pays. Il ira finir ses jours dans un monastère en Espagne.
Émile Lavoie est un scientifique.
Il est clair qu’il veut avant tout faire œuvre pédagogique dans son roman. Il
est parfois difficile de le suivre lorsqu’il écrit sur la géographie des lieux,
même s’il nous fournit une carte. Il est plus accessible lorsqu’il parle du
quotidien des Inuits. Il veut transmettre beaucoup d’informations et parfois,
les moyens employés ne sont pas tellement « romanesques ». Pendant
deux chapitres (12-13), il ne se passe à peu près rien, sinon une longue
discussion entre le héros et le chef du village qui décrit le mode de vie de sa
communauté. Les Inuits sont présentés sous un jour très sympathique. Même leurs
mœurs sexuelles et religieuses trouvent grâce aux yeux de l’auteur, ce qui est remarquable
pour l’époque. Émile Lavoie écrit bien, mais le travail d’éditeur de Garand
est, comme d’habitude, de piètre qualité : au moins 300 fautes et une
ponctuation dans les dialogues plutôt désastreuse.
Qui est Émile Lavoie?
Théodore-Émile Lavoie est né
le 17 décembre 1881 à Nouvelle
(Bonaventure). Il a épousé Germaine Leclerc, le 8 janvier 1912, à L’Islet. Émile Lavoie était l’ingénieur civil,
responsable des questions scientifiques lors de l’expédition dans l’Arctique du
capitaine J. E. Bernier, du 7 juillet 1910 au 24 septembre 1911. On trouve même
des lettres et des carnets dont il est l’auteur dans les Fonds d’archives du
célèbre navigateur (Fonds
J. E. Bernier). La question qui se pose bien entendu : jusqu’à quel
point cette histoire est-elle autobiographique, d’autant plus que l’auteur ne
s’en cache pas, puisque dans le texte il ajoute parfois des commentaires qui authentifient
certains événements ?
On trouve aussi des informations
sur Émile Lavoie dans le Fonds
de l’ordre Jacques-Cartier déposé à l’Université d’Ottawa. En 1952, en tant
que co-fondateur de l’ordre, il a eu droit à une courte biographie. En voici le
résumé :
Il a étudié au St-Joseph's College, à Watertown, chez les Pères Capucins à Ottawa et au collège de
Rimouski. Il a travaillé un temps avant de reprendre ses études en génie civil
entre 1905 et 1910. Il a suivi un « cours spécialisé en magnétisme terrestre et
en météorologie à l'Université de Toronto ».
En I9I0-I911, il a accompagné l’expédition du capitaine Bernier dans
l’Arctique. Il explore les iles Baffin, Bylot, North-Devon, Cornwallis et fait le relevé des côtes
inexplorées, ce qu’il décrit dans son roman.
Il explore aussi la côte du
Labrador, le détroit et la baie d’Hudson, la baie James et l’estuaire des rivières
Rupert et Nattaway. À son retour au pays, il devient fonctionnaire aux Travaux
publics, à Ottawa. Il va être l’un des principaux animateurs de l’ordre Jacques
Cartier, une société secrète vouée à la défense du français, fondée en 1926. En 1942, retraité, il
s’établit à L’Islet. Une station météorologique porte son nom dans le Grand
Nord.