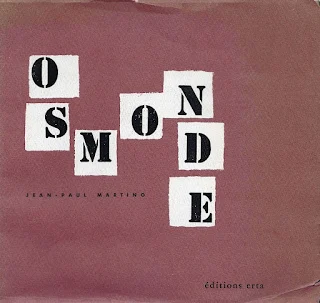Armand Roy, Têtes
fortes, Montréal, Les éditions du Totem, 1935, 193 pages.
Insatisfait d’Albert Lévesque, son éditeur et ami, Albert Pelletier
lance les éditions du Totem en 1933. Son entreprise ne durera que 5 ans
(1933-1938) et sera surtout active entre 1933 et 1936 (10 titres sur les 12 que
Totem publiera). En 1935 parait
Têtes
fortes, roman susceptible de froisser les susceptibilités frileuses, entre
autres et surtout à cause du dénouement. En tant qu’éditeur indépendant, Pelletier
entend bien tenir la dragée haute au clergé, en dépit de «
L’affaire Les demi-civilisés » survenue un an plus tôt.
Ce roman ressemble beaucoup aux
Amours d’un communiste d’Henry Deyglun publié chez Lévesque deux ans plus tôt. Dans les deux,
on lit une histoire d’amour sur fond de revendications sociopolitiques. Tout au
plus, les communistes sont remplacés par les nationalistes, un parti qui agit
aussi dans une certaine clandestinité. Si chez Deyglun, la morale était sauve,
on ne peut pas en dire autant du roman de Roy.
Louis Clément est un industriel qui possède une métairie à Saint-Bruno,
près de Saint-Pascal de Kamouraska. L’immense ferme est tenue par Thomas
Chevrier, ses trois fils et quelques ouvriers. Pour les Clément, la métairie
est surtout un lieu de villégiature.
Au retour d’Europe, Serge Clément, le fils de Louis, se rend dans la
métairie. Il est accueilli comme un enfant prodigue par la famille du métayer,
surtout par Madeleine, une jeune fille instruite qui n’a rien d’une paysanne et sa compagne de jeu quand ils étaient enfants. Madeleine l’aime en silence.
Malgré son père qui n’a que du mépris pour tout ce qui est intellectuel,
Serge devient professeur à l’Université Laval et s’engage dans le parti
nationaliste. Lors d’une réunion avec les amis bourgeois de sa famille, il
rencontre une jeune femme mariée qui lui fait la cour. Elle le poursuit de ses
avances. Cette fille finit par l’exaspérer et, du coup, il se rend compte qu’il
est amoureux de Madeleine Chevrier. Pendant tout un été, les deux jeunes
amoureux flirtent avant que Serge se décide à demander sa main.
La vie de Serge bascule du jour au lendemain à cause de son engagement politique. Un journal de droite,
d’obédience religieuse, se lance dans une campagne de salissage contre le parti
nationaliste : il associe le nationalisme au bolchévisme, à
l’anticléricalisme et le rend même responsable du meurtre de deux
fonctionnaires commis par un déséquilibré. Serge perd sa place de professeur
et, bientôt, reçoit une lettre de sa fiancée qui rompt les fiançailles, poussée
par le curé de sa paroisse qui a relayé les calomnies du journal catholique.
Complètement désabusé, Serge se jette dans les bras adultères de la femme
mariée.
Tout au long du roman, Serge fait étalage de ses « hautes valeurs
morales ». Ceci rend d’autant plus provocante la fin du roman :
« Elle passa un bras autour du coup de Serge, l’attira davantage et ferma
les paupières en posant sa bouche humide sur la sienne. Une ivresse chaude les
parcourut. Serge demeura sans force, à sa merci. »
Roy décrit les Canadiens français comme un peuple manipulé par le clergé
et les journalistes de droite. L’école et le syndicalisme ne semblent pas en
mesure de faire contrepoids. Pourquoi les « têtes fortes »? C’est le
surnom qu’on donne aux membres du parti nationaliste. Armand Roy, contrairement
à Henry Deyglun, demeure assez vague sur les idées et les intentions réelles du
parti nationaliste. Vise-t-on l’indépendance ou la sauvegarde de la langue
française dans le cadre fédéral? Disons qu’au parti nationaliste, on discute surtout
de stratégie. Bref, les idées politiques ne sont pas très intéressantes
puisqu’on se contente d’énoncer quelques grands principes. Il s’agit de
« préparer le relèvement national et la révolution sociale ».
Extrait
Ils se turent un moment. Serge prit le visage
de Madeleine dans ses mains et le couvrit de baisers. A ce moment, elle attira
son compagnon à elle, le serra très fort comme si elle eût voulu s’identifier à
lui. Mais Serge se défit doucement de son étreinte et se leva, les yeux
hagards. Tout à sa passion de jeune fille inexpérimentée, Madeleine ne comprit
pas, d’abord, le sens de ce geste brusque. Elle restait couchée sur le côté,
les cheveux et les vêtements en désordre.
—
Allons, viens. Filons, dit Serge. Elle reprit ses sens et se rendit
compte qu’elle venait d’échapper à un danger. Alors elle se leva à son tour et,
en signe de remerciements sans doute, se jeta au cou de Serge.
— Non, laisse, fit-il. Sortons d’ici au plus
tôt. De ses deux mains il écarta les branchages et, suivi de Madeleine qui
butait sur les racines, il s’engagea dans le sentier. Il pressait le pas parce
qu’il sentait que la fatalité de la nature les menaçait encore. Dans la
chevelure des arbres, les rossignols jetaient des rires per- lés. Serge n’entendit,
ne vit rien. Ils avaient franchi le bois d’un pas inégal et marchaient
maintenant à la li- sière du champ. Madeleine était bouleversée.
— Serge, mon chéri, cria-t-elle. Il ne répondit
pas. Elle courut un peu et, l’attrapant par la manche, l’arrêta:
— Pourquoi m’en veux-tu? demanda-t-elle, les
larmes dans les yeux. Alors il se calma et parla doucement:
— Pauvre petite, je ne t’en veux pas, dit-il.
Nous allions céder aux exigences de la nature. Nous sommes tous des malheureux! (Pages 136-137)