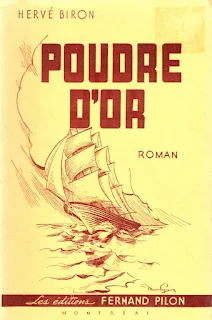1849, à Vieuxpont, village fictif près de Montréal. Lafontaine et Baldwin dirigent le Canada uni. Des troubles surviennent quand ils décident de voter une indemnité aux victimes de 1837. Le parlement est incendié.
Première partie
Le seigneur de Vieuxpont a lourdement hypothéqué sa seigneurie. Il n’en est plus que l’administrateur. Son fils Louis, un peu ulcéré de voir la noblesse canadienne pactiser avec les financiers anglais, après ses études de médecine, décide de se faire chercheur d’or. Avec plusieurs jeunes hommes, dont certains censitaires de son père, il décide de partir en Californie où, dit-on, l’or coule à flots. En plus, Il est amoureux d’une roturière, Gisèle Blouin, ce qui déplaît à sa famille qui, même ruinée, demeure tout imbue de son rang.
Le seigneur de Vieuxpont a lourdement hypothéqué sa seigneurie. Il n’en est plus que l’administrateur. Son fils Louis, un peu ulcéré de voir la noblesse canadienne pactiser avec les financiers anglais, après ses études de médecine, décide de se faire chercheur d’or. Avec plusieurs jeunes hommes, dont certains censitaires de son père, il décide de partir en Californie où, dit-on, l’or coule à flots. En plus, Il est amoureux d’une roturière, Gisèle Blouin, ce qui déplaît à sa famille qui, même ruinée, demeure tout imbue de son rang.
Le groupe gagne New York en empruntant le Richelieu, le Lac Champlain, puis un train, expérience nouvelle et exaltante (on est en 1849). Après quelques semaines d’attente, ils trouvent un navire qui doit les mener en Californie en contournant les Amériques. Le voyage doit durer six mois. Et les exilés doivent revenir dans deux ans.
Ils mettent deux mois à atteindre le cap Horn. Durant cette partie du périple, deux événements viennent rompre la monotonie du voyage (et du récit) : une violente tempête dont ils se sortent miraculeusement et un conflit entre Louis et Lucas, les deux prétendants de Gisèle. Le contournement du Cap Horn, qui prend un mois, s’avère particulièrement pénible. Dans le Pacifique, las du voyage, las de la nourriture avariée, las de l’autorité cruelle du capitaine, ils se mutinent, mais tout finit par se régler pour le mieux. Au bout de quatre mois de voyage, ils atteignent le Chili. Ils débarquent à Valparaiso une journée pour refaire leurs provisions. Deux mois plus tard, ils débarquent enfin à San Francisco.
Deuxième partie
À San Francisco, Louis retrouve son oncle Joseph. Il a trouvé de l’or, l’a joué au casino et est maintenant serveur de restaurant. Louis avec deux de ses amis et son oncle forment une petite société. Ils travaillent pour ramasser un peu d’argent pour acheter des outils et une concession ( claim ) qui se trouve à 250 milles à l’intérieur des terres. Pendant le périple, l’un de ses amis périt. L’aventure s’avère fructueuse toutefois. Deux mois plus tard, ils reviennent à San Francisco avec une petite fortune. L’oncle est chargé de la transformer en argent sonnant. Plutôt, il se rend dans un casino et perd presque la totalité. Louis est découragé. Il connaît une période très difficile, fréquentant les tripots et les femmes, gagnant tout juste d’argent pour survivre. Il tombe amoureux de la fille d’un caïd. Finalement, il finit par se reprendre en main, fonde un hôpital pour les Canadiens, gagne de l’argent. Il apprend que son père est mort, que sa fiancée vit maintenant avec sa mère. Il décide de rentrer.
À San Francisco, Louis retrouve son oncle Joseph. Il a trouvé de l’or, l’a joué au casino et est maintenant serveur de restaurant. Louis avec deux de ses amis et son oncle forment une petite société. Ils travaillent pour ramasser un peu d’argent pour acheter des outils et une concession ( claim ) qui se trouve à 250 milles à l’intérieur des terres. Pendant le périple, l’un de ses amis périt. L’aventure s’avère fructueuse toutefois. Deux mois plus tard, ils reviennent à San Francisco avec une petite fortune. L’oncle est chargé de la transformer en argent sonnant. Plutôt, il se rend dans un casino et perd presque la totalité. Louis est découragé. Il connaît une période très difficile, fréquentant les tripots et les femmes, gagnant tout juste d’argent pour survivre. Il tombe amoureux de la fille d’un caïd. Finalement, il finit par se reprendre en main, fonde un hôpital pour les Canadiens, gagne de l’argent. Il apprend que son père est mort, que sa fiancée vit maintenant avec sa mère. Il décide de rentrer.
Léo-Paul Desrosiers a déjà exploité le sujet de la ruée vers l’or de la Californie dans Nord-Sud en 1931. Madeleine Grandbois aborde aussi ce thème dans « La bague d’or », l’une des nouvelles de Maria de l’hospice. Le récit de Biron commence là où se termine celui de Desrosiers, soit au départ du Québec. Au début, on se croirait dans un roman historique, puis le tout se transforme en roman d’aventures, pour se terminer en roman agriculturiste. La fin est très décevante. On s’attend à tout sauf à un petit discours agriculturiste pour clore le récit. San Francisco est présentée comme une ville du Far west. Les curés canadiens y mènent pourtant la pluie et le beau temps. Historiquement, Biron décrit l’après Rébellion et la fin du régime seigneurial. ***
Extrait
…il rencontra Duhamel et régla ses comptes. L’Hôpital canadien rapportait des sommes considérables, et Louis avait accumulé $5,000. Il voulut en laisser une part à son associé, qui refusa. Il vendrait la bicoque et se rembourserait de ses frais. Son avoir s'arrondissait, d'ailleurs, sans cesse ; la part offerte par Vieuxpont ne l'intéressait pas.
— Qu'il est loin, le jour de notre arrivée dans ce pays à moitié civilisé, prononça Louis. En deux ans, une transformation extraordinaire, presque magique, s'est opérée dans cette ville fabuleuse. Nous sommes des pionniers. C'est pour cela que je ne quitterai peut-être jamais San Francisco.
— Je n'ai jamais pu m'acclimater complètement à cette ville. Cela ne m'a pas empêché d'en être ensorcelé. Mais je n'y ai jamais vécu de façon normale. Tantôt, une existence de dissipation jusqu'au dégoût. D'autres fois, l'abattement, la descente du courant, la dérive. Pour moi, impossible de trouver autre chose à San Francisco.
— Il faut être pétri d'esprit d'aventure comme moi pour y faire son bonheur. Un jour, je risquerai peut-être tout mon avoir au jeu, et le lendemain je reprendrai mon violon et je ferai danser la clientèle des cafés. J'ai en moi le sang de tous les grands aventuriers. Les voyageurs canadiens partaient au début de la saison, erraient dans les bois durant tout l'hiver, recueillaient des milliers de peaux de castor, accumulaient une fortune, et le printemps ils revenaient vers le cœur de la Nouvelle-France.
Souvent, lorsqu'ils atteignaient les rapides de Lachine, leurs canots chaviraient et ils perdaient le fruit de tous leurs efforts, de tous les risques et de toutes les souffrances qu'ils avaient endurés. Ils recommençaient en neuf. L'épreuve ne les plongeait pas dans le désespoir. Ils passaient l'été à recueillir l'argent nécessaire à un nouveau gréement et ils Repartaient au début de l'automne.
— L'aventure seule leur suffisait.
— De même pour, nos bûcherons.
— Moi, j'ai perdu une partie de cet esprit, dit Louis lentement. Ma famille possède déjà une tradition agricole. Je me croyais fait pour l'aventure, mais j'ai appris à mes dépens que c'est la paix et la tranquillité qui me conviennent réellement.
— C'est ce que tu as choisi ?
—Impossible de compter sur autre chose. Je retourne au pays et je m'installe sur une terre.
— La seigneurie ?
— Je la laisse aller. Maintenant que le père est décédé, cela n'a plus sa raison d'être. D'abord, je n'ai pas assez d'argent pour acquitter la dette. Que le bonhomme Grant la reprenne. C'est déjà périmé. Le gouvernement va abolir bientôt le régime seigneurial. Avec l'argent qui va me rester, j'achèterai une ferme. Je continuerai à soigner les malades. Entre temps, je labourerai la terre et je faucherai mon grain. (p. 183-185)
Hervé Biron sur Laurentiana