Roland Giguère, Les armes blanches, Erta, 1954, s.p.
(Collection de la tête armée) (Avec six dessins de l’auteur) (Couverture d'Albert Dumouchel)
Le recueil ne compte que 11
poèmes et fait moins de 30 pages. Matériellement, il est très richement illustré,
ce qui en fait un objet recherché des collectionneurs.
Tout le recueil est construit sur
la tension aliénation-rédemption. Le poète ne réussit jamais tout à fait à
se libérer d’un monde qui l’opprime. On peut penser que c’est la société qui
est l’oppresseur.
Dans « Continuer à
vivre », Giguère décrit un monde en décrépitude dans lequel fleurit un «
cancer … invulnérable». Les hommes qui l’habitent ont été souillés
par cette pourriture et, pire encore, s’en sentent responsables :
« nous nous sentions virus / plaies béantes / pus poison plaies / mauvais
sang et plaies ». L’imaginaire leur sert d’exutoire : « et pour
continuer à vivre / dans nos solitaires et silencieuses cellules / nous
commencions d’inventer un monde / avec les formes et les couleurs / que nous
lui avions rêvés ».
Dans « Les
mots-flots », le poète évoque le pouvoir créateur du langage. Non contents
de le représenter, les mots transfigurent le réel, le déplacent, le
prolongent : « Les mots-flots viennent battre la plage blanche / où
j’écris que l’eau n’est plus l’eau / sans les lèvres qui la boivent ». Ils
peuvent aussi bien révéler la beauté qu’engendrer la faille qui jettera par
terre l’édifice : « un seul grain de sable et la mariée n’est plus à
elle / ne s’appartient plus / devient mère et se couche en souriant / comme un
verre renversé perd son eau / et les mots-flots envahissent la table / la
maison le champ / le verre se multiplie par sa brisure / et le malheur devient
transparent ».
« L’été torride »
évoque un être aliéné dans un monde desséché : « on perdait la tête à
chaque pas et l’on se retournait / pour s’apercevoir qu’elle n’était plus
là ».
« Paysage dépaysé »,
dédié à « [s]es amis peintres », et « Van Gogh » décrivent
un monde vide, déglingué, qui ne demande qu’à être remodelé : « le
paysage était à refaire » ; « la vie revenait à ses sources de miel /
sève et sang renouvelés / dans un crépitement de l’œil » Ou encore :
« Une vie de tournesols commençait ».
« Le silence aux champs » nous transporte
sur le versant de la révolte : « La raison de nos silences toujours
la même / reculait devant la force du cri ».
« À cris perdus », « Les heures
lentes » et « Les yeux du pain » évoquent encore et toujours
cette tension entre le malheur qui écrase l’individu et la résistance qui laisse
l’espoir : « le feu toujours prêt à s’ouvrir / au souvenir de la cendre
sur la feuille / au moindre geste d’allumer le regard ». Rien n’est jamais
acquis, toute conquête repose sur des assises qui peuvent s’écrouler à tout
moment : « les heures coulent dans les lignes profondes de la main /
sans s'arrêter sans rien noyer sans heurt / les heures coulent et la main
doucement se resserre / sur la gorge d'un long ruisseau / mince filet de voix
qu'il ne faut pas briser / gorge chaude / mince filet de vie qu'il ne faut pas
broyer / à tout prix / au prix de ne plus jamais dormir la nuit / au prix même
de la vie ».
« Roses et ronces » est
l’un des poèmes les plus célèbres de Giguère. La musicalité et le rythme
contribuent à sa beauté. Les mots « roses, ronces et rosaces »,
assemblés de différentes façons, reviennent comme un leitmotiv. Au-delà du
matériau sonore, on y retrouve encore cette alternance d’images qui évoquent
tantôt la sérénité tantôt la catastrophe : « la douceur envolée n’a
laissé derrière elle / qu’un long ruban déchiré ». Le monde a perdu ses
points d’ancrage : « le cœur bat comme une porte / que plus rien ne
retient dans ses gonds » Et dans ce poème, cet équilibre si tenu bascule
dans la noirceur : « rosace les roses les roses et les ronces / il y avait
sur cette terre tant de choses fragiles / tant de choses qu'il ne fallait pas
briser / pour y croire et pour y boire / fontaine aussi pure aussi claire que
l'eau / fontaine maintenant si noire que l'eau est absente »
Le dernier poème, intitulé
prosaïquement « L’effort humain », m’apparaît comme un
épilogue : une dernière fois, Giguère évoque un monde en ruine, dont il fallait
se libérer. Pourtant, la conquête demeure bien modeste, le tout ne tient qu’à
« un cerceau retrouvé ».
Les Armes blanches, publié en 1953, est l’un des beaux recueils de la
poésie québécoise. Il faut se rappeler que les éditions de l’Hexagone seront
fondées en cette même année 1953. Quand on met ces deux événements en
parallèle, on ne peut qu’admirer le travail de Giguère. On peut dire sans se
tromper que tout un pan de la collection « Les Matinaux »
s’inscrit dans la continuité du travail de Giguère. On parle ici aussi bien de la
thématique que de la fabrication artisanale des recueils.
Lire « Roses
et ronces »
Lire « Les
mots-flots »
Sur les éditions ERTA
La collection « La tête armée »
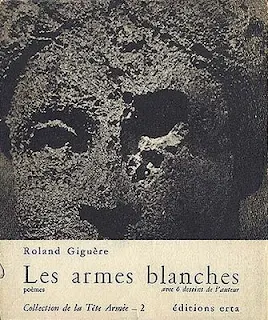


Aucun commentaire:
Publier un commentaire