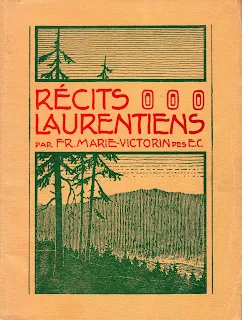André Giroux, Au-delà des visages, Montréal, Variétés, 1948, 173 pages.
Dans un hôtel, un jeune homme de bonne famille, Jacques Langlet, 23 ans, a tué une fille avec laquelle il avait une liaison (une prostituée?). Toute l’histoire se déroule dans les quelques jours qui suivent le crime. Le lecteur ne sera jamais « en présence » du meurtrier. Il ne connaîtra pas les faits précis, ni les mobiles de Langlet. Ce qu’il lit, ce sont les diverses interprétations de son acte, les tentatives de cerner le personnage et la rumeur urbaine que suscite ce crime.
Au-delà des visages est un roman de mœurs. Le crime est le prétexte trouvé pour jeter un éclairage sur la société bourgeoise de l’après-guerre. C’est un roman moderne, de facture polyphonique. Chaque chapitre, constitué du témoignage d’un personnage, éclaire quelque peu la personnalité ou un aspect de la vie de Langlet : ses confrères fonctionnaires, par esprit de caste, essaient d’atténuer son geste; son ancien supérieur fait ressortir son caractère ombrageux; un confrère ne voit en lui qu’un moraliste intransigeant; Marie-Ève, qui l’aime sans retour, essaie de partager son désarroi à distance; la femme de ménage avoue qu’elle l’aime comme son fils; le bibliothécaire certifie que ce ne sont pas les mauvaises lectures (il lui a refusé Rimbaud) qui sont à l’origine du meurtre; l’ayant rencontré, son avocat s’interroge sur la responsabilité humaine et la vitalité de l’esprit du christianisme; son meilleur ami voit en lui un Grand Meaulnes incompris avide de tendresse mais emmuré dans son incapacité à communiquer, y compris avec les femmes ; son père, qui a failli commettre le même acte naguère, se culpabilise, ayant la certitude de n’avoir pas été à la hauteur; sa mère met de côté sa peine et sa honte pour redevenir l’épine dorsale de la famille en déroute; le père Brillart, son confesseur, explique que le drame de Langlet n’est pas charnel, mais spirituel : ayant cédé au péché, il aurait voulu tuer le mal… En tout, Langlet apparaît comme un jeune homme brillant, poli, intransigeant, sensible, amoureux des arts et de la nature, épris d’idéal pour ne pas dire de pureté. Un puritain en quelque sorte. Il aurait tué parce que le mal était entré en lui et l’avait éloigné de son idéal de pureté. On ignore ce qui arrivera au jeune homme, mais on peut supposer qu’il sera condamné.
« Le grand drame des humains, c’est bien leur impuissance à regarder au-delà des visages. » (142) L’auteur présente une vision décapante de l’élite québécoise. Il dénonce l’hypocrisie de cette société étriquée, avec sa religion de façade, sa propension à confondre relation sociale et relation humaine, avancement et amitié. Cette société se dit chrétienne, mais ne ressent aucune responsabilité, ni compassion pour ses semblables. Si l’un des siens commet l’irréparable, elle le rejette sans autre procès. Il faut rayer le mal. Un journal de droite saisit l’occasion pour appeler la police des mœurs et la police des liqueurs à intensifier la répression contre toute cette dépravation car « une âme impure est une terre toute prête à recevoir la graine moscovite » du communisme.
« […] à nous, journalistes catholiques et canadiens-français, échoit le rigoureux devoir de stigmatiser, avec l'humble talent que nous sommes fiers de mettre toujours au service de l'Église, le péché dont les ramifications s'étendent jusqu'au sein des classes privilégiées, plus que toutes les autres tenues de donner l'exemple.
Depuis quelques semaines, la police semble sortir de sa léthargie. Ce n'est pas trop tôt ! On a bien voulu nous dire que la campagne sans peur et sans reproche que nous poursuivons n'est pas étrangère à ce réveil des gardiens de l'ordre. Nous en rendons grâce à Dieu ! Mais il faut que cette répression du mal s'intensifie, qu'elle soit aussi vaste que notre foi ! Plusieurs arrestations ont été opérées ces derniers temps ; plusieurs bouges ont été vidés de leur marchandise humaine et de leur clientèle infâme. Cela est très bien, mais ce n'est pas assez ! Car nous savons que les vrais coupables sont encore en liberté et qu'ils déambulent, d'une façon éhontée, dans certains salons du quartier le plus riche de notre ville. C'est un scandale pour les honnêtes gens ! Que la police frappe, et qu'elle frappe fort ! On dit que la justice a le bras long : qu'elle le prouve, c'est le temps ! Qu'elle ne craigne pas de mettre la main au collet de bandits en smoking. Et nous espérons que nos policiers n'auront pas à lutter, dans l'exercice de leurs fonctions, contre certaines puissances occultes. Nous n'en disons pas plus long pour le moment. Nous espérons être compris ! Nous nous excusons d'une certaine violence qui transpire sans doute dans ces lignes. Nous ne pouvons en réprimer les sursauts. » (p. 47-49)
Sur le plan moral, Giroux aborde les difficiles relations entre la chair et l’esprit, la solitude qui en résulte chez un être idéaliste comme Langlet. Le péché, c’est la chair. Seul l’esprit peut contenir l’appel de la chair. On voit où peut mener une société qui fait du désir physique un péché, le plus immonde qui soit. La femme devient l’Ève du paradis perdu, la tentatrice, la fleur du mal qu’il faut détruire. Tuer la femme, c’est tuer la chair, rayer le mal. Giroux écrivait dans la mouvance des Mauriac, Bernanos et Gide qui abordèrent cette problématique si ma mémoire ne me trahit pas. On pense aussi à Joseph Day, dans Moïra de Julien Green, qui va aussi tuer une femme qui l’avait entraîné à son corps défendant dans le péché de la chair. Le roman de Green parut deux ans après celui de Giroux.
« Jacques a péché par la chair, il a tué ! Ce qui s'est passé, ce soir-là, pendant les heures où il s'enferma avec l'autre, nous pouvons l'imaginer aussi bien qu'eux. Mais si nous en frémissons, c'est sans colère, sans dégoût, en tout cas pas avec ce dégoût qui se donne des bons points. Victime de l'éternelle soif du bien et du mal, Jacques a voulu savoir. Mais tandis que les autres ne retenaient que la saveur du fruit défendu, lui, a violemment vomi cette nourriture empoisonnée. Il a su le mal, mais il n'a pas renié le bien. Plus encore, j'affirme qu'à cette minute précise où l'illusion fuyait honteusement devant l'horrible réalité, Jacques découvrit, dans une illumination soudaine, ce qu'est la pureté. Il la connut dans sa plus grande splendeur, alors qu'il l'obscurcissait dans sa chair. Et dans un déchirement affreux, il ressentit l'atroce désespoir de l'absence. L'espace d'un éclair, il entrevit un Visage qui se détournait de lui. La divine présence l'abandonnait. Il trembla dans le froid et l'obscurité du vide. Celui qui était plus lui-même que lui, n'habitait plus avec lui. Tout ce qu'il avait pu donner à un autre, le seul partage qu'il eût réussi avec une créature, c'était donc cette dérisoire imitation de la charité divine ? Ce furent à la fois cette connaissance et ce désespoir qui assaillirent l'âme de votre fils en cette minute crucifiante de sa vie. Il vit rouge, et il tua pour ôter de son regard, pour supprimer, pour anéantir à tout jamais l'instrument de cette connaissance et de ce désespoir. Le drame est là ! » (p. 165-166) ****
Dans un hôtel, un jeune homme de bonne famille, Jacques Langlet, 23 ans, a tué une fille avec laquelle il avait une liaison (une prostituée?). Toute l’histoire se déroule dans les quelques jours qui suivent le crime. Le lecteur ne sera jamais « en présence » du meurtrier. Il ne connaîtra pas les faits précis, ni les mobiles de Langlet. Ce qu’il lit, ce sont les diverses interprétations de son acte, les tentatives de cerner le personnage et la rumeur urbaine que suscite ce crime.
Au-delà des visages est un roman de mœurs. Le crime est le prétexte trouvé pour jeter un éclairage sur la société bourgeoise de l’après-guerre. C’est un roman moderne, de facture polyphonique. Chaque chapitre, constitué du témoignage d’un personnage, éclaire quelque peu la personnalité ou un aspect de la vie de Langlet : ses confrères fonctionnaires, par esprit de caste, essaient d’atténuer son geste; son ancien supérieur fait ressortir son caractère ombrageux; un confrère ne voit en lui qu’un moraliste intransigeant; Marie-Ève, qui l’aime sans retour, essaie de partager son désarroi à distance; la femme de ménage avoue qu’elle l’aime comme son fils; le bibliothécaire certifie que ce ne sont pas les mauvaises lectures (il lui a refusé Rimbaud) qui sont à l’origine du meurtre; l’ayant rencontré, son avocat s’interroge sur la responsabilité humaine et la vitalité de l’esprit du christianisme; son meilleur ami voit en lui un Grand Meaulnes incompris avide de tendresse mais emmuré dans son incapacité à communiquer, y compris avec les femmes ; son père, qui a failli commettre le même acte naguère, se culpabilise, ayant la certitude de n’avoir pas été à la hauteur; sa mère met de côté sa peine et sa honte pour redevenir l’épine dorsale de la famille en déroute; le père Brillart, son confesseur, explique que le drame de Langlet n’est pas charnel, mais spirituel : ayant cédé au péché, il aurait voulu tuer le mal… En tout, Langlet apparaît comme un jeune homme brillant, poli, intransigeant, sensible, amoureux des arts et de la nature, épris d’idéal pour ne pas dire de pureté. Un puritain en quelque sorte. Il aurait tué parce que le mal était entré en lui et l’avait éloigné de son idéal de pureté. On ignore ce qui arrivera au jeune homme, mais on peut supposer qu’il sera condamné.
« Le grand drame des humains, c’est bien leur impuissance à regarder au-delà des visages. » (142) L’auteur présente une vision décapante de l’élite québécoise. Il dénonce l’hypocrisie de cette société étriquée, avec sa religion de façade, sa propension à confondre relation sociale et relation humaine, avancement et amitié. Cette société se dit chrétienne, mais ne ressent aucune responsabilité, ni compassion pour ses semblables. Si l’un des siens commet l’irréparable, elle le rejette sans autre procès. Il faut rayer le mal. Un journal de droite saisit l’occasion pour appeler la police des mœurs et la police des liqueurs à intensifier la répression contre toute cette dépravation car « une âme impure est une terre toute prête à recevoir la graine moscovite » du communisme.
« […] à nous, journalistes catholiques et canadiens-français, échoit le rigoureux devoir de stigmatiser, avec l'humble talent que nous sommes fiers de mettre toujours au service de l'Église, le péché dont les ramifications s'étendent jusqu'au sein des classes privilégiées, plus que toutes les autres tenues de donner l'exemple.
Depuis quelques semaines, la police semble sortir de sa léthargie. Ce n'est pas trop tôt ! On a bien voulu nous dire que la campagne sans peur et sans reproche que nous poursuivons n'est pas étrangère à ce réveil des gardiens de l'ordre. Nous en rendons grâce à Dieu ! Mais il faut que cette répression du mal s'intensifie, qu'elle soit aussi vaste que notre foi ! Plusieurs arrestations ont été opérées ces derniers temps ; plusieurs bouges ont été vidés de leur marchandise humaine et de leur clientèle infâme. Cela est très bien, mais ce n'est pas assez ! Car nous savons que les vrais coupables sont encore en liberté et qu'ils déambulent, d'une façon éhontée, dans certains salons du quartier le plus riche de notre ville. C'est un scandale pour les honnêtes gens ! Que la police frappe, et qu'elle frappe fort ! On dit que la justice a le bras long : qu'elle le prouve, c'est le temps ! Qu'elle ne craigne pas de mettre la main au collet de bandits en smoking. Et nous espérons que nos policiers n'auront pas à lutter, dans l'exercice de leurs fonctions, contre certaines puissances occultes. Nous n'en disons pas plus long pour le moment. Nous espérons être compris ! Nous nous excusons d'une certaine violence qui transpire sans doute dans ces lignes. Nous ne pouvons en réprimer les sursauts. » (p. 47-49)
Sur le plan moral, Giroux aborde les difficiles relations entre la chair et l’esprit, la solitude qui en résulte chez un être idéaliste comme Langlet. Le péché, c’est la chair. Seul l’esprit peut contenir l’appel de la chair. On voit où peut mener une société qui fait du désir physique un péché, le plus immonde qui soit. La femme devient l’Ève du paradis perdu, la tentatrice, la fleur du mal qu’il faut détruire. Tuer la femme, c’est tuer la chair, rayer le mal. Giroux écrivait dans la mouvance des Mauriac, Bernanos et Gide qui abordèrent cette problématique si ma mémoire ne me trahit pas. On pense aussi à Joseph Day, dans Moïra de Julien Green, qui va aussi tuer une femme qui l’avait entraîné à son corps défendant dans le péché de la chair. Le roman de Green parut deux ans après celui de Giroux.
« Jacques a péché par la chair, il a tué ! Ce qui s'est passé, ce soir-là, pendant les heures où il s'enferma avec l'autre, nous pouvons l'imaginer aussi bien qu'eux. Mais si nous en frémissons, c'est sans colère, sans dégoût, en tout cas pas avec ce dégoût qui se donne des bons points. Victime de l'éternelle soif du bien et du mal, Jacques a voulu savoir. Mais tandis que les autres ne retenaient que la saveur du fruit défendu, lui, a violemment vomi cette nourriture empoisonnée. Il a su le mal, mais il n'a pas renié le bien. Plus encore, j'affirme qu'à cette minute précise où l'illusion fuyait honteusement devant l'horrible réalité, Jacques découvrit, dans une illumination soudaine, ce qu'est la pureté. Il la connut dans sa plus grande splendeur, alors qu'il l'obscurcissait dans sa chair. Et dans un déchirement affreux, il ressentit l'atroce désespoir de l'absence. L'espace d'un éclair, il entrevit un Visage qui se détournait de lui. La divine présence l'abandonnait. Il trembla dans le froid et l'obscurité du vide. Celui qui était plus lui-même que lui, n'habitait plus avec lui. Tout ce qu'il avait pu donner à un autre, le seul partage qu'il eût réussi avec une créature, c'était donc cette dérisoire imitation de la charité divine ? Ce furent à la fois cette connaissance et ce désespoir qui assaillirent l'âme de votre fils en cette minute crucifiante de sa vie. Il vit rouge, et il tua pour ôter de son regard, pour supprimer, pour anéantir à tout jamais l'instrument de cette connaissance et de ce désespoir. Le drame est là ! » (p. 165-166) ****
André Giroux sur Laurentiana
Le Gouffre a toujours soif
Au-delà des visages