Gatien Lapointe, Jour malaisé, Montréal, s. e., 1953, 93 pages.
Gatien
Lapointe n’a que 22 ans lorsqu’il publie, à compte d’auteur, Jour malaisé, recueil qu’il désavouera dans
une entrevue donnée à Donald Smith : « Ce sont là des brouillons de poèmes
que j’ai publiés trop tôt. » (L’Écrivain
devant son œuvre, 1983). Le recueil compte 64 poèmes répartis en sept
parties : Offrande, Musiques peintes, Aquarelles d'automne, Chiffons
de lumière, Étoiles mortes, Murailles du soir, Jour malaisé. Je ne suis pas sûr qu’il y avait matière pour un
découpage aussi fin. En fait tout le recueil baigne dans la même atmosphère, même
si les titres de chacune des parties peuvent laisser entrevoir une évolution.
Ce
qui dynamise l’inspiration, ce sont l’opposition entre un passé heureux et un présent
malheureux et la dualité entre le corps et l’âme. Autour de ces tensions, se déclinent
les motifs suivants : crainte du désir et de la chair, perte de l’amour,
dérive morale, culpabilité, repentir, déréliction de soi, enfance refuge…
« Offrande » ne contient que
le poème éponyme, paradoxalement écrit au passé. On a l’impression que le poète
veut tirer un trait sur son présent : « j’ai brûlé toutes les
musiques... J’ai versé tous les symboles de l’Amour... J’ai donné un grand bal
à mon âme ». L’offrande a ici davantage valeur de purification que de don. « Musiques
peintes » évoquent un amour ancien, un temps heureux désormais révolu :
« Pourquoi / Cette marche aux plaines rougies / Des anciennes étés /
pourquoi ce retour inutile / Vers d’anciennes amours ». Dans « Aquarelles d’automne », le poète
se rappelle son enfance rurale, mais aussi les « blessures du péché ».
Il cherche une voie de régénérescence : « je cherche dans le passé /
Les mains libres de l’amour // un sourire qui se rallume / Sur les fagots de
l’automne ». Dans « Chiffons
de lumière », on retrouve à peu près la même problématique : « Autrefois
tes yeux étaient purs et calmes / ... / Regarde-les aujourd’hui tes yeux / Des
lambeaux de ciel endolori ». « Étoiles
mortes » et « Murailles du
soir » évoquent la perte des repères. Ce sont surtout les croyances
religieuses qui semblent s’écrouler. Lapointe y mentionne la « ruine des dieux », les « ruines de [s]es idoles » et finit
par déclarer que « les hommes n’ont plus besoin de dieux ». Le poète
est enfermé dans un monde de clair-obscur, de nuit, où tout n’est que mensonge,
solitude, incompréhension, un monde vide dans lequel, « la raison
n’ose plus inventer / D’autre dieu ». « Jour malaisé », qui
conclut le recueil, n’ajoute rien de neuf : encore une fois, c’est l’état
de confusion d’un homme qui se retrouve devant un monde incompréhensible.
Jour malaisé est assez représentatif des
années de la grande noirceur. On s’agite dans le sombre, l’horizon semble
complètement fermé. Un sentiment d’enfermement, d’impuissance traverse le
recueil. Inutile de préciser qu’on est très loin des grands recueils que
Lapointe nous donnera dans les années
60 : Ode au Saint-Laurent, Le Premier Mot.
JOUR MALAISÉ
Au-dessus
des clairs de lune
L'aube
embrouille les mensonges
Nos
secrets d'amour
Le
feu recommence
La sarabande
des nostalgies bleues
Sans
soif l'heure chemine
Vers
l'éternel Néant
Et
le soleil ignore encore
La
chair impure des âmes
Dans
l'herbe
Un
oiseau s'étonne
Regardant
pâlir les ciels d'été
L'automne
vieux qui tend la main
Au
printemps tout confus
Devant
tant de dieux
Et
par delà le silence de la raison
J’oublie
tous mes livres d'enfant.
Un dossier
dans Québec
francais

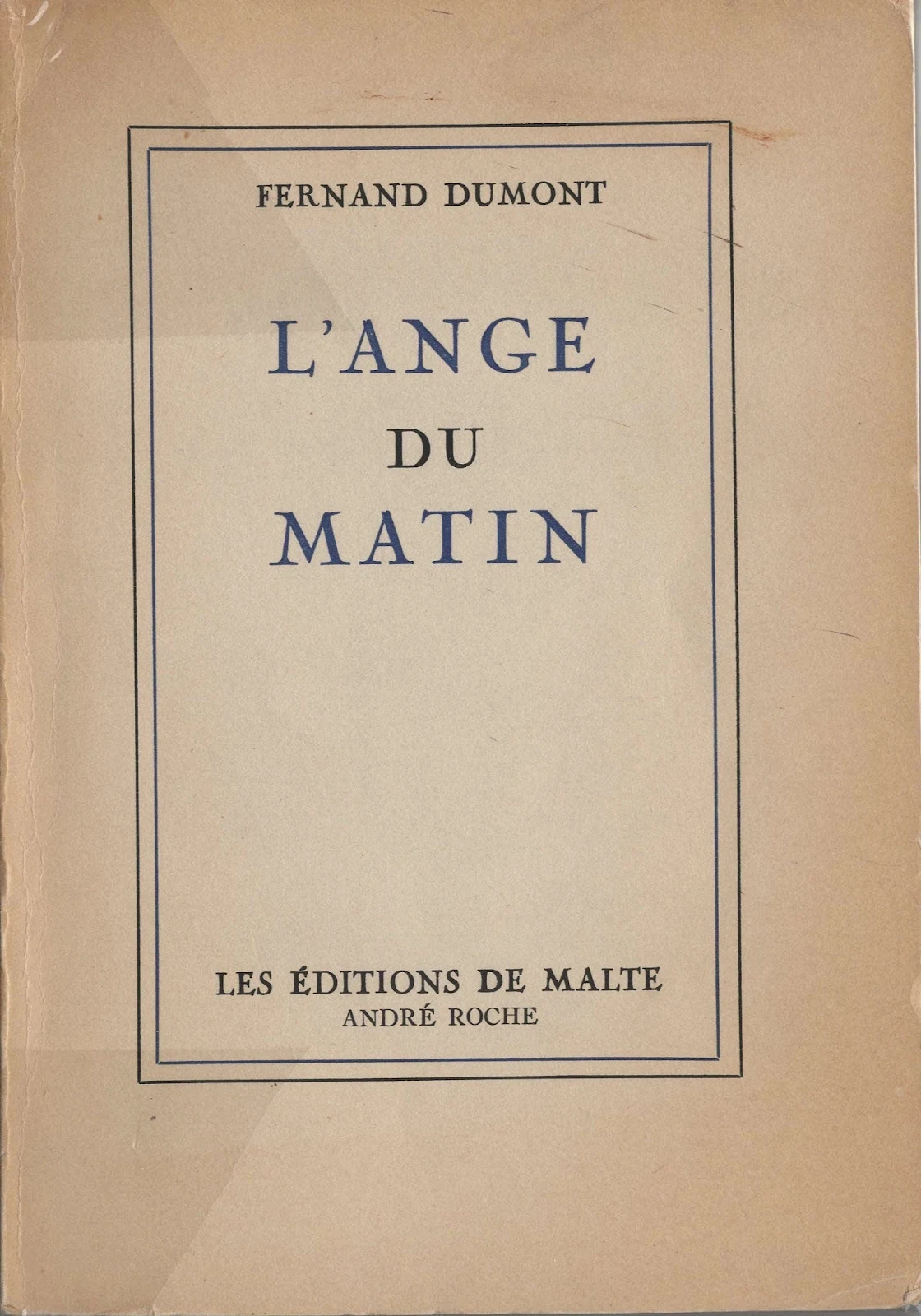





.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
