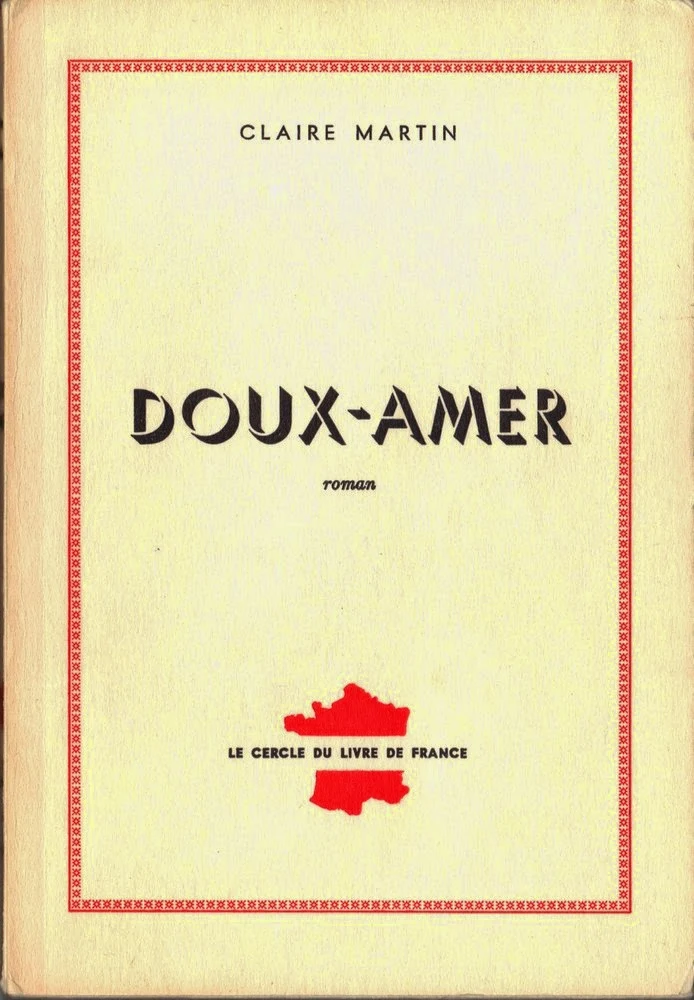Adrienne Choquette, Laure Clouet, Montréal, Institut littéraire de Québec, 1961, 135 pages. (Avec deux fusains de Sœur Sainte-Alice-de-Blois)
Depuis la mort de sa mère, Laure Clouet, une vieille fille, mène une existence étriquée en compagnie de ses deux domestiques, entre les murs clos de l'opulente demeure familiale située sur Grande-Allée à Québec. « La vieille maison aux assises encore solides se renfrognerait bientôt sous la pluie de novembre fouettant ses pierres. À l'intérieur, Marie-Laure poursuivrait ses soirées de reprisage pour l'ouvroir de la paroisse. Elle ne lèverait pas les yeux, mais peut-être n'entendait-elle pas la pluie siffler? Il semblait que nulle rumeur extérieure jamais n'aurait pu troubler le rythme de cette maison, aussi immuablement ordonnée que ses horloges à carillon. Semblable à quelque fort, la demeure de la Grande-Allée se moquait des intempéries depuis soixante ans. On y entrait comme dans un tombeau orné. La première surprise passée, une singulière impression de ne plus participer à la vie du siècle s'insinuait dans l'âme. Bientôt, les murs épais, le silence, la galerie des portraits de famille, des meubles d'un autre âge achevaient de couper toute amarre. Marie-Laure Clouet était née entre ces murs, elle avait joué aux jeux sages des enfants solitaires. Peut-être sa jeunesse avait-elle un moment frémi devant elle! Nul, en tout cas, ne le sut. » Elle continue de perpétuer une tradition familiale, celle du Mardi d’Amitié (lire l’extrait), qui consiste à inviter les vieilles amies de la famille, parce que sa mère tyrannique le lui a demandé sur son lit de mort.
Depuis la mort de sa mère, Laure Clouet, une vieille fille, mène une existence étriquée en compagnie de ses deux domestiques, entre les murs clos de l'opulente demeure familiale située sur Grande-Allée à Québec. « La vieille maison aux assises encore solides se renfrognerait bientôt sous la pluie de novembre fouettant ses pierres. À l'intérieur, Marie-Laure poursuivrait ses soirées de reprisage pour l'ouvroir de la paroisse. Elle ne lèverait pas les yeux, mais peut-être n'entendait-elle pas la pluie siffler? Il semblait que nulle rumeur extérieure jamais n'aurait pu troubler le rythme de cette maison, aussi immuablement ordonnée que ses horloges à carillon. Semblable à quelque fort, la demeure de la Grande-Allée se moquait des intempéries depuis soixante ans. On y entrait comme dans un tombeau orné. La première surprise passée, une singulière impression de ne plus participer à la vie du siècle s'insinuait dans l'âme. Bientôt, les murs épais, le silence, la galerie des portraits de famille, des meubles d'un autre âge achevaient de couper toute amarre. Marie-Laure Clouet était née entre ces murs, elle avait joué aux jeux sages des enfants solitaires. Peut-être sa jeunesse avait-elle un moment frémi devant elle! Nul, en tout cas, ne le sut. » Elle continue de perpétuer une tradition familiale, celle du Mardi d’Amitié (lire l’extrait), qui consiste à inviter les vieilles amies de la famille, parce que sa mère tyrannique le lui a demandé sur son lit de mort.
Un jour, Laure reçoit une lettre d’Annine Thiboutot, une jeune fille que sa mère a aidée il y a bien longtemps. Son mari a trouvé un travail à Québec, et elle lui demande de les héberger, le temps qu’ils se trouvent un logement. Laure n’arrive pas à se décider, surtout qu’elle craint de déroger à l’ordre établi, au caractère sacré de la tradition familiale. Finalement, après avoir écouté des conseils à droite et à gauche, elle décide qu’elle les recevra. Cette simple décision ressuscite toute une partie d’elle-même qu’elle croyait morte; elle s’interroge sur ses choix de vie, sur sa solitude de vieille fille, sur l’importance des traditions… « Elle se demanda brusquement pourquoi elle avait laissé stagner sa vie telle une eau morte. » Elle se sent prisonnière de toutes les vieilleries qu’elle conserve en l’honneur de sa famille et d’un mode de vie en train de s’éteindre, celui de la vieille bourgeoisie de la haute-ville de Québec. Elle se décrit comme la « gardienne de tombeaux vides ». Elle a 44 ans, elle n’a jamais eu d’amoureux et n’a même pas une amie. Elle n’a jamais rien fait qui ait compté pour elle ou pour les autres. Elle espère profiter, ne serait-ce que par procuration, un peu du bonheur de ce jeune couple. Elle se sent rajeunie, elle se découvre même une sensualité.
L’histoire finit un peu en queue de poisson. Laure vient consulter madame Bloies, une vieille amie de sa mère plus ouverte aux changements. Celle-ci lui a laissé ce message : « Tu as longtemps marché dans un désert. Te voici au bord d’un oasis. Ne bois pas trop vite à la source, elle te ferait plus de mal que le sable sec. » Laure voudrait que madame Boies l’éclaire davantage sur cette parabole. Malheureusement, elle arrive trop tard, sa vieille amie est morte. Et on ne saura pas jusqu’où ira l’émancipation de cette vieille fille.
C’est un récit très classique, et dans son écriture et dans sa composition. L’action est inexistante : on suit la lente évolution de Laure Clouet. Certains critiques ont voulu y voir le symbole de l’émancipation des femmes ou même du Québec.
« Le personnage de la vieille fille représente, dans l'économie patriarcale, une femme qui n'est ni "fille de" (elle est trop vieille pour être encore la fille de son père) ni "femme de" : elle est donc femme de personne. La nouvelle "Laure Clouet" d'Adrienne Choquette, présente un personnage de vieille fille qui se verra "rajeunir" par la présence d'un personnage féminin plus jeune. La remise en question de l'héritage patriarcal permet alors à la vieille fille, survivante d'un univers mortifère, de se transformer et de transformer son univers par une adhésion à des valeurs "autres". Elle passe, en quelque sorte, du mode passif au mode actif. Dans cette perspective, Laure Clouet semble représenter un Québec traditionnel prêt à s'affranchir. » (Isabelle Boisclair, Laure Clouet, femme de personne)
Il est un peu difficile de dater ce récit. Choquette décrit la ville de Québec, comme Lemelin l’a fait, avec ses petits ouvriers et ses cols-blancs miteux, avec sa haute et sa basse ville : « Peu à peu, les classes sociales reprenaient position. Cela se faisait sans heurts, comme d’un accord tacite : Saint Roch en bas, Grande-Allée en haut, et jamais si nettement qu’à l’automne les portes de la ville n’assignaient aux habitants leurs limites respectives. »
Mathilde Bruneau... Une vie passée à sauver les apparences du bonheur. La frêle créature avait tenu bon, acculée à un héroïsme quotidien dénié par le milieu même qui l'y avait jetée. Après quarante ans d'exercice, cette femme pouvait, avec sérénité, entretenir ses petits-enfants de leur grand-père "aussi bon que beau", disait-elle, en souriant sans pitié pour elle-même au portrait de l'infidèle.
Sans doute n'avait-elle pas été la seule à refouler dans le silence son cœur fier. D'autres, bien d'autres certainement, au sein d'existences apparemment comblées et douillettement inutiles, avaient connu le coup de ciseau de la souffrance et de l'humiliation. Mais la loi du milieu commandait de se taire et de figurer. À la fin de la représentation pourtant, les dernières familles bourgeoises de Québec apprenaient parfois qu'elles avaient eu tort de tant lutter puisque les générations montantes résolument acceptaient de confondre leurs intérêts et leurs plaisirs. Ultimes obstinées résistantes, quelques vieilles dames aux bijoux désuets comme leurs somptueuses demeures, assistaient dans l'impuissance à la mise à mort du rang et au coup de pied de l'âne sur les idéaux de leur génération. Et peut-être était-ce pour elles la pire épreuve que ce vacillement des cadres auxquels plus d'une avait immolé sa part légitime de bonheur.
Dans l'antique salon de leur amie morte, réunies autour du foyer pour quelques heures d'entretien un peu précieux, piqué parfois d'un irrépressible petit coup de griffe, avec des gestes d'une grâce ronde qui ponctuaient de jolies exclamations surannées, cinq vieilles dames prenaient, deux fois l'an, une revanche illusoire sur le siècle en feignant d'ignorer le bruit qu'il faisait. Mais peut-être ne feignaient-elles point. Peut-être, dans une maison qui faisait penser à un vaisseau enlisé, descendaient-elles à la rencontre de fantômes plus vivants et plus chers à leur cœur que leurs sportifs petits-fils. (p. 63-65)
Adrienne Choquette
sur Laurentiana