Réjean Ducharme, L'avalée des avalés, Paris, Gallimard, 1966, 282 pages.
Bérénice Einberg, neuf
ans au début du roman, vit dans une famille désunie : elle a le sentiment
d’être prisonnière des adultes. Elle est « l’avalée des avalés ». Son
père est juif et sa mère, catholique. « Quand
ils se sont mariés, ils se sont mis d’accord sur une sorte de division des
enfants qu’ils allaient avoir. […] D’après leurs arrangements, le premier
rejeton va aux catholiques, le deuxième aux juifs, le troisième aux
catholiques, le quatrième aux juifs, et ainsi de suite jusqu’au trente et
unième. Premier rejeton, Christian est à Mme Einberg, et Mme Einberg l’emmène à
la messe. Second et dernier rejeton, je suis à M. Einberg, et M. Einberg
m’emmène à la synagogue. Ils nous ont. Ils sont sûrs qu’ils nous ont. Ils nous
ont, ils nous gardent. »
Elle
adore sa mère, qu’elle surnomme Chat mort ou Chamomor, et encore plus son frère
Christian, de quelques années, plus âgé qu’elle. Elle est très possessive avec
les gens qu’elle aime : elle voudrait que leur amour soit exclusif. Aussi
voit-elle mal l’arrivée de Mingralie et ensuite de ses cousins polonais.
Bérénice a maintenant 11 ans et vit une profonde dépression. « Je ne suis pas malade. Je suis morte. Je ne suis plus qu’un reflet de mon âme. Je flotte, légère comme un souvenir. Je plane dans l’éther des espaces sidéraux, souverainement et définitivement indifférente. » Sa mère la veille jour et nuit. Quand elle finit par baisser sa garde et par céder à l’amour maternelle, elle est guérie : « Tout à coup, ça y est! C’en est fait de moi. Je perds la tête. Tout à coup, en moi, c’est la rupture des écluses, l’éclatement des digues et barrages. Je sais que cette femme est truquée ; je me le dis, me le répète. Mais c’est inutile. Prise d’un grand éblouissement, j'oublie tout, perds tout. Je dégringole de tous mes sommets, m’écrase. Je perds pied, déboule. Tout me glisse entre les doigts. Tout à coup, comme mue par une détente volcanique, je me retourne, me dresse, m’élance, me jette dans ses bras, me cramponne à son cou. Elle m’enlace avec force, sans rien dire. »
Aussitôt guérie, elle
reprend là où elle avait laissé. Surtout, elle force Christian à faire toutes
les folies, ce qui pousse Einberg à l’envoyer à New York chez l’oncle Zio. Son
amie Constance Chlore est avec elle. Même si son espace de liberté est réduit, elle
continue de crâner, se permettant toutes les frasques : évasion, vol à l’étalage,
non-respect du jeûne, lecture porno. Quand ses parents la visitent, elle refuse
de les voir. Son amie Constance Chlore est tuée dans un accident. Elle se fait
un copain, Ding Dong, mais lui refuse toute marque d’affection. D’une révolte
passive, elle passe à une révolte ouverte, très agressive : elle
défie Zio, ses professeurs, elle est très violente avec un de ses cousins qui
la courtise, elle se saoule, elle abandonne un spectacle de danse à l’entracte,
etc. Au bout de 5 ans, Zio finit par admettre qu’il ne réussira pas à la remettre
sur le droit chemin et la renvoie à ses parents.
J’avais déjà lu deux ou
trois fois L’avalée des avalés.
Trente ans plus tard, je crois toujours que c’est un grand roman. On connaît
tous le début d’anthologie : « Tout m’avale. Quand j'ai les yeux
fermés, c’est par mon ventre que je suis avalée, c’est dans mon ventre que
j'étouffe. Quand j’ai les yeux ouverts, c’est par ce que je vois que je suis
avalée, c’est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée
par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles,
par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage
de ma mère est beau pour rien. S’il était laid, il serait laid pour rien. Les
visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon,
une fleur, et ça nous travaille, puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça
nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visages, de papillons, de fleurs. »
Le roman se tient à
cette hauteur pendant 300 pages bien serrées. La voix et le propos sont uniques
et l’inspiration semble inépuisable. Peu de romans peuvent se targuer de présenter
ces trois éléments avec un tel brio.
On aurait tort de le réduire
à une révolte adolescente, quoique c’en soit le coeur. Il me semble qu’il faut aussi
tenir compte des prémisses sur lequel cette histoire débute : Bérénice est
née dans le monde de l’après-guerre. Ironie du sort, sa mère polonaise, dont
les frères ont collaboré avec les Nazis, a été « sauvée » par son père
juif. Elle n’avait que 13 ans quand elle
a épousé Einberg : « Tu n'étais pas si dédaigneuse quand je t’ai
trouvée, à Varsovie, dans l’égout. Tes frères, MM. les colonels, collaboraient.
Tes frères, MM. les Polonais, venaient de te violer. Je t’ai donné du chocolat.
Tu avais si faim que tu l’as mangé dans ma main. » Toute la suite découle
de cette liaison viciée à la base. La guerre hante ce récit. Ne pourrait-on pas
parler de choc post-traumatique pour expliquer la féroce guerre de couple que
se livrent les parents, ce dont les enfants sont victimes?
Observons aussi que ce
roman n’est pas ancré dans la société québécoise comme plusieurs de l’époque. Il
faut voir le caractère universel de cette histoire. On est chez un couple de
l’après-guerre, le plus souvent dans le milieu juif, et non dans une famille
québécoise traditionnelle.
« J’ai besoin de haïr.
Je hais. » L’immense souffrance qui habite Bérénice se transforme au fil
du roman en haine. Au début, elle s’exerce à la haine, son père en étant le
premier objet; à la fin, elle y est parvenue : elle n’aime plus personne. « Bérénice Einberg,
as-tu du cœur ? J’ai plein de peau mais pas de cœur, Monseigneur. Et pourquoi
donc, mon enfant ? Je ne sais pas, Monseigneur. Ça m'est venu comme Ça, petit à
petit, peu à peu, au jour le jour, tranquillement, sans que je m’en aperçoive. »
Les figures falotes de Constance Chlore devenue Exangue
et de Christian, plus imaginées que réelles, ne sont plus là pour alimenter son
besoin inassouvi d’amour. Ne reste que
la révolte haineuse : elle est prête à tuer.
Métaphore, allégories, références
à l’Antiquité, notions scientifiques, Nelligan, associations surréalistes et le
bérénicien alimentent le discours de Bérénice. Quant à moi, ce qui étonne
davantage, ce sont les passages argumentatifs qui déraillent en cours de
démonstration. L’écriture retourne sans cesse sur elle-même, pour en ajouter et en
ajouter encore. « L’autorité que Zio a sur moi ne tient à rien, il faut
bien l’avouer. Pourtant, elle tient. L’autorité des généraux sur les hommes ne
tient à rien. Pourtant, elle tient bien. J’ai pitié de Zio. Il peut si peu
contre moi, pour moi, contre les bacilles qui me rongent. »
Il faut bien le dire, le
roman risque d’écorcher la sensibilité contemporaine. Habitée par une telle
haine de l’humanité, malheureuse, cruelle et révoltée, l’héroïne prête peu attention aux autres, ne censure pas son discours sur la race, la religion,
l’orientation sexuelle, l’image corporelle, etc.
Pour aller plus loin :
La réception des manuscrits de Ducharme chez Gallimard
Pour tout savoir sur
« L’affaire Ducharme »
 |
| L’édition pirate |
.jpg)
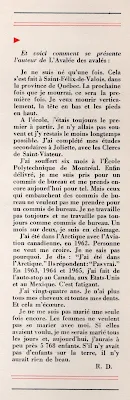
Aucun commentaire:
Publier un commentaire