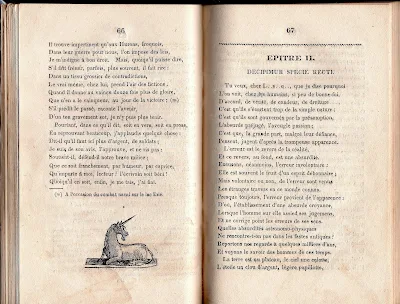Oscar Massé, Mena’sen, Québec, Typographie Dussault
& Proulx, 1922, 123 pages.
Oscar
Massé (1880-1949) propose une version originale de la légende sherbrookoise « Le rocher
au pin solitaire ». Il l'a rebaptisée de son nom
abénaquis : « Mena’sen ». (Voir Wikipedia pour la version
traditionnelle)
On
est en 1704. La France et l’Angleterre
sont en conflit (Guerre de succession
d’Espagne). Le gouverneur Vaudreuil accepte qu’on mène un raid contre
les « Bastonnais », pour solidifier la frontière. On choisit d'attaquer Deerfield, une petite ville du Massachusetts. En plein mois de février, la
troupe canadienne, qui compte plusieurs Abénakis dans ses rangs, entame sa marche en
suivant la rivière Saint-François, puis d’autres affluents et chemins empruntés par les coureurs des
bois. On surprend les habitants de Deerfield en pleine nuit et les Abénakis les
massacrent de la façon la plus ignoble. Les Canadiens, sous le commandant
d’Hertel de Rouville (1668-1722), mènent une guerre plus classique et s’emparent d’un certain nombre de prisonniers qu’ils pourront échanger éventuellement. Sur
les 112 captifs, une cinquantaine seront ramenés vivants, dont Robert Gardner
et Alice Morton. Massé nous avait présenté ces deux jeunes personnes, très sympathiques, au tout début. Les otages sont parqués sur l'Île du feu, pour ainsi dire dans la
réserve des Abénakis qui deviennent leurs gardiens. Alors que les Abénakis célèbrent
la Fête des aïeux, Gardner et Morton décident de fuir en empruntant la
Saint-François. Ils réussissent à échapper à leurs poursuivants, mais la jeune
fille, bientôt épuisée, meurt. Pour éviter que les bêtes sauvages s’emparent de son corps, Gardner l’enterre
sur un rocher qui pointe dans la Saint-François : Mena’sen. Et il plante le
petit pin, qui deviendra des centaines d’années plus tard une attraction
touristique. Quant à Robert Gardner, épuisé, il se laisse pour ainsi dire couler. Ainsi va la légende du « Rocher au pin solitaire», telle que
raconté par Oscar Massé. (Sur internet, on trouve une description, sans doute
plus véridique, de la route suivie et de la bataille de Deerfield.)
Tous
les commentateurs — et Massé lui-même — admettent que cette histoire aurait pu
être mieux racontée. L’auteur a un style très fleuri, utilise beaucoup
d’archaïsmes : « Aux branches des pins rameux où pisotent les étourneaux
pendent, en festons plus ou moins symétriques, des bandes d’escarlatine. »
Mais ce qui est problématique, c’est la structure du récit. Certains chapitres
sont consacrés à des personnages qu’on ne revoit plus par la suite. D'autres sont des essais sur les Autochtones, d’autres encore, des tableaux de la
nature ou des morceaux d’histoire. Autrement dit, les différents éléments qui
composent habituellement un récit historique sont mal liés entre eux.
Deux
remarques supplémentaires : premièrement, il n’est pas fréquent que les
héros d’un récit historique canadien-français soient des
« Américains », ce qui est le cas dans Mena'sen. Le motif des amants réunis dans la mort en fait des personnages très sympathiques. Deuxièmement, concernant les Abénakis, Massé souffle
le chaud et le froid : il souligne leur nature cruelle, revancharde mais,
en même temps, il admet que les Européens les manipulent, les détruisent. Du
même souffle, il développe toute une théorie concernant l’incompatibilité entre
la nature et la culture : « …ne dirait-on pas que c’est la
civilisation qui a, non pas transformé ou européanisé́, mais supprimé ou fait
disparaître le peau-rouge ? Il y a peut-être plus de vrai — tout paradoxal que
cela semble — que de boutade dans cette idée que la civilisation et la nature
sont incompatibles! »
Extrait
« Quelle
est cette masse informe qui saille du milieu du fleuve ? Ne dirait-on pas un
monstre aquatique, quelque tarasque tapie au fond du fleuve et dont la crête émerge
?
C’est
Mena’sen, le redoutable dieu terme que, suivant la mythologie abénaquise, il
faut, avant de passer outre, propitier par quelque sacrifice expiatoire. On
dirait, en effet, dans la plaine liquide, un dolmen qui appète une victime.
Il y
a, dans ce rocher qui troue la surface calme des eaux, quelque chose d’insolent
qui menace et défie. Mena’sen a l’air rébarbatif, méchant, sinistre. Cette
effervescence de vie qui l’entoure, ces effluves printaniers qui flottent dans
l’air l’exaspèrent. Cette exubérance est contumélie qui le nargue. Le flot
l’effleure de sa caresse mièvre sans l’émouvoir.
Il
semble émaner de Mena’sen quelque fluide mystérieux et toxique qui sature l’âme
de trémeur. L’absconse goétie du sked-8a8asino abonde en maléfices sataniques:
peut-être Mena’sen dégage-t-il, par quelque envoûtement horrible, les malédictions
de la tribu qui là-bas implore Ni8askichi de faire périr les fugitifs. (p.
111)
Mena’sen