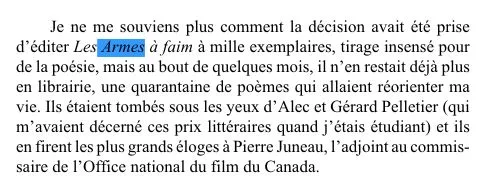Olivier Marchand, Crier que je
vis, Montréal, L’Hexagone, 1958, s.p. (Coll. Les matinaux, no
8) (Couverture de Gilles Carle)
Le cri de Marchand n’est pas un
cri de détresse ou de souffrance. Ni un cri de ralliement. C’est plutôt un appel, un signal. Parler, crier pour ne pas sombrer dans l’oubli, l’indifférencié : « Parler / parler tout haut / avec la véhémence d’un racheté / revenir à soi comme une bouée / croire à la justesse des choses ». Parler pour ne pas être avalé par le quotidien tantôt brutal tantôt asphyxiant, ne pas renoncer, s’accrocher : « Tempête sur un cœur boulonné et
récapitulé / le matin a fait sa proie de ma détresse / limpide et creuse
étincelle // berce quand même l’âme du lointain plus forte / c’est la simple
sagesse // les fleuves au bout des peuples trempent leur front ».
Plutôt qu’une quête, on pourrait
parler de conquête, car rien n’est jamais assuré.
Chaque matin, il faut recommencer, affermir ses positions, se battre contre le maussade, continuer d’y croire : « au bout du peuple lourd de ces mugissements / j’ai appliqué mon visage aux barreaux de ton âme / une résurrection un cortège un bruit blanc / ta colombe ô Seigneur comme une main de femme ». Le cri permet de projeter la voix au loin, au-delà de soi. Les cris « sont des
ponts », ponts vers l’autre, mais aussi vers l’inconnu : « ainsi
faudra marcher la planète en longueur / car le vent de courroux insurge nos
domaines / ensablant nos espoirs son souffle crie la peur / de vertu et de
force il blesse nos semaines ». C’est
aussi l’espoir que rien ne finira : « mais quand tout sera
rétabli / tout sera bâti / tout sera agrandi / il y aura une autre vie ». Camille,
l’ « enfant-mappemonde, [...] avec son regard qui cherche / son regard en route / [n'a-t-elle pas] de l’univers plein les
ailes » ?
On ne perçoit pas vraiment une ligne thématique, avec un début et une fin. La poésie de Marchand, qu’on devine très travaillée, est faite de petites touches, de retouches, de reprises, de changements d’angle. Cette poésie me semble davantage du domaine personnel que social. Crier que je vis, c’est la manifestation d’un homme qui veut signaler sa présence au monde.
Olivier Marchand
Deux sangs
Olivier Marchand
Deux sangs