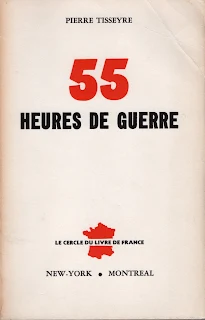Tout récit de guerre finit par se rassembler. Les batailles succèdent aux batailles et en ce, le récit de Vaillancourt se démarque seulement par le fait qu’il insiste beaucoup sur le danger que courent les soldats face aux obus allemands. Les soldats finissent aussi par se ressembler. Certains sont de véritables casse-cous, d’autres sont très prudents, certains ont du flair, d’autres sont intelligents. Ainsi en est-il des Bolduc, Garneau, Dubuc, Thivierge, Taillefer, Lanthier, Beauvais, Xavier Gagnon, Vachon, tous compagnons d’armes de Lanoue... Certains seront blessés, la plupart vont mourir. Tout engagé volontaire finit par se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère. Et on découvre des motivations assez diverses. L’un d’eux était millionnaire, plusieurs sont des rejetés sociaux (ou se perçoivent ainsi), d’autres sont des aventuriers. « Avoir marché au devant de son destin pour soumettre sa vie à l'épreuve suprême; s'être trouvé, tel que prévu, face à la Mort; l'avoir défiée en combat singulier, s'être battu comme Jacob avec l'ange; — Qu'on eût vaincu ou perdu, cela, peut-être, était digne d'un homme ? Beaucoup de gens réprouveraient cet acte, c'était leur droit. On ne s'était pas battu, somme toute, pour défendre ses foyers. Si on avait libéré des peuples dont la gratitude, à elle seule, était une récompense suffisante, les idéologies politiques n'étaient pas toujours claires, dans la tête de tous ces soldats qui connaissaient surtout leur devoir. Mais ceux qui affecteraient de mépriser cet acte, il y avait de bonnes chances pour qu'ils fussent les médiocres ou la canaille. Pour exposer sa vie en y trouvant une satisfaction de l'âme, il fallait valoir quelque chose. »
L’auteur parle aussi de la camaraderie artificielle qui lie les militaires, camaraderie alimentée par le partage d’expériences dangereuses. « La guerre, songeait Richard, est de toute évidence le plus mauvais terrain qu'on puisse choisir pour y semer des attachements [...] la guerre avait fait qu'ils dussent se regarder longtemps vivre, avant de passer leur chemin. La guerre avait happé leurs destins pour les associer. Ils avaient vécu ensemble les meilleures années de leur jeunesse, les plus riches, les plus fortes et les plus généreuses. Les irrétractables; les parties-à-jamais; les irremplaçables.»
C’est une réflexion sur la guerre, mais non une condamnation Comme dans tous ces récits, le narrateur est divisé face à la guerre : il dénonce cette tuerie inhumaine qui jette de pauvres pions dans un combat qu’ils ne comprennent pas, mais en même temps il doit avouer que cette vie, à flirter avec la mort, est tellement intense que tout autre aventure humaine peut sembler bien fade.
Vaillancourt dénonce le sort fait aux simples soldats, entre autres l’injustice des récompenses : « — D'abord, commença-t-il, si t'es simple soldat ou lance-capote comme moé et que tu le restes jusqu'à la fin de la guerre — et l'on va rester tous les deux tels que l'on est, si tu veux dire comme moé — t'as à peu près autant de chances de gagner une médaille de bravoure que d'obtenir ta discharge. Tu peux te faire tuer dix fois de suite : t'auras jamais de médaille à moins d'avoir sauvé ton régiment et tué cent Allemands devant un brigadier comme témoin. Mais c'est tellement rare qu'on voye un brigadier au front, que t'as à peu près autant de chances d'en voir un d'ici à la fin de la guerre que t'en as de sauver ton régiment. — Tu me suis ?
— Si t'as des témoins moins pesants qu'un brigadier, t'as un p'tit moyen de compenser au désavantage de la situation, en te faisant arracher un bras ou une jambe pendant que tu sauves ton régiment. Et si tes témoins étaient même pas des officiers, ta dernière chance est de te faire tuer en sauvant ton régiment; dans ce cas-là, y vont envoyer la médaille à ton plus proche parent. Moé, ça serait ma femme; toé, ça serait probablement ta mère qui braillerait toutes les larmes de son corps. »
C’est un bon roman, juste un peu au-dessous de Neuf jours de haine. Ce n’est pas mal écrit. Les dialogues sont crus (jurons, joual, sexualité). Les retours en arrière ne sont pas très bien intégrés au récit.
Sur Vaillancourt : Rendez-vous à l’étoile
Extrait
Lanoue réfléchit quelques secondes, puis il se redressa sur ses coudes. Un barrage de cette nature ne s'effectuait pas sans un avant-poste d'observation : il scruta le bosquet sur la droite.
Il ne s'était pas attendu, de loin, à distinguer quoi que ce fût d'insolite derrière des arbres. Il n'en eut pas moins la conviction qu'il y avait quelque chose là et rampa vers Lanthier.
Le terrain finit par être comparable au cratère d'un volcan en éruption. Ce fut sur le peloton le déchaînement d'un cataclysme hors de toute mesure humaine. C'était un concert incessant de hurlements d'enfer qui plongeaient droit sur les malheureux agrippés à la terre où ils ne pouvaient s'enfouir, suivis d'explosions monstrueuses qui les environnaient de flammes et les soulevaient. Toutes les forces telluriques de ce sol à l'histoire barbare semblaient s'être concentrées sur ce point de l'Allemagne pour détruire ses envahisseurs. Les obus sifflaient, hurlaient, crevaient et tonnaient sur le peloton en l'enveloppant d'une fumée noire qui était affreuse; les hommes à plat ventre étreignaient la terre de leurs bras, de leurs jambes et de leurs ventres, ouvrant convulsivement la bouche. Des cris, des appels, des gémissements et des râles confus de blessés commencèrent à s'élever du paquet d'hommes tordus comme des épileptiques, et le bombardement augmenta encore sa violence. La plaine entière, cette fois, parut se soulever et onduler comme le dos d'un pachyderme en furie.
Une voix, tout à coup, s'éleva du cataclysme; elle le domina dans un gémissement éperdu qui atteignit les hommes à la cervelle :
— Maman !. . .
Un jeune conscrit, dressé debout, les bras très hauts, sa bouche et ses yeux immensément ouverts, avait jeté l'appel ultime de l'être humain. Il resta ainsi immobile, figé dans l'extase de la mort. Puis ses jambes cédèrent lentement sous lui, et il disparut dans la fumée de l'obus qui l'avait tué.
Un souffle de démence passa sur les hommes. Lanthier, dressé à son tour, hurla :
— Debout ! Debout !. . . Tout le monde debout ! — On sort d'icitte ! Suivez-moé tous, on pique su' le bois !
Tous les hommes encore capables de se tenir sur leurs jambes s'élancèrent au pas de course à la suite de Lanthier. Ils coururent pendant quelques minutes, dans une ruée hors de l'enfer; mais l'enfer ne tarda pas à les poursuivre et à les rejoindre. Les artilleurs n'eurent qu'à déplacer de quelques centimètres l'angle de leur tir pour retrouver leur cible mobile. Et l'avalanche de fer et de feu s'abattit de nouveau sur les hommes... (p. 132-133)