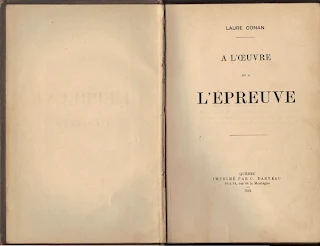Élioza Fafard-Lacasse, Légendes et Récits de la Côte-Nord du Saint-Laurent, Montréal, Atelier de l’Éclaireur de Montréal, 1937, 131 pages.
Pointe-des-Monts, Côte-Nord. Chassé d’un petit village du Saguenay à la suite d’une faillite, Louis-Ferdinand Fafard, le père d’Élioza, arrive au phare de Pointe-des-Monts, avec sa famille, le 15 novembre 1872. La jeune fille a alors neuf ans. Elle vivra dix-huit ans au phare, « les plus belles années de [s]a vie ». Ce sont ces souvenirs qu’elle entreprend de raconter et qu’elle publie en 1937 sous le titre : Légendes et Récits de la Côte-Nord du Saint-Laurent.
Au cas où le lieu ne vous dirait rien, il vaut mieux commencer par une visite virtuelle. « Le phare de la Pointe-des-Monts est situé à environ trois cents milles en bas de Québec, sur la côte nord du Golfe Saint-Laurent. La géographie de l’époque reconnaissait sa position actuelle comme le commencement du Labrador canadien. Il fut construit en 1830, sous le régime anglais. C’est une très forte construction en pierre de taille, sise sur une pointe de rocher qui devient, à marée haute, complètement entourée d’eau, formant ainsi une sorte d’îlot relié à la terre par un pont à cage d’une longueur de cinq cents pieds environ. »
Un mystère, sinon une poésie, entoure la vie de tous ces gardiens qui ont maintenu les phares disséminés sur le Saint-Laurent. Leur travail était relativement simple : « Le gardien devait allumer ces lampes tous les soirs, au déclin du jour, et les éteindre lorsque les ombres de la nuit s’effaçaient devant les premières lueurs de l’aube. » On imagine la solitude des lieux : « Ô! les rigueurs de l’hiver au Labrador à cette époque lointaine, il faut les avoir connues! C’était d’abord, lorsqu’avait lieu la clôture de la navigation, l’adieu à tout contact avec la civilisation. Il fallait s’isoler pour six longs mois, et se pourvoir de tout ce qui était nécessaire pour faire face aux rigueurs du climat. À certains jours, les longues veillées n’étaient troublées que par le fracas des violentes tempêtes. Les plaintes du vent tourbillonnant autour du phare avaient je ne sais quoi de lugubre. Et cependant, au milieu de ce désarroi de la nature en furie, nous nous sentions en sécurité près d’un bon feu. Il y avait un certain charme à suivre le déchaînement des éléments. »
Le témoignage d’Élioza Fafard est intéressant, non seulement parce qu’il rend compte de la vie au phare, mais aussi d’un monde disparu. Elle voue un grand respect aux Innus (les Montagnais) qui étaient alors leurs seuls voisins. « Les Indiennes portaient une jupe très courte et de couleur éclatante : rouge, bleue ou jaune. Elles avaient pour coiffure un bonnet en drap rouge et noir orné de perles, qu’elles travaillaient elles-mêmes à merveille. Les hommes avaient encore les cheveux longs. Ils étaient chaussés de mocassins et portaient une ceinture rouge. » Il en va de même pour les Métis : « Cette population était un mélange de diverses nations, il y avait des Canadiens, des Français, des Anglais, des Écossais, que sais-je encore, qui, forcés par les événements de vivre dans ces endroits, avaient contracté des alliances avec des femmes des tribus sauvages de ce pays; et de là viennent les Métis qui existent encore aujourd’hui. Leur commerce était très agréable, ils étaient intelligents, spirituels et avides d’instruction. »
Isolés au phare? Pas tant que ça! À vrai dire, peu d’enfants eurent plus de contacts avec les différentes nations de la terre. Souvent les naufragés passaient quelques semaines avec eux. Ils hébergèrent même certains voyageurs mystérieux : « Que d’étrangers, avec lesquels s’établissait une certaine sympathie, passèrent au phare pour ne jamais revenir! Je me souviens qu’un jour, un visiteur étranger arriva seul dans un canot, venant de très loin, nous dit-il. Mon père le reçut avec son habituelle cordialité. L’étranger, qui se disait médecin, passa huit jours au phare, et pendant huit jours nous fûmes sous le charme de sa belle éducation et de sa haute culture, mais le but de son voyage extraordinaire demeura un mystère. » Enfin, il y avait aussi les marins de passage : « Semblables à de grands oiseaux déployant leurs ailes, de jolis vaisseaux à voiles blanches commençaient à voguer sur le fleuve. À cette époque nous ne comptions que peu de bateaux à vapeur mais beaucoup de voiliers transatlantiques; il y en avait parfois des centaines. Rien n’était plus joli que le spectacle de ces élégants navires, voiles hautes, retenus par le calme et se balançant légèrement devant le phare, en attendant un vent favorable pour continuer leur voyage. Nous entendions le chant des matelots que l’écho répétait dans le lointain, ce chant particulier aux marins des bateaux à voile et qu’ils employaient lorsqu’ils mettaient le navire à tribord ou à bâbord. »
Il fallait bien avoir quelques contacts avec la civilisation, entre autres pour accomplir ses devoirs religieux. À quelques milles du phare se trouve Baie-Trinité. C’est là que la jeune Élioza doit pensionner pour accomplir les préparatifs de sa première communion. Et il fallait aussi quelque instruction : ses parents les envoyèrent, elle et sa sœur, étudier au couvent de Sillery.
On a aussi droit à certains échos de la Côte, à la petite histoire. Elle décrit les principaux lieux, des Ilets-Jérémie à Sept-Îles, et rapporte certaines légendes comme celle du feu fantôme que les marins poursuivent en vain, celle du monstre marin qui dévore les voyageurs… Elle consacre un chapitre au mythique Napoléon-Alexandre Comeau et à ses exploits. Enfin, elles rapporte certains faits qui feraient la une des journaux aujourd’hui : histoires romanesques, meurtres, sauvetages. Elle raconte, entre autres, le naufrage de sa famille et son sauvetage au bout de quatre heures d’angoisse lors d’un voyage à Québec en 1877
Plusieurs personnages « importants » visitent le phare : le Marquis de Lorne, la princesse Louise et le prince Arthur, le comte Desloges, le marquis de Roy… Le passage de celui-ci est marquant pour la jeune fille : « Le jeune marquis surtout, avec son joli langage parisien, m’apparaissait comme le Prince Charmant. C’était plus qu’il n’en fallait pour une jeune fille de seize ans, sortant du couvent, et surtout dans un pays si propre aux sentiments romanesques. Son départ fut un choc pour moi. J’en fus bien attristée. Je rêvai longtemps de lui : ma pensée l’accompagnait sur cette mer qui l’emportait au loin, là-bas, créant une distance de plus en plus grande entre nous. »
Un jour, il fallut quitter Pointe-des-Monts. « Triste et émue, je quittai la Pointe-des-Monts par un beau soir du mois d’août 18... C’était au crépuscule, un reste du jour paraissait encore au nord. Nous passâmes pour une dernière fois devant le phare qui avait été si souvent le point de notre arrivée et de notre départ. Ses lumières venaient d’être allumées et les reflets de leurs rayons se répandaient en ondes lumineuses, éclairant le fleuve dans toute sa beauté. Mes regards embrassaient toutes ces choses que j’avais tant aimées, avec le secret pressentiment que je ne les reverrais plus. » La narratrice y revint vingt ans plus tard.
Il y a peu à ajouter sur ce charmant recueil de souvenirs d’agréable lecture. Le livre est très rare, mais on en trouve des versions informatisées sur BANQ , BeQ et Nos Racines. ***
Pointe-des-Monts, Côte-Nord. Chassé d’un petit village du Saguenay à la suite d’une faillite, Louis-Ferdinand Fafard, le père d’Élioza, arrive au phare de Pointe-des-Monts, avec sa famille, le 15 novembre 1872. La jeune fille a alors neuf ans. Elle vivra dix-huit ans au phare, « les plus belles années de [s]a vie ». Ce sont ces souvenirs qu’elle entreprend de raconter et qu’elle publie en 1937 sous le titre : Légendes et Récits de la Côte-Nord du Saint-Laurent.
Au cas où le lieu ne vous dirait rien, il vaut mieux commencer par une visite virtuelle. « Le phare de la Pointe-des-Monts est situé à environ trois cents milles en bas de Québec, sur la côte nord du Golfe Saint-Laurent. La géographie de l’époque reconnaissait sa position actuelle comme le commencement du Labrador canadien. Il fut construit en 1830, sous le régime anglais. C’est une très forte construction en pierre de taille, sise sur une pointe de rocher qui devient, à marée haute, complètement entourée d’eau, formant ainsi une sorte d’îlot relié à la terre par un pont à cage d’une longueur de cinq cents pieds environ. »
Un mystère, sinon une poésie, entoure la vie de tous ces gardiens qui ont maintenu les phares disséminés sur le Saint-Laurent. Leur travail était relativement simple : « Le gardien devait allumer ces lampes tous les soirs, au déclin du jour, et les éteindre lorsque les ombres de la nuit s’effaçaient devant les premières lueurs de l’aube. » On imagine la solitude des lieux : « Ô! les rigueurs de l’hiver au Labrador à cette époque lointaine, il faut les avoir connues! C’était d’abord, lorsqu’avait lieu la clôture de la navigation, l’adieu à tout contact avec la civilisation. Il fallait s’isoler pour six longs mois, et se pourvoir de tout ce qui était nécessaire pour faire face aux rigueurs du climat. À certains jours, les longues veillées n’étaient troublées que par le fracas des violentes tempêtes. Les plaintes du vent tourbillonnant autour du phare avaient je ne sais quoi de lugubre. Et cependant, au milieu de ce désarroi de la nature en furie, nous nous sentions en sécurité près d’un bon feu. Il y avait un certain charme à suivre le déchaînement des éléments. »
Le témoignage d’Élioza Fafard est intéressant, non seulement parce qu’il rend compte de la vie au phare, mais aussi d’un monde disparu. Elle voue un grand respect aux Innus (les Montagnais) qui étaient alors leurs seuls voisins. « Les Indiennes portaient une jupe très courte et de couleur éclatante : rouge, bleue ou jaune. Elles avaient pour coiffure un bonnet en drap rouge et noir orné de perles, qu’elles travaillaient elles-mêmes à merveille. Les hommes avaient encore les cheveux longs. Ils étaient chaussés de mocassins et portaient une ceinture rouge. » Il en va de même pour les Métis : « Cette population était un mélange de diverses nations, il y avait des Canadiens, des Français, des Anglais, des Écossais, que sais-je encore, qui, forcés par les événements de vivre dans ces endroits, avaient contracté des alliances avec des femmes des tribus sauvages de ce pays; et de là viennent les Métis qui existent encore aujourd’hui. Leur commerce était très agréable, ils étaient intelligents, spirituels et avides d’instruction. »
Isolés au phare? Pas tant que ça! À vrai dire, peu d’enfants eurent plus de contacts avec les différentes nations de la terre. Souvent les naufragés passaient quelques semaines avec eux. Ils hébergèrent même certains voyageurs mystérieux : « Que d’étrangers, avec lesquels s’établissait une certaine sympathie, passèrent au phare pour ne jamais revenir! Je me souviens qu’un jour, un visiteur étranger arriva seul dans un canot, venant de très loin, nous dit-il. Mon père le reçut avec son habituelle cordialité. L’étranger, qui se disait médecin, passa huit jours au phare, et pendant huit jours nous fûmes sous le charme de sa belle éducation et de sa haute culture, mais le but de son voyage extraordinaire demeura un mystère. » Enfin, il y avait aussi les marins de passage : « Semblables à de grands oiseaux déployant leurs ailes, de jolis vaisseaux à voiles blanches commençaient à voguer sur le fleuve. À cette époque nous ne comptions que peu de bateaux à vapeur mais beaucoup de voiliers transatlantiques; il y en avait parfois des centaines. Rien n’était plus joli que le spectacle de ces élégants navires, voiles hautes, retenus par le calme et se balançant légèrement devant le phare, en attendant un vent favorable pour continuer leur voyage. Nous entendions le chant des matelots que l’écho répétait dans le lointain, ce chant particulier aux marins des bateaux à voile et qu’ils employaient lorsqu’ils mettaient le navire à tribord ou à bâbord. »
Il fallait bien avoir quelques contacts avec la civilisation, entre autres pour accomplir ses devoirs religieux. À quelques milles du phare se trouve Baie-Trinité. C’est là que la jeune Élioza doit pensionner pour accomplir les préparatifs de sa première communion. Et il fallait aussi quelque instruction : ses parents les envoyèrent, elle et sa sœur, étudier au couvent de Sillery.
On a aussi droit à certains échos de la Côte, à la petite histoire. Elle décrit les principaux lieux, des Ilets-Jérémie à Sept-Îles, et rapporte certaines légendes comme celle du feu fantôme que les marins poursuivent en vain, celle du monstre marin qui dévore les voyageurs… Elle consacre un chapitre au mythique Napoléon-Alexandre Comeau et à ses exploits. Enfin, elles rapporte certains faits qui feraient la une des journaux aujourd’hui : histoires romanesques, meurtres, sauvetages. Elle raconte, entre autres, le naufrage de sa famille et son sauvetage au bout de quatre heures d’angoisse lors d’un voyage à Québec en 1877
Plusieurs personnages « importants » visitent le phare : le Marquis de Lorne, la princesse Louise et le prince Arthur, le comte Desloges, le marquis de Roy… Le passage de celui-ci est marquant pour la jeune fille : « Le jeune marquis surtout, avec son joli langage parisien, m’apparaissait comme le Prince Charmant. C’était plus qu’il n’en fallait pour une jeune fille de seize ans, sortant du couvent, et surtout dans un pays si propre aux sentiments romanesques. Son départ fut un choc pour moi. J’en fus bien attristée. Je rêvai longtemps de lui : ma pensée l’accompagnait sur cette mer qui l’emportait au loin, là-bas, créant une distance de plus en plus grande entre nous. »
Un jour, il fallut quitter Pointe-des-Monts. « Triste et émue, je quittai la Pointe-des-Monts par un beau soir du mois d’août 18... C’était au crépuscule, un reste du jour paraissait encore au nord. Nous passâmes pour une dernière fois devant le phare qui avait été si souvent le point de notre arrivée et de notre départ. Ses lumières venaient d’être allumées et les reflets de leurs rayons se répandaient en ondes lumineuses, éclairant le fleuve dans toute sa beauté. Mes regards embrassaient toutes ces choses que j’avais tant aimées, avec le secret pressentiment que je ne les reverrais plus. » La narratrice y revint vingt ans plus tard.
Il y a peu à ajouter sur ce charmant recueil de souvenirs d’agréable lecture. Le livre est très rare, mais on en trouve des versions informatisées sur BANQ , BeQ et Nos Racines. ***















.jpeg)