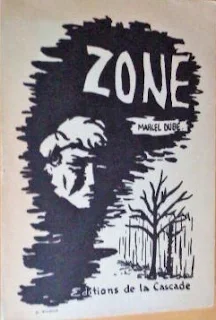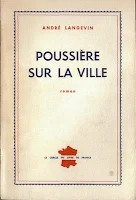Isabelle Legris, Ma vie tragique. Poèmes de la douleur et du sang, Montréal, Éditions du Mausolée, 1947, 158 p.
Isabelle Legris n’a que 19 ans quand elle publie Ma vie tragique. Comme certains critiques l’ont noté, il est un peu curieux de trouver à la fois une dédicace à sa mère et l’annonce de ses « Carnets d’amante » comme « œuvre en préparation » au début du recueil.
Ma vie tragique compte quatre parties. La première, qui ne porte pas de titre, contient neuf poèmes, tous en italique. Dès le premier poème, « Les Fronts aveugles », on découvre l’audace de la poète, son esthétique quelque peu surréaliste. La mort est très présente : « Nous n’avons jamais vu les heures de ces années transcendantes / se mirer dans l’apparat du linceul et soumettre au tombeau / la trame des trajectoires du temps / et soumettre au tombeau l’écho de la mort ». Legris répète comme un leitmotiv « Nous n’avons jamais vu… » Il me semble que ce sentiment d’exclusion est assez symptomatique d’un malaise, souvent décrit dans les années de la grande noirceur : la vie en retrait du monde, l’inadaptation du poète. Ainsi va le début du « Chant de l’angoisse » : « les journées de demain seront lourdes et atroces / le ciel sans clémence / et la terre imparfaite ». Chez Legris, ce malaise semble lié au désir coupable, la chair devant débattre avec le feu : « mais leurs chairs pénétreront la couleur des soleils / et leurs chairs entreront dans le feu sonore // et le combat de la chair restera vain ». Seule la mort peut offrir un plaisir déculpabilisé : « on verra la mort / on la verra de près / on l’aimera d’un vaste amour // elle qui doit répandre l’allégresse des voluptés éternelles ».
On retrouve un peu la même thématique dans « Poèmes pathétiques », c’est-à-dire la passion coupable, les fantasmes, la sexualité violente. Le soleil ne se contente plus d’être le surmoi culpabilisant; il devient le bourreau qui immole sa victime : « le soleil luit pour moi / et devant mes yeux / mais sa morsure est un dard / qui m’empoisonne et me tue / … / qui s’emporte et déchire / dans sa rage animale / se rue sur sa proie / et la saisit ensanglantée. » Ce fantasme, comme toute la sexualité, est associé à l’avilissement : « ma bouche en voulant murmurer / les mots de l’espérance / a rencontré dans l’ombre / la boue et la fange misérables ». D’où vient cette culpabilité dégradante? Le poème « Délire » est assez explicite : « parce qu'il est venu / tardivement / pour jouer sur mes yeux / la chanson de l'inceste // parce qu'il était mon frère / immensément / comme glissent dans le soir / des jours mous / et sans crépuscules // mais moi je marchais / semblable à la pécheresse / de la Bible / avec ma robe de soie / ouverte sur ma poitrine en feu / pour recevoir la caresse / de celui qui ne venait pas ».
Dans « Symphonie de la douleur », la troisième partie, chaque poème est associé à une tonalité musicale et à une couleur; par exemple, le premier poème s’intitule « Poème en do mineur (bleu) ». L’imaginaire, lui, n’a pas changé. Dans « Poème en ré majeur (blanc) », elle imagine des Vierges qui se dévêtent et s’adonnent au jeu de l’amour. Ailleurs elle écrit de façon très audacieuse : « j’ai trop aimé l’orgie / des saisons enflammées / et le désordre affreux / dans lequel trainaient / les jours de juillet / harassé et luisant / comme une eau d’huile grasse / cachant des péchés noirs ». Et cela non plus, on ne l’a pas lu souvent dans la littérature québécoise d’avant les années 1960 : « j’ai laissé mes grands rêves / dans la caverne humide / où rampaient les serpents / dans la glue de leur bave ».
 La dernière partie, qui s’intitule « Chants du cœur », laisse présager une atmosphère moins glauque, mais on retrouve encore les mêmes motifs, comme celui de l’amour coupable associé à la mort : « je voudrais me jeter / dans le brasier sinistre / me perdre et m’anéantir / mourir d’une seule mort de sang / dans l’ivresse du feu / mourir comme finit le tourment / dans le seul cœur de Dieu ». Malgré le sentiment d’abjection, le désir survit comme en témoigne l’avant-dernier poème du recueil « J’ai trop attendu l’heure » : « j’ai trop attendu l’heure / où sa chair serait mêlée à la mienne / où l’amour et le chant / seraient devenus / la source de nos deux ardeurs / où le sang de son corps / aurait coulé sur moi / pour me réchauffer toute / et m’abreuver de force »
La dernière partie, qui s’intitule « Chants du cœur », laisse présager une atmosphère moins glauque, mais on retrouve encore les mêmes motifs, comme celui de l’amour coupable associé à la mort : « je voudrais me jeter / dans le brasier sinistre / me perdre et m’anéantir / mourir d’une seule mort de sang / dans l’ivresse du feu / mourir comme finit le tourment / dans le seul cœur de Dieu ». Malgré le sentiment d’abjection, le désir survit comme en témoigne l’avant-dernier poème du recueil « J’ai trop attendu l’heure » : « j’ai trop attendu l’heure / où sa chair serait mêlée à la mienne / où l’amour et le chant / seraient devenus / la source de nos deux ardeurs / où le sang de son corps / aurait coulé sur moi / pour me réchauffer toute / et m’abreuver de force »
Cette œuvre a été sortie de l’anonymat ces dernières années, surtout par la rétrospective des éditions de l’Hexagone. L’histoire littéraire s’est-elle trompée? Oui, selon moi. Legris, qui n’a pas le fini littéraire des Garneau, Grandbois et Hébert, porte quand même une voix originale dans le Québec des années 1940. Quelle audace! Elle parle ouvertement de sexualité, souvent sans culpabilité excessive. Et personne ne peut nier ses dons de poète!
Toutefois, on tombera d’accord pour dire que son recueil n’est pas assez travaillé. Surtout dans la première partie, Legris recherche l’image forte, la formule qui fera mouche dans l’esprit de son lecteur, sacrifiant souvent la cohérence du propos. Et parfois on note certaines maladresses, comme cette formulation dans le premier poème : « la réalité des nids détruits par la destruction »; ou encore tout cette strophe : nous n’avons jamais entendu l’horloge des temples / sonore dans le matin / et les temples venir vers nous / dans le matin / comme la longitude des itinéraires / défendus par l’aurore. » On pourrait aussi questionner la composition du recueil. En fait, il faudrait couper, ce que l’auteure aurait fait, il semblerait, dans une version remaniée de ses poèmes publiée en 1979 et intitulée Le Sceau de l'ellipse.
TORCHÈRE
je ne suis pas coupable
d'avoir à pleines gorgées
épuisé
l'eau de la source du soir
dans ma bouche
l'eau qui jaillissait du roc
puis coulait sur la terre
pour former de la boue
avec ce sable
je ne suis pas coupable
des rochers de la source
où s'introduit la pluie
de la nuit
d'avoir pris dans mes mains
pendant les heures de pluie
son front de meurtrier
plus noir et plus tragique
que l'orage dans les bois
d'avoir touché son front
flagellé
par le jade des eaux visqueuses
comme on paraît s'éloigner
des rivières de l'été
je ne suis pas coupable
de l'homme inassouvi
avalé par ma bouche
de l'homme insatisfait
sans lumière
à couleur de baiser et de braises
je ne suis pas coupable
de ma folie abrupte
et de mes yeux évanouis
devant cet homme blanc
qui cache mon sein triste
et que j'aimais jadis
comme un enfant des langes
le monde et l'homme
je les ai bus alors
comme des dieux pourpres
sanglants
je les ai bus comme des vins vulgaires
jusqu'à la substance même de mes os
puis les ai vomis
sur leur tête ils ont reçu mon sang
fétide
sur leur front bâtard
de pendus
ils ont reçu le venin eux
avec leurs mensonges
mais de ce sang horrible
sorti de mon sein
à la place du lait
je ne suis pas coupable
Lire l’article de Jessica Bélanger.
Isabelle Legris n’a que 19 ans quand elle publie Ma vie tragique. Comme certains critiques l’ont noté, il est un peu curieux de trouver à la fois une dédicace à sa mère et l’annonce de ses « Carnets d’amante » comme « œuvre en préparation » au début du recueil.
Ma vie tragique compte quatre parties. La première, qui ne porte pas de titre, contient neuf poèmes, tous en italique. Dès le premier poème, « Les Fronts aveugles », on découvre l’audace de la poète, son esthétique quelque peu surréaliste. La mort est très présente : « Nous n’avons jamais vu les heures de ces années transcendantes / se mirer dans l’apparat du linceul et soumettre au tombeau / la trame des trajectoires du temps / et soumettre au tombeau l’écho de la mort ». Legris répète comme un leitmotiv « Nous n’avons jamais vu… » Il me semble que ce sentiment d’exclusion est assez symptomatique d’un malaise, souvent décrit dans les années de la grande noirceur : la vie en retrait du monde, l’inadaptation du poète. Ainsi va le début du « Chant de l’angoisse » : « les journées de demain seront lourdes et atroces / le ciel sans clémence / et la terre imparfaite ». Chez Legris, ce malaise semble lié au désir coupable, la chair devant débattre avec le feu : « mais leurs chairs pénétreront la couleur des soleils / et leurs chairs entreront dans le feu sonore // et le combat de la chair restera vain ». Seule la mort peut offrir un plaisir déculpabilisé : « on verra la mort / on la verra de près / on l’aimera d’un vaste amour // elle qui doit répandre l’allégresse des voluptés éternelles ».
On retrouve un peu la même thématique dans « Poèmes pathétiques », c’est-à-dire la passion coupable, les fantasmes, la sexualité violente. Le soleil ne se contente plus d’être le surmoi culpabilisant; il devient le bourreau qui immole sa victime : « le soleil luit pour moi / et devant mes yeux / mais sa morsure est un dard / qui m’empoisonne et me tue / … / qui s’emporte et déchire / dans sa rage animale / se rue sur sa proie / et la saisit ensanglantée. » Ce fantasme, comme toute la sexualité, est associé à l’avilissement : « ma bouche en voulant murmurer / les mots de l’espérance / a rencontré dans l’ombre / la boue et la fange misérables ». D’où vient cette culpabilité dégradante? Le poème « Délire » est assez explicite : « parce qu'il est venu / tardivement / pour jouer sur mes yeux / la chanson de l'inceste // parce qu'il était mon frère / immensément / comme glissent dans le soir / des jours mous / et sans crépuscules // mais moi je marchais / semblable à la pécheresse / de la Bible / avec ma robe de soie / ouverte sur ma poitrine en feu / pour recevoir la caresse / de celui qui ne venait pas ».
Dans « Symphonie de la douleur », la troisième partie, chaque poème est associé à une tonalité musicale et à une couleur; par exemple, le premier poème s’intitule « Poème en do mineur (bleu) ». L’imaginaire, lui, n’a pas changé. Dans « Poème en ré majeur (blanc) », elle imagine des Vierges qui se dévêtent et s’adonnent au jeu de l’amour. Ailleurs elle écrit de façon très audacieuse : « j’ai trop aimé l’orgie / des saisons enflammées / et le désordre affreux / dans lequel trainaient / les jours de juillet / harassé et luisant / comme une eau d’huile grasse / cachant des péchés noirs ». Et cela non plus, on ne l’a pas lu souvent dans la littérature québécoise d’avant les années 1960 : « j’ai laissé mes grands rêves / dans la caverne humide / où rampaient les serpents / dans la glue de leur bave ».
 La dernière partie, qui s’intitule « Chants du cœur », laisse présager une atmosphère moins glauque, mais on retrouve encore les mêmes motifs, comme celui de l’amour coupable associé à la mort : « je voudrais me jeter / dans le brasier sinistre / me perdre et m’anéantir / mourir d’une seule mort de sang / dans l’ivresse du feu / mourir comme finit le tourment / dans le seul cœur de Dieu ». Malgré le sentiment d’abjection, le désir survit comme en témoigne l’avant-dernier poème du recueil « J’ai trop attendu l’heure » : « j’ai trop attendu l’heure / où sa chair serait mêlée à la mienne / où l’amour et le chant / seraient devenus / la source de nos deux ardeurs / où le sang de son corps / aurait coulé sur moi / pour me réchauffer toute / et m’abreuver de force »
La dernière partie, qui s’intitule « Chants du cœur », laisse présager une atmosphère moins glauque, mais on retrouve encore les mêmes motifs, comme celui de l’amour coupable associé à la mort : « je voudrais me jeter / dans le brasier sinistre / me perdre et m’anéantir / mourir d’une seule mort de sang / dans l’ivresse du feu / mourir comme finit le tourment / dans le seul cœur de Dieu ». Malgré le sentiment d’abjection, le désir survit comme en témoigne l’avant-dernier poème du recueil « J’ai trop attendu l’heure » : « j’ai trop attendu l’heure / où sa chair serait mêlée à la mienne / où l’amour et le chant / seraient devenus / la source de nos deux ardeurs / où le sang de son corps / aurait coulé sur moi / pour me réchauffer toute / et m’abreuver de force »Cette œuvre a été sortie de l’anonymat ces dernières années, surtout par la rétrospective des éditions de l’Hexagone. L’histoire littéraire s’est-elle trompée? Oui, selon moi. Legris, qui n’a pas le fini littéraire des Garneau, Grandbois et Hébert, porte quand même une voix originale dans le Québec des années 1940. Quelle audace! Elle parle ouvertement de sexualité, souvent sans culpabilité excessive. Et personne ne peut nier ses dons de poète!
Toutefois, on tombera d’accord pour dire que son recueil n’est pas assez travaillé. Surtout dans la première partie, Legris recherche l’image forte, la formule qui fera mouche dans l’esprit de son lecteur, sacrifiant souvent la cohérence du propos. Et parfois on note certaines maladresses, comme cette formulation dans le premier poème : « la réalité des nids détruits par la destruction »; ou encore tout cette strophe : nous n’avons jamais entendu l’horloge des temples / sonore dans le matin / et les temples venir vers nous / dans le matin / comme la longitude des itinéraires / défendus par l’aurore. » On pourrait aussi questionner la composition du recueil. En fait, il faudrait couper, ce que l’auteure aurait fait, il semblerait, dans une version remaniée de ses poèmes publiée en 1979 et intitulée Le Sceau de l'ellipse.
TORCHÈRE
je ne suis pas coupable
d'avoir à pleines gorgées
épuisé
l'eau de la source du soir
dans ma bouche
l'eau qui jaillissait du roc
puis coulait sur la terre
pour former de la boue
avec ce sable
je ne suis pas coupable
des rochers de la source
où s'introduit la pluie
de la nuit
d'avoir pris dans mes mains
pendant les heures de pluie
son front de meurtrier
plus noir et plus tragique
que l'orage dans les bois
d'avoir touché son front
flagellé
par le jade des eaux visqueuses
comme on paraît s'éloigner
des rivières de l'été
je ne suis pas coupable
de l'homme inassouvi
avalé par ma bouche
de l'homme insatisfait
sans lumière
à couleur de baiser et de braises
je ne suis pas coupable
de ma folie abrupte
et de mes yeux évanouis
devant cet homme blanc
qui cache mon sein triste
et que j'aimais jadis
comme un enfant des langes
le monde et l'homme
je les ai bus alors
comme des dieux pourpres
sanglants
je les ai bus comme des vins vulgaires
jusqu'à la substance même de mes os
puis les ai vomis
sur leur tête ils ont reçu mon sang
fétide
sur leur front bâtard
de pendus
ils ont reçu le venin eux
avec leurs mensonges
mais de ce sang horrible
sorti de mon sein
à la place du lait
je ne suis pas coupable
Lire l’article de Jessica Bélanger.






 Extrait
Extrait