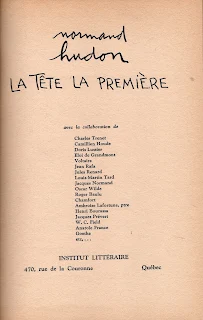Robert de Roquebrune, Cherchant mes souvenirs, 1911-1940, Montréal, Fides, Collection du Nénuphar, 1968, 243 p.
Cherchant mes souvenirs, 1911-1940 vient compléter Testament de mon enfance et Quartier Saint-Louis que j’ai déjà présentés sur ce blogue. Je vais répéter rapidement ce que j’ai déjà écrit, à savoir que les mémoires de Roquebrune, bien qu’anecdotiques, sont racontées avec charme et finesse. Au-delà de l’autofabulation propre à tout mémorialiste, ce témoignage nous fait revivre la première moitié du vingtième siècle, telle que vécue par un intellectuel fortuné, qui prenait la vie à la légère.
Résumons
le livre. Roquebrune épouse Josée Angers en 1911, les deux se paient un voyage
de noces d’une dizaine de mois à Paris. De retour au Québec, ils s’installent à
Beloeil. Roquebrune commence à écrire à
la suggestion de son épouse, participe à la création du mythique Nigog
en 1918 (voir l’extrait). Le couple retourne à Paris en 1919, cette fois-ci
pour y vivre. Roquebrune continue d’écrire romans, essais et articles
journalistiques, tout en travaillant comme archiviste. Le couple, sans enfants,
possède une maison à Paris et une autre près de Nice. Ils voyagent beaucoup, surtout
en Europe. En 1940, pour fuir la guerre, ils traversent en Angleterre avant de
rentrer au Canada. C’est ici que s’arrête le récit de Roquebrune.
Ajoutons
qu’ils retournent en France en 1946. Josée y décède en 1964 et Roquebrune
rentre au Canada en 1968, année de publication du présent livre. Il vivra
encore dix ans.
Roquebrune
se plaît à tracer un portrait de tous ces gens qu’il a connus ou simplement
croisés dans un salon. Et il y en a beaucoup! Citons parmi les noms
connus : Barbey d’Aurevilly, Teilhard de Chardin, Maurice Ravel, Paul Claudel, Léon Bloy,
Charles Maurras… Il décrit aussi plusieurs lieux de séjour qu’ils ont
fréquentés.
Curieusement,
la figure qui émerge de ce livre, c’est celle de sa femme Josée Angers, décédée
au moment de l’écriture du livre. Il semble complètement perdu sans elle. Ce
qu’il faut comprendre, c’est que cette femme fortunée, bien supérieure à lui
intellectuellement parlant – c’est lui qui le dit –, a géré leur vie de couple,
achetant et décorant les maisons, préparant avec un soin minutieux leurs
nombreux voyages, ménageant le quotidien et la vie sociale... À lui est resté
le « beau rôle », celui de l’écrivain mondain, du fin
causeur qui fréquente la haute société canadienne et française à Paris.
Extrait (LE NIGOG)
En
fondant Le Nigog, nous n’avions nullement comme but de démolir ou de
faire une petite révolution. Il n’y avait rien à démolir dans le monde vide que
nous habitions et une révolution ne s’accomplit pas contre le néant. Pourtant,
dès l’apparition des premiers numéros du Nigog on nous fit une réputation
fracassante. D’abord ce mot insolite: Nigog, étonnait beaucoup. C’est Pré- fontaine
qui l’avait trouvé et nous l’avait proposé un soir comme titre de notre revue.
Nous cherchions un mot qui ne fût pas trop banal et Revue de ceci ou Revue de
cela nous ennuyaient. « Appelons notre revue Le Nigog, dit Préfontaine,
personne ne saura ce que ça veut dire. »
Nous
l’ignorions tous d’ailleurs sauf Préfontaine et les Hébert. « Un nigog, dit
Préfontaine, c’est un dard dont les Indiens se servaient pour pêcher. A Québec
existe un élégant petit monument qui représente un Indien armé de cet
instrument. Il est de Philippe Hébert et s’appelle le Sauvage au nigog. » Le
mot nous plut et aussi le symbole du dard. Ozias Leduc était avec nous ce soir-là
et nous lui avons demandé de dessiner la couverture de la revue. Et c’est ainsi
que les douze numéros du Nigog parurent avec l’enseigne dessinée par le
peintre de la montagne de Saint- Hilaire.
Durant
ce sinistre hiver de 1918 l’ennui nous paralysait. Par les glaciales journées
de février, je me redisais mélancoliquement les vers de Mallarmé: « Ô miroir !
— Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée. — Que de fois et pendant des
heures — désolé des songes... » En Europe, la guerre s’éternisait et semblait
ne devoir jamais finir.
Le Nigog
nous délivra de l’ennui, eau froide dans son cadre gelée. Le soir, chez
Préfontaine, au lieu de parler de la guerre, d’échanger nos appréhensions pour
la France, nous préparions un numéro du Nigog. Préfontaine avait pris
ses fonctions de directeur très sérieusement. Il avait tout le temps de s’y
consacrer et cela l’intéressait prodigieusement. Il était aidé par Josée qui
était de- venue secrétaire bénévole de la revue. C’est elle qui corrigeait les épreuves
et relisait attentivement les articles. Préfontaine avait trouvé un imprimeur
qui ne nous écorchait pas trop. Il avait son installation rue Craig et
imprimait des circulaires commerciales et des cartes de visites pour hommes
d’affaires. Préfontaine réussit à le persuader de donner un aspect attrayant à
notre Nigog. Le premier fascicule eut un succès de curiosité. Des abonnements
arrivèrent et Préfontaine recueillit même des annonces, de sorte que la revue
put vivre sans rien nous coûter. Elle ne nous rapportait rien non plus, mais
cela nous l’avions prévu. Et nos collaborateurs nous donnaient gratuitement
leurs articles.
Car
nous avions trouvé des collaborateurs parmi nos amis. Le cénacle de chez
Préfontaine s’était sensiblement étendu. Le soir, sa bibliothèque était parfois
remplie d’une petite foule. Les poètes René Chopin et Paul Morin, le pianiste
Alfred Laliberté, le compositeur Rodolphe Mathieu, le vieux peintre Dyonnet,
les architectes Beaugrand-Champagne et Drouin venaient à nos réunions. Et aussi
des amis anglais: John Murray-Gibbon, Thomas Ludlow, John Roxburg Smith, Ramsey
Traquair, Bernard K. Sandwell. Ce dernier était journaliste, les autres
professeurs à l’Université McGill. Et un illustre professeur à l’Université de Montréal,
Edouard Montpetit, venait parfois prendre part à nos discussions. Un de mes
vieux amis, le spirituel abbé Olivier Maurault, fut de notre petite chapelle
sans en être pourtant le chapelain.
Parfois
nos réunions se faisaient dans le studio de Léo-Pol Morin et Victor Barbeau et
Marcel Dugas y donnèrent de remarquables conférences.
Les articles publiés dans Le Nigog sur
l’art et la littérature eurent une certaine influence. Ils apportaient quelque
chose de très nouveau, en tout cas, dans la province de Québec: un désir de
liberté intellectuelle, une tentative de sortir des vieilles ornières. Et
Gérard Morrisset, dans un ouvrage sur la peinture, a pu écrire récemment: « Ce
sont les critiques du Nigog qui, s’ils n’annoncent pas la brisure qui se fera
durement sentir plus tard, du moins attachèrent-ils le grelot. Leur œuvre de
critique, à la fois brillante, gamine et profonde a ouvert des horizons à la jeunesse
de l’époque 1920. » (p. 102-104)