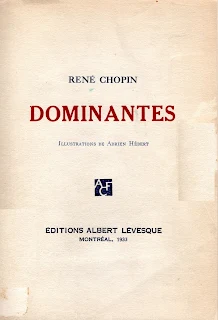Alfred Mousseau, Mirage, Montréal, J. A. Marchand imprimeur, 1913, 77 pages.
Tout comme Au village, ce livre a été édité grâce aux souscripteurs dont Laurier, Gouin, Taschereau... Le roman est précédé d’une préface dans laquelle on sent l’influence de Camille Roy : « Mon désir serait de graver, d’un burin sûr et fidèle, les traits de mes contemporains; mais cette ambition est difficile à réaliser et demanderait plus de maîtrise et plus d’habileté artistique que j’en ai. Je me contenterai donc d’esquisser un petit coin du grand tableau [...] me bornant à espérer qu’on dira, après avoir lu les pages qui vont suivre et qui sont un récit véridique d’évènements réels : « C’est bien comme cela que les choses arrivent, chez nous, dans la vie de tous les jours. »
Le roman compte deux intrigues, à peine reliées entre elles. La première et la plus importante est en partie une histoire du terroir. Saint-Augustin est un village « situé sur la ligne du Pacifique qui va de Montréal à Sainte-Agathe » qui est en train de devenir un lieu de villégiature pour les riches fortunés de Montréal. Pour un, le docteur Ducondu y a bâti une belle villa où il passe ses étés avec sa femme et sa fille Ernestine. Joseph Dulieu, un agent immobilier sans âme, a fleuré la bonne affaire. Il courtise un vieux cultivateur, Josaphat Beaulieu, espérant obtenir sa terre à vil prix, ce qu’il réussit. Plus encore, il réussit à le convaincre de s’installer à Montréal pour exploiter une épicerie qu’il lui vend au double de sa valeur, bien entendu! À l’époque, Montréal fait l’objet de grands développements domiciliaires qui constituent un plateau de choix pour les spéculateurs. Voyant autour de lui toutes ces gens qui réussissent à devenir riches du jour au lendemain, le vieux Beaulieu se laisse emporter par l’euphorie, se tourne encore vers Dulieu, qui, cette fois-ci, lui vend des terrains qui ne pourront prendre de la valeur avant dix ans, tant ils sont éloignés de la ville. Peu de temps se passe avant que le vieux cultivateur doive se rendre à l’évidence : il est ruiné. Le pauvre, il en meurt.
La seconde histoire est une intrigue sentimentale, tout ce qu’il y a de plus banal. C’est celle d’un étudiant en droit, Louis Duverger, le fils d’un cultivateur beaucoup plus sage que le père Beaulieu, un jeune homme, parfait sous toutes ses coutures. Lui, il a évité de se laisser corrompre par la ville. Comme récompense, il a réussi à franchir le fossé des classes sociales et à épouser la fille du riche docteur Ducondu.
Ce roman très moralisateur épouse l’idéologie du terroir, sans être vraiment un roman du terroir. Pour l’essentiel, l’intrigue se déroule en ville ou encore dans les villas que possèdent les riches villégiateurs. Tout ce monde s’entend pour dire que la vie à la campagne est la plus saine, que les valeurs paysannes sont les fondements de la nation.
Extraits
« Les jeunes gens de la ville qui sortent d’un externat pour entrer à l’université et qui demeurent dans leurs familles ne courent assurément pas de grand danger; ils ne font que garder les défauts ou les qualités qu’ils ont, car ils ne changent guère de milieu. Mais il n’en est pas de même des jeunes gens des campagnes. Ces derniers apportent la sève vive du sol; ils viennent mêler leur sang pur et fécond au rang appauvri des fils des cités; ils sont l’appoint d’énergie précieuse et de forces qui constituent une richesse inestimable. » (p. 15)
« C’est la loi inévitable du progrès : pendant que le peuple tout entier devient plus riche, plus cultivé, plus civilisé et augmente son bien-être matériel, des milliers d’êtres humains qui contribuent à cette marche en avant, à cette poussée de l’humanité, meurent misérablement; et la race trop affinée perd de sa vigueur et de sa force. Les derniers humains auront au service d’une cérébralité intense un corps débile. (p. 30)
« Elle était encore très jeune et elle avait peu lu, de sorte que les idées romanesques lui étaient inconnues. Elle était beaucoup plus heureuse ainsi, différente en cela de ces jeunes filles de la campagne qui gâtent leur vie, parce qu’elles ont reçu trop d’instruction, qui deviennent des déclassés et qui sont absolument malheureuses. [...] L’homme profite plus facilement de son instruction pour s’élever, pour améliorer sa situation. Mais la femme dont les parents, dont les frères, dont les voisins n’ont que peu d’instruction, regrettent souvent de n`être pas comprise par eux et souvent, dans l’état actuel de la société, tirer grand parti de son instruction. » (p. 41-42)
« Ils cueillaient la fleur de l’amour et ils jouissaient de ce qu’il offre de meilleur, car l’aveu enlève à l’amour son apanage éthéré, sa poésie, pour y substituer la réalité, pour le concrétiser, le transporter dans le domaine matériel et en faire une « chose », qui vieillira et disparaitra comme toutes les « choses ». (p. 49)
Tout comme Au village, ce livre a été édité grâce aux souscripteurs dont Laurier, Gouin, Taschereau... Le roman est précédé d’une préface dans laquelle on sent l’influence de Camille Roy : « Mon désir serait de graver, d’un burin sûr et fidèle, les traits de mes contemporains; mais cette ambition est difficile à réaliser et demanderait plus de maîtrise et plus d’habileté artistique que j’en ai. Je me contenterai donc d’esquisser un petit coin du grand tableau [...] me bornant à espérer qu’on dira, après avoir lu les pages qui vont suivre et qui sont un récit véridique d’évènements réels : « C’est bien comme cela que les choses arrivent, chez nous, dans la vie de tous les jours. »
Le roman compte deux intrigues, à peine reliées entre elles. La première et la plus importante est en partie une histoire du terroir. Saint-Augustin est un village « situé sur la ligne du Pacifique qui va de Montréal à Sainte-Agathe » qui est en train de devenir un lieu de villégiature pour les riches fortunés de Montréal. Pour un, le docteur Ducondu y a bâti une belle villa où il passe ses étés avec sa femme et sa fille Ernestine. Joseph Dulieu, un agent immobilier sans âme, a fleuré la bonne affaire. Il courtise un vieux cultivateur, Josaphat Beaulieu, espérant obtenir sa terre à vil prix, ce qu’il réussit. Plus encore, il réussit à le convaincre de s’installer à Montréal pour exploiter une épicerie qu’il lui vend au double de sa valeur, bien entendu! À l’époque, Montréal fait l’objet de grands développements domiciliaires qui constituent un plateau de choix pour les spéculateurs. Voyant autour de lui toutes ces gens qui réussissent à devenir riches du jour au lendemain, le vieux Beaulieu se laisse emporter par l’euphorie, se tourne encore vers Dulieu, qui, cette fois-ci, lui vend des terrains qui ne pourront prendre de la valeur avant dix ans, tant ils sont éloignés de la ville. Peu de temps se passe avant que le vieux cultivateur doive se rendre à l’évidence : il est ruiné. Le pauvre, il en meurt.
La seconde histoire est une intrigue sentimentale, tout ce qu’il y a de plus banal. C’est celle d’un étudiant en droit, Louis Duverger, le fils d’un cultivateur beaucoup plus sage que le père Beaulieu, un jeune homme, parfait sous toutes ses coutures. Lui, il a évité de se laisser corrompre par la ville. Comme récompense, il a réussi à franchir le fossé des classes sociales et à épouser la fille du riche docteur Ducondu.
Ce roman très moralisateur épouse l’idéologie du terroir, sans être vraiment un roman du terroir. Pour l’essentiel, l’intrigue se déroule en ville ou encore dans les villas que possèdent les riches villégiateurs. Tout ce monde s’entend pour dire que la vie à la campagne est la plus saine, que les valeurs paysannes sont les fondements de la nation.
Extraits
« Les jeunes gens de la ville qui sortent d’un externat pour entrer à l’université et qui demeurent dans leurs familles ne courent assurément pas de grand danger; ils ne font que garder les défauts ou les qualités qu’ils ont, car ils ne changent guère de milieu. Mais il n’en est pas de même des jeunes gens des campagnes. Ces derniers apportent la sève vive du sol; ils viennent mêler leur sang pur et fécond au rang appauvri des fils des cités; ils sont l’appoint d’énergie précieuse et de forces qui constituent une richesse inestimable. » (p. 15)
« C’est la loi inévitable du progrès : pendant que le peuple tout entier devient plus riche, plus cultivé, plus civilisé et augmente son bien-être matériel, des milliers d’êtres humains qui contribuent à cette marche en avant, à cette poussée de l’humanité, meurent misérablement; et la race trop affinée perd de sa vigueur et de sa force. Les derniers humains auront au service d’une cérébralité intense un corps débile. (p. 30)
« Elle était encore très jeune et elle avait peu lu, de sorte que les idées romanesques lui étaient inconnues. Elle était beaucoup plus heureuse ainsi, différente en cela de ces jeunes filles de la campagne qui gâtent leur vie, parce qu’elles ont reçu trop d’instruction, qui deviennent des déclassés et qui sont absolument malheureuses. [...] L’homme profite plus facilement de son instruction pour s’élever, pour améliorer sa situation. Mais la femme dont les parents, dont les frères, dont les voisins n’ont que peu d’instruction, regrettent souvent de n`être pas comprise par eux et souvent, dans l’état actuel de la société, tirer grand parti de son instruction. » (p. 41-42)
« Ils cueillaient la fleur de l’amour et ils jouissaient de ce qu’il offre de meilleur, car l’aveu enlève à l’amour son apanage éthéré, sa poésie, pour y substituer la réalité, pour le concrétiser, le transporter dans le domaine matériel et en faire une « chose », qui vieillira et disparaitra comme toutes les « choses ». (p. 49)