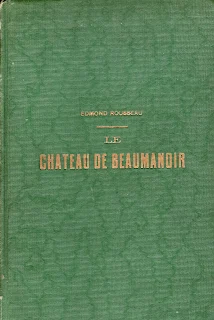Georges Boucher de Boucherville, Une de perdue, deux de trouvées, Montréal, Eusèbe Sénécal, 1874, t. I : 375 pages; t. II : 356 pages (1re publication en feuilleton : 1849-1851; version augmentée et remaniée en 1864-65)
 Nouvelle-Orléans, 1836. Alphonse Meunier vient de mourir, laissant son immense fortune à son fils adoptif Pierre de Saint-Luc. (En fait, comme on va le découvrir plus tard, c’est son vrai fils. Sa mère, croyant son mari mort, s’était remariée. C’est pourtant Meunier qui a élevé l’enfant, ce qui serait trop long à expliquer ici.) Saint-Luc est absent lors de la lecture du testament : il est à Cuba. Un personnage dans l’entourage de Meunier, le docteur Rivard, est prêt à tout pour s’emparer de l’héritage. Il a falsifié des documents civils afin qu'un jeune attardé intellectuel, qu'il a adopté, soit reconnu comme l'héritier, si Saint-Luc venait à disparaître.
Nouvelle-Orléans, 1836. Alphonse Meunier vient de mourir, laissant son immense fortune à son fils adoptif Pierre de Saint-Luc. (En fait, comme on va le découvrir plus tard, c’est son vrai fils. Sa mère, croyant son mari mort, s’était remariée. C’est pourtant Meunier qui a élevé l’enfant, ce qui serait trop long à expliquer ici.) Saint-Luc est absent lors de la lecture du testament : il est à Cuba. Un personnage dans l’entourage de Meunier, le docteur Rivard, est prêt à tout pour s’emparer de l’héritage. Il a falsifié des documents civils afin qu'un jeune attardé intellectuel, qu'il a adopté, soit reconnu comme l'héritier, si Saint-Luc venait à disparaître.
Le bateau de Saint-Luc, Le Zéphyr, met les voiles pour la Louisiane. Sir Arthur Gosford (le frère du gouverneur du Bas-Canada) et sa fille Clarisse sont montés à bord. Comme les pirates ont eu vent que Le Zéphyr transportait une forte somme d’argent, ils l'attaquent. Saint-Luc réussit à les déjouer et se mérite l’estime des Gosford.
 Nouvelle-Orléans, 1836. Alphonse Meunier vient de mourir, laissant son immense fortune à son fils adoptif Pierre de Saint-Luc. (En fait, comme on va le découvrir plus tard, c’est son vrai fils. Sa mère, croyant son mari mort, s’était remariée. C’est pourtant Meunier qui a élevé l’enfant, ce qui serait trop long à expliquer ici.) Saint-Luc est absent lors de la lecture du testament : il est à Cuba. Un personnage dans l’entourage de Meunier, le docteur Rivard, est prêt à tout pour s’emparer de l’héritage. Il a falsifié des documents civils afin qu'un jeune attardé intellectuel, qu'il a adopté, soit reconnu comme l'héritier, si Saint-Luc venait à disparaître.
Nouvelle-Orléans, 1836. Alphonse Meunier vient de mourir, laissant son immense fortune à son fils adoptif Pierre de Saint-Luc. (En fait, comme on va le découvrir plus tard, c’est son vrai fils. Sa mère, croyant son mari mort, s’était remariée. C’est pourtant Meunier qui a élevé l’enfant, ce qui serait trop long à expliquer ici.) Saint-Luc est absent lors de la lecture du testament : il est à Cuba. Un personnage dans l’entourage de Meunier, le docteur Rivard, est prêt à tout pour s’emparer de l’héritage. Il a falsifié des documents civils afin qu'un jeune attardé intellectuel, qu'il a adopté, soit reconnu comme l'héritier, si Saint-Luc venait à disparaître.Le bateau de Saint-Luc, Le Zéphyr, met les voiles pour la Louisiane. Sir Arthur Gosford (le frère du gouverneur du Bas-Canada) et sa fille Clarisse sont montés à bord. Comme les pirates ont eu vent que Le Zéphyr transportait une forte somme d’argent, ils l'attaquent. Saint-Luc réussit à les déjouer et se mérite l’estime des Gosford.
Au même moment, les esclaves se révoltent. Alphonse Meunier a laissé non seulement de l’argent et de l’immobilier mais aussi plusieurs esclaves. Saint-Luc réussit à mâter la révolte. Il trouve même un moyen qui permettra aux esclaves de s’émanciper en cinq ans.
Ayant réglé ses problèmes de succession et d’intendance, il décide d’entreprendre un voyage au Canada afin de retrouver sa mère. Il se rend à Montréal, est mêlé aux affrontements entre les membres du Doric club et des Fils de la liberté. Son enquête le mène à Saint-Ours, puis à Québec. Là, il retrouve Sir Arthur Gosford et sa fille Clarisse. Il fréquente les bals et les salons et rencontrent deux jeunes filles, deux jumelles, qui lui plaisent beaucoup. Il finit par découvrir que leur mère est sa mère. On apprend, en épilogue, qu’il a épousé Clarisse Gosford.Quand Le Zéphyr approche de la Nouvelle-Orléans, un petit bateau vient à leur rencontre avec un supposé message d’Alphonse Meunier, demandant à Saint-Luc de les accompagner. Bien entendu, ce dernier ignore que son père adoptif est décédé. C’est un piège orchestré par le Dr Rivard dans le but de faire disparaître l’héritier de Meunier. Saint-Luc est emmené dans un lieu désert, ligoté et emprisonné. Les malfaiteurs dénichent un cadavre, le faisant passer pour celui de Saint-Luc. Tout le monde le croit mort, sauf son fidèle serviteur Trim. Ce dernier enquête, le retrouve, le libère : le plan du docteur Rivard échoue et Saint-Luc prend possession de son héritage.
 |
| Boucher de Boucherville - BAnQ |
On trouve de tout dans Une de perdue, deux de trouvées : le roman commence par une classique histoire de pirates. En même temps, on assiste aux manigances d’un personnage diabolique et aux ruses qu’il met en place pour se saisir de l’héritage du héros. Ces deux histoires sont abandonnées au milieu du roman et, presque sans transition, on se retrouve dans une révolte d’esclaves. Le roman devient plus sérieux, Boucher de Boucherville développant un discours antiesclavagiste. Cette histoire se clôt elle aussi de façon abrupte et voilà que nous sommes transportés au Bas-Canada en pleine crise de Rébellion. On a reproché à Boucherville sa vision de la Rébellion : effectivement son héros se sent aussi près des Anglais que des Patriotes. En même temps, s’amorce une histoire d’amour. Vous l’aurez compris, le roman fourmille de péripéties, de batailles, d’actions d’éclats, de revirements et le résumé que j’en ai fait ne retient que les grandes lignes. On a aussi reproché, avec raison, au roman son manque d’unité. Effectivement, il y a trois romans dans un. Boucherville se montre sous son meilleur jour dans l’histoire de pirates du début.
Extrait
« —Bien, mes enfants, cria le capitaine, en avant maintenant !
Les marins du Zéphyr s'élancent sur le gaillard ; le capitaine ordonne de mettre le feu au chaudron, et une immense flamme s'élance et répand au loin sa lumière sur les eaux. Ce fut alors une horrible mêlée. Les pirates montent par les amarres, se hissent les uns sur les autres ; ils lancent leurs grappins dans les cordages et grimpent dans toutes les directions. Une voix retentit qui les encourage. C'est Cabrera, Antonio Cabrera leur chef. Il est sur le gaillard d'avant avec une dizaine des siens, repoussant l'attaque et favorisant l'abordage des pirates. Le tumulte est à son comble. Tout est confusion. Pirates et Zéphyr sont confondus. C'est une lutte acharnée, d'homme à homme ; tout se culbute et se relève pour rouler et se culbuter encore. Les fusils ne servent plus ; les pistolets sont déchargés. Le sang ruisselle et rend le pont glissant. Tous les pirates sont maintenant montés. Le gaillard d'avant est trop petit pour les contenir. Les Zéphyrs semblent céder sous les efforts prodigieux de Cabrera et de ses gens. La flamme bleuâtre de l'alcool et des combustibles, qui brûlent dans le chaudron, répand une lueur blafarde sur leurs figures, couvertes de poudre et de sang. Ils sont serrés en masse compacte et pressant devant eux les Zéphyrs qui reculent pied à pied, mais en ordre.
Le capitaine Pierre n'est pas avec eux, il est à l'arrière, debout sur son banc de quart, son porte-voix à la main ; il suit avec sang-froid la lutte qui rugit à l'avant du navire.
Il voit ses Zéphyrs qui cèdent peu à peu ; il ne craint rien, car il sait que c'est une manœuvre qu'ils exécutent afin d'amener les pirates sous la portée de ses deux canons. Arrivés près du mât d'artimon, les Zéphyrs déchargent leurs derniers coups de pistolet ; les pirates hésitent, s'arrêtent et se pressent en masse serrée.
« — Ventre à terre ! crie le capitaine à travers son porte-voix.
— Feu » !
Et les deux canons partent ensemble, enfilant le pont de bout en bout, à la hauteur de poitrine d'homme ; la mitraille balaye et fauche à travers les rangs des pirates qui sont restés debout. Ceux qui ne sont pas tombés, se retirent précipitamment vers le beaupré pour sauter dans les chaloupes. Mais Cabrera est là, il les arrête de sa voix :
« — Je tue le premier qui recule, crie-t-il, en avant ! suivez-moi » !
Et il s'élance encore une fois à la tête des siens. Mais cette fois, Pierre est aux premiers rangs de ses braves Zéphyrs. La mort suit leurs sabres qui tranchent et fauchent dans les rangs des pirates. Cabrera a reconnu Pierre, et c'est sur lui que se concentrent toute sa rage et toute sa fureur. Il fait des efforts inouïs pour le rejoindre. En vain son sabre promène la mort devant lui, la mêlée est trop affreuse, des masses d'hommes le séparent de celui qu'il voudrait tenir sous sa main. (tome I, pages 96-98)