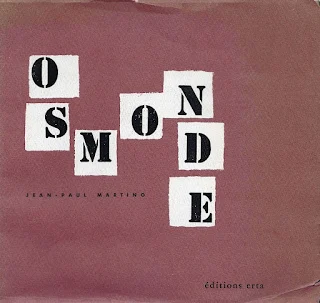Le recueil
compte trois parties : « Poèmes pour l’Haggadah » et
« Poèmes de la sommeillante » et « Dormir Vivre Dormir et se
réveiller ivre ».
Poèmes pour l’Haggadah et le passage
Cette partie ne compte que trois poèmes et elle comporte des
références religieuses. Intitulé « A mon fils », le premier poème
plonge le lecteur dans la culture juive, et il est difficile de déterminer si
le propos est personnel ou la contrefaçon d’un discours religieux. Dans un
paysage apocalyptique, la poète essaie de tracer une voie à son fils :
« tu lèveras ta main comme un sceptre / nous parcourerons (sic) les rues
en cendres / jésus-joad-emmanuel-c ». Il me semble que ce motif de
l’intégration dans une culture religieuse est aussi lisible dans le second
poème : « des prophètes mille illuminés s’agenouillent et brandissent
leur descendance / … / et t’appellent et te tirent et cisaillent mon doux sein
paré d’escale ». Par contre, dans le troisième poème, la poète s’adresse à
Jésus et le discours ressemble à celui d’une femme qui veut s’affranchir
de certaines croyances : « le mal grandit avec son écho dans
l’habitation vide / et avec lui le cerne étroit du premier dard ». Ou encore :
« cette fille aux seins allongés qui parlait de prière / parlant
aujourd’hui d’eau même / qui nous dit sa parabole / son amour va au guide des
caravanes ».
Poèmes de la
sommeillante
C’est un peu la même démarche que je lis dans la seconde
partie, celle d’un affranchissement, mais cette fois-ci, d’une situation
amoureuse qui finit par devenir un carcan : « je n’irai pas vers
la mer dit Sofia je resterai / sur la berge de l’île ici / où je peux rester
moi-même […] ». La sommeillante prend conscience que cet « amour sans
racine » n’est pas viable : « les vents tournent sur leur tige /
et la sommeillante découvre ses prunelles ». Au sortir du sommeil, la
femme retrouve ses repères en tant que femme (Femme comme lieu et lande) mais aussi sa capacité à habiter la
société (Éveil de l’œil).
« Dormir Vivre Dormir et se
réveiller ivre »
(Cocteau)
Le motif du sommeil est toujours présent, mais davantage lié
à celui du songe. Cette amoureuse qui sommeille, c’est aussi celle qui rêve. Et
toujours la même constatation : « ainsi le sommeil et sa proie
l’acquiescement ». Cette partie, plus accessible, nous aide à comprendre
ce qui précède : « je suis la sommeillante au milieu des filets / et
je suis la proie / en ce lieu du gémissement ». Et toujours le même
dénouement : « la sommeillante debout dans le songe qui croule et se
diffuse ».
Cependant, les deux derniers poèmes du recueil nous amènent
plus loin, il me semble sur un plan plus philosophique : « un sommeil
que je décris cherche ses liens / l’être écrasé poursuit son évasion / et tend
les poignets à des chaines intérieures / la mystique n’est que nervure et voile
/ de l’absolu à la connaissance ». Ce besoin d’aller vers le
plus-grand-que-soi est affirmé dans les derniers vers du recueil :
« CAR / le signe demeure / temple / et abondance de génération ».
Vous l’avez sans doute deviné à la prudence de mon texte, il
est un peu hasardeux de se lancer dans l’interprétation d’un tel recueil. Il
est bien évident que l’auteure tente de brouiller les pistes trop faciles à
suivre. Ceci dit, il est étonnant que cette auteure n’ait pas
persévéré.
FEMME COMME LIEU ET LANDE
Femme à la fenêtre du
désir et qui fixes ton œil pensif
sur la
plaie incendiaire
femme des pardons femme
des tolérances et fertile
eau et lait jeune sanguine
à l’aile lourde
l'algue et la sargasse
t’immergent et te continuent
jeu de l’attraction et du
symbole retiré
comme tu conserves bien
l’irrigation paisible du sang
et la crue immémoriale du
lieu sur l’être:
SOMMEIL