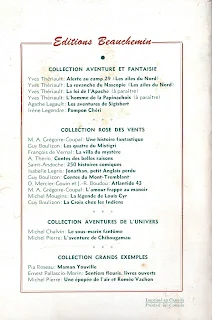John Uriah Gregory, En racontant. Récits de voyages en
Floride, au Labrador et sur le fleuve Saint-Laurent, Québec,
Typographie C. Darveau, 1886, 245 pages. (Traduction :
Alphonse Gagnon)
Le Labrador (ancienne appellation de la Basse-Côte-Nord)
est assez bien représenté dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Jean-Baptiste Ferland (Le Labrador,
1860), Faucher de Saint-Maurice (De tribord
à babord, 1877), Zacharie Lacasse, (Trois contes sauvages, 1882) Henry de Puyjalon (Récits du Labrador, 1894), et Victor Huard (Labrador et
Anticosti, 1897) ont tous laissé un témoignage de leur passage dans cette région
isolée du reste du monde.
John Uriah Gregory (1830-1913) était chef de
bureau du Ministère de la Marine à Québec. Mes recherches me laissent croire
que son livre, traduit par Alphonse Gagnon, n’a jamais paru en anglais. Trois textes portent sur la Basse-Côte-Nord. Il faut
lire cette oeuvre (plus autobiographique, ethnologique que littéraire) comme le témoignage d’une époque.
Les Pêcheurs
du Labrador
« Au commencement de l’automne de cette même
année, le gouverneur-général, alors Lord Monck, reçut une lettre du capitaine
du vaisseau le Sphinx, revenant d’une croisière sur la côte du Labrador,
attirant son attention sur l’état déplorable des pêcheurs, et citant, en
particulier, le cas d’une famille de la baie Bradore, appelée Jones. » On
est en septembre 1868. Gregory va visiter cette famille Jones et d’autres
pêcheurs qui meurent littéralement de faim avec mission de les aider. Le
bateau, plein de victuailles, l’amène directement à Blanc-Sablon. La chasse aux
loups-marins est le principal gagne-pain de ces gens. Les pêcheurs côtiers font
la chasse avec des seines, mais encore faut-il que les bêtes daignent passer
près des rivages. Ils ne font pas le poids face aux bateaux commerciaux qui
peuvent chasser les bêtes sur les banquises. L’auteur va s’arrêter à plusieurs
postes en remontant le fleuve. En plus de la chasse aux phoques, différents
sujets vont être abordés : le chien esquimau et le cométique, la chasse à
la baleine, la surexploitation des ressources, l’exploitation des pêcheurs par
les trafiquants, la chasse sur le continent...
En Floride
Voyage touristique. Un train l’amène à New York, un bateau à Savanah
et un autre bateau à Jacksonville. Gregory s’intéresse au climat, à la culture
des oranges, des arbres fruitiers, à l’agriculture. « Nous fîmes feu sur
eux à droite et à gauche, et, si l’on peut en juger par les jets d’eau qu’ils
provoquèrent, nous dûmes en (les caïmans) atteindre plusieurs. »
Le Fleuve
Saint-Laurent - Le Fleuve Saint-Laurent
- Navigation d’hiver
Chapitre très technique, dans lequel le
fonctionnaire Gregory énumère les différents moyens mis en œuvre par le
gouvernement pour faciliter la navigation sur le fleuve, été comme hiver.
L’île
d’Anticosti et ses naufrages
Après avoir énuméré les ressources de l’île et
précisé les moyens mis à la disposition des navires pour éviter les naufrages
(phares, cornes de brume, réserve de nourriture), l’auteur va raconter
quelques-uns des naufrages célèbres dont Anticosti fut le théâtre. La moitié du chapitre est consacré au naufrage de la Renommée en 1736 et
surtout au difficile hiver de survie qui s’ensuivit. Gregory cite le récit que
Faucher de Saint-Maurice en a fait dans De
babord à tribord. Il passe plus rapidement sur d’autres naufrages célèbres : celui de
l’amiral Phipps en 1690, ceux du Bristolian et du Pamlico en 1880, celui du
Granicus en 1828, celui de Walker à l’île-aux-Œufs en 1711. Pour terminer, l’auteur termine en expliquant
que la récente colonisation de l’île (fondée sur la culture de la patate)
assure aux rescapés de meilleures chances de survie.
Une Baleine
dans le port de Québec
Histoire humoristique. Un pêcheur a trouvé à
« vingt-quatre milles en bas de Québec, et à cent milles de l’eau salée »
une grosse baleine échouée sur le rivage. Il l’a remorquée jusqu’à Québec et il
offre à Gregory la possibilité d’exploiter le cadavre (huile, les os). Ce
dernier, tout fonctionnaire qu’il soit en 1872, accepte la proposition. Ce qui
devait s’avérer avantageux au plan pécuniaire, tourne au désastre : les
visiteurs accourent, on les fait payer, mais au bout de trois jours un
inspecteur de l’hygiène l’oblige à débarrasser le port de cette
« puanteur ». Ceci n’est que
le début d’une suite de déboires : le narrateur va perdre de l’argent et
voguer d’ennuis en ennuis.
Dans le Bas
du Fleuve
« En juillet 1872, mes devoirs officiels
m’obligèrent à visiter la côte du Labrador, en bas de la Pointe de Monts. »
À la suite d’une tempête, Gregory doit passer une nuit chez un guide. C’est là
qu’il rencontre une femme instruite, madame Gitony, qui vit dans ces lieux
éloignés de tout. Elle lui raconte un peu sa vie, en partie passée sur l’île
d’Anticosti. Gregory parle aussi des gardiens de phares, dont plusieurs étaient
instruits. « Il est des personnes qui deviennent tellement éprises de la vie
sauvage et libre des bois que, malgré ses fatigues, ses privations, ses luttes
contre la faim, un séjour de quelques mois dans une grande ville leur devient
ennuyeux au point qu’elles aspirent bientôt à reprendre leur première
occupation ; ce qui arrive fréquemment. »
Un oiseau
sans plumes
Histoire humoristique. Gregory accompagne un
« gentilhomme » qui est aussi « un
savant et un littérateur d’un grand mérite » dans une excursion de pêche.
Ce dernier ne cache pas sa déception quand Gregory s’avère incapable de
répondre à ses questions sur la botanique et la géologie. Mais il tient sa
revanche quand le prétentieux gentilhomme confond le chant d’une grenouille
avec celui d’un oiseau.
Lire En racontant…