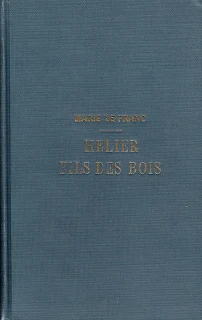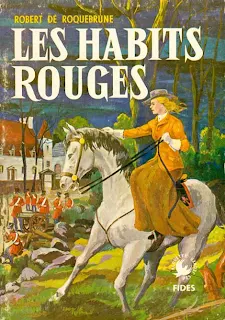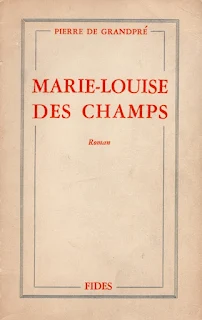Marie Le Franc, Hélier fils des bois, Paris, Rieder, 1930, 283 p.
À 26 ans, Julienne Javilliers « n’a pas connu l’amour ». Cette intellectuelle décidée fait peur aux hommes. Elle est originaire du Midi de la France, est passée par Paris. Grâce à une bourse, elle est venue aux États-Unis, a enseigné un an au Montana, puis est débarquée à McGill pour étudier le parler canadien-français. Depuis, elle y enseigne, ne retournant en France que l’été, s’y sentant de moins en moins chez elle.
Cet été, elle décide de le passer en solitaire au Lac Tremblant, pour « voir clair en [elle] ». Déjà, à cette époque, Tremblant est un lieu touristique prisé des touristes anglais. Des petits chalets sont disséminés autour du lac. Julienne s’installe au camp Lighthall, dans la Baie-des-Ours, sur le rive nord du lac, le côté le moins habité. La première personne qu’elle rencontre est Hélier le Touzel. C’est l’homme à tout faire du club des « sporstmen » : il est postier, il livre la marchandise, il dirige des excursions... Il aide Julienne à traverser sur l’autre rive, à remettre en état le chalet qu’elle habitera, à transporter vivres et bagages. Sur place, Julienne doit commencer par apprivoiser ces lieux sauvages, sa solitude, sa peur. Le chalet est complètement isolé. Elle se retrouve seule au bord de la grande forêt nordique.
Rapidement, elle se laisse prendre par « l’énorme nature ». Hélier, qui veille sur elle, lui propose une excursion à La Palissade. Cette excursion lui permet de découvrir la forêt, avec ses charmes et ses pièges. Ils passent le dimanche ensemble, parlant peu, contemplant le lac. Un autre soir, ils décident de faire une excursion sur la Cachée, une rivière qui n’inspire qu’un sentiment de mort, de désolation.
Arrive dans le décor Renault Saint-Cyr, secrétaire de la Ligue des relations internationales. Il a loué un chalet qu'il habite avec son domestique. Il est tout le contraire de Hélier. Il connaît déjà Julienne et lui fait la cour. Julienne se sent tiraillée entre Renault et Hélier. Elle relance Hélier : ils vont voir le petit lac vert, le lac d’Hélier. Renault est malade, elle le soigne. Mais l’aime-t-elle?
L’automne arrive. Renault et Julienne s’aventurent en pleine forêt, à l’assaut de la Palissade. Ils se perdent, passent une nuit dehors. Il pleut, elle gèle; Renault se révèle sous un jour bien peu reluisant. C’en est fini de ses amours pour lui.
Avant de partir, elle décide d’aller surprendre Hélier au lac Vert. On découvre que Hélier l’aime. Elle lui fait ses adieux. On peut penser qu’ils font l’amour….
Quand on lit Marie Le Franc, il faut s’attendre à beaucoup de descriptions. Ce roman ne fait pas exception. Au moins cinquante pages sont consacrées à la nature laurentienne. Trop? Pas nécessairement. C’est la force de Marie le Franc. La description n’est jamais banale. La nature sauvage révèle les êtres à eux-mêmes. « Elle s'arrêtait, devant lui [Hélier] comme on s'arrête devant une forêt, avec timidité et rêverie. La forêt domine de sa hauteur et de son épaisseur. Il faut lui demander la permission d'avancer. Elle se referme à mesure qu'elle s'ouvre. Elle recrée de l'ombre et du mystère. Elle donne envie de regarder en arrière. Elle prépare, à notre insu, un chemin de retour. Elle arrache à nos épaules des pans d'ombre qu'elle tisse avec la sienne : elle force la pensée à semer sur ses pas. Le progrès qu'on fait en elle ne signifie pas l'abandon d'un lambeau de soi. La recherche n'est pas destructive. » L’humain s’y retrouve comme au premier temps de l’humanité, démuni, vulnérable : « La forêt était d'une vieillesse inimaginable, couverte d'une pourriture végétale amoncelée par les siècles. Des arbres géants étaient couchés à terre, moussus, en apparence intacts, dans l’attente d'une sépulture. On posait le pied dessus, sans défiance, et on y enfonçait jusqu'au genou. » À vrai dire, aucun auteur québécois de souche n’a mieux décrit la forêt que cette Française. Ce roman ressemble beaucoup à La Randonnée passionnée que j’ai déjà blogué. Le Franc reprend ses deux thèmes de prédilection : la nature et l’amour. Tout un chapitre, le onzième, est consacré au thème amoureux. ****
Extrait
Les arbres étaient de petites et de grandes maisons, des édifices majestueux et un nombre infini de cabanes jetées les unes sur les autres. Les branchages formaient des charpentes, des toits, des pans de murs. Il y avait des ombres incompréhensibles, emprisonnées entre les arbres. On s'en allait dans la forêt en cherchant ses intentions. On arrivait tout d'un coup à des endroits où la lumière s'était accumulée depuis des siècles, comme si un grand lampadaire eût continué d'éclairer une ville où ne vivait. plus personne. On restait un instant sur les bords, à regarder la zone lumineuse, entre les branches écartées, osant à peine la troubler. On respirait en elle l'haleine des âges. On n'avait d'autre but que d'aller de l'avant. L'effort humain devenait enfin désintéressé : il n'avait plus pour objet d'ajouter au fatras de ses acquisitions. Il cédait à la magie de la solitude qui agrandissait sans cesse son cercle. Toute chose avait un envers, un au-delà. C'était à la partie de la forêt qu'on ne voyait pas et que l'on n'atteindrait probablement jamais qu'allait la curiosité. Elle devait aboutir à des lieux fantastiques, qu'on ne réussissait pas à concevoir, dans lesquels l'imagination se plaisait à se dissoudre. Il y avait une ivresse à avancer sans chemin, à éparpiller au vent des efforts perdus. Il fallait de temps en temps placer doucement son visage contre les arbres et jeter une exclamation sourde : « Forêt Tremblante ! » comme pour s'alléger d'un amour accumulé. On éprouvait de la reconnaissance qu'elle vous tolérât au centre de son mystère, et l'on se sentait devenir partie de ce mystère. Elle avait une personnalité qui tenait à la fois de la bête et de l'homme : puissance physique et spiritualité, mais l'une et l’autre décuplées, sans bornes. (p. 136-137)
À 26 ans, Julienne Javilliers « n’a pas connu l’amour ». Cette intellectuelle décidée fait peur aux hommes. Elle est originaire du Midi de la France, est passée par Paris. Grâce à une bourse, elle est venue aux États-Unis, a enseigné un an au Montana, puis est débarquée à McGill pour étudier le parler canadien-français. Depuis, elle y enseigne, ne retournant en France que l’été, s’y sentant de moins en moins chez elle.
Cet été, elle décide de le passer en solitaire au Lac Tremblant, pour « voir clair en [elle] ». Déjà, à cette époque, Tremblant est un lieu touristique prisé des touristes anglais. Des petits chalets sont disséminés autour du lac. Julienne s’installe au camp Lighthall, dans la Baie-des-Ours, sur le rive nord du lac, le côté le moins habité. La première personne qu’elle rencontre est Hélier le Touzel. C’est l’homme à tout faire du club des « sporstmen » : il est postier, il livre la marchandise, il dirige des excursions... Il aide Julienne à traverser sur l’autre rive, à remettre en état le chalet qu’elle habitera, à transporter vivres et bagages. Sur place, Julienne doit commencer par apprivoiser ces lieux sauvages, sa solitude, sa peur. Le chalet est complètement isolé. Elle se retrouve seule au bord de la grande forêt nordique.
Rapidement, elle se laisse prendre par « l’énorme nature ». Hélier, qui veille sur elle, lui propose une excursion à La Palissade. Cette excursion lui permet de découvrir la forêt, avec ses charmes et ses pièges. Ils passent le dimanche ensemble, parlant peu, contemplant le lac. Un autre soir, ils décident de faire une excursion sur la Cachée, une rivière qui n’inspire qu’un sentiment de mort, de désolation.
Arrive dans le décor Renault Saint-Cyr, secrétaire de la Ligue des relations internationales. Il a loué un chalet qu'il habite avec son domestique. Il est tout le contraire de Hélier. Il connaît déjà Julienne et lui fait la cour. Julienne se sent tiraillée entre Renault et Hélier. Elle relance Hélier : ils vont voir le petit lac vert, le lac d’Hélier. Renault est malade, elle le soigne. Mais l’aime-t-elle?
L’automne arrive. Renault et Julienne s’aventurent en pleine forêt, à l’assaut de la Palissade. Ils se perdent, passent une nuit dehors. Il pleut, elle gèle; Renault se révèle sous un jour bien peu reluisant. C’en est fini de ses amours pour lui.
Avant de partir, elle décide d’aller surprendre Hélier au lac Vert. On découvre que Hélier l’aime. Elle lui fait ses adieux. On peut penser qu’ils font l’amour….
Quand on lit Marie Le Franc, il faut s’attendre à beaucoup de descriptions. Ce roman ne fait pas exception. Au moins cinquante pages sont consacrées à la nature laurentienne. Trop? Pas nécessairement. C’est la force de Marie le Franc. La description n’est jamais banale. La nature sauvage révèle les êtres à eux-mêmes. « Elle s'arrêtait, devant lui [Hélier] comme on s'arrête devant une forêt, avec timidité et rêverie. La forêt domine de sa hauteur et de son épaisseur. Il faut lui demander la permission d'avancer. Elle se referme à mesure qu'elle s'ouvre. Elle recrée de l'ombre et du mystère. Elle donne envie de regarder en arrière. Elle prépare, à notre insu, un chemin de retour. Elle arrache à nos épaules des pans d'ombre qu'elle tisse avec la sienne : elle force la pensée à semer sur ses pas. Le progrès qu'on fait en elle ne signifie pas l'abandon d'un lambeau de soi. La recherche n'est pas destructive. » L’humain s’y retrouve comme au premier temps de l’humanité, démuni, vulnérable : « La forêt était d'une vieillesse inimaginable, couverte d'une pourriture végétale amoncelée par les siècles. Des arbres géants étaient couchés à terre, moussus, en apparence intacts, dans l’attente d'une sépulture. On posait le pied dessus, sans défiance, et on y enfonçait jusqu'au genou. » À vrai dire, aucun auteur québécois de souche n’a mieux décrit la forêt que cette Française. Ce roman ressemble beaucoup à La Randonnée passionnée que j’ai déjà blogué. Le Franc reprend ses deux thèmes de prédilection : la nature et l’amour. Tout un chapitre, le onzième, est consacré au thème amoureux. ****
Extrait
Les arbres étaient de petites et de grandes maisons, des édifices majestueux et un nombre infini de cabanes jetées les unes sur les autres. Les branchages formaient des charpentes, des toits, des pans de murs. Il y avait des ombres incompréhensibles, emprisonnées entre les arbres. On s'en allait dans la forêt en cherchant ses intentions. On arrivait tout d'un coup à des endroits où la lumière s'était accumulée depuis des siècles, comme si un grand lampadaire eût continué d'éclairer une ville où ne vivait. plus personne. On restait un instant sur les bords, à regarder la zone lumineuse, entre les branches écartées, osant à peine la troubler. On respirait en elle l'haleine des âges. On n'avait d'autre but que d'aller de l'avant. L'effort humain devenait enfin désintéressé : il n'avait plus pour objet d'ajouter au fatras de ses acquisitions. Il cédait à la magie de la solitude qui agrandissait sans cesse son cercle. Toute chose avait un envers, un au-delà. C'était à la partie de la forêt qu'on ne voyait pas et que l'on n'atteindrait probablement jamais qu'allait la curiosité. Elle devait aboutir à des lieux fantastiques, qu'on ne réussissait pas à concevoir, dans lesquels l'imagination se plaisait à se dissoudre. Il y avait une ivresse à avancer sans chemin, à éparpiller au vent des efforts perdus. Il fallait de temps en temps placer doucement son visage contre les arbres et jeter une exclamation sourde : « Forêt Tremblante ! » comme pour s'alléger d'un amour accumulé. On éprouvait de la reconnaissance qu'elle vous tolérât au centre de son mystère, et l'on se sentait devenir partie de ce mystère. Elle avait une personnalité qui tenait à la fois de la bête et de l'homme : puissance physique et spiritualité, mais l'une et l’autre décuplées, sans bornes. (p. 136-137)